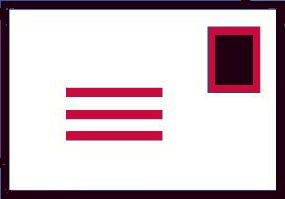Berlin,
dans les premiers jours de 1919, avait l’air d’une ville dans
laquelle rien ne pouvait arrêter l’influence croissante de la
gauche révolutionnaire. Le gouvernement Ebert était de plus en plus
fragile. Les Sociaux-Démocrates Indépendants l’avaient abandonné.
L’armée se décomposait. Une vague de grèves poussait de plus en
plus d’ouvriers dans l’opposition et le gouvernement demeurait
impuissant, son organe de parti saisi. Par dessus tout, la gauche
révolutionnaire exerçait une influence sur les deux corps armés
les plus importants de la ville – la Division de Marine du Peuple
et la Force de Sécurité d’Eichhorn.
Ebert
songeait à abandonner Berlin. « Vous
savez, maintenant je m'en vais. »,
dit-il au général Groener. « Si
la bande de Liebknecht en profite pour prendre le pouvoir, personne
ne peut les en empêcher. Mais si rien ne peut être trouvé, si je
ne peux rien trouver, alors nous sommes en capacité après quelques
jours d'établir à nouveau notre gouvernement ici ou là ».1
Mais
les généraux le persuadèrent de tenir. Le 4 janvier, le
gouvernement fit sa première contre-offensive. Il annonça
qu’Eichhorn avait été démis de ses fonctions de chef de la
police.
Il
s’agissait là d’une provocation délibérée. Le gouvernement
savait que plus il attendait, plus il perdait sa popularité dans la
capitale. Mais il pensait aussi que les Freikorps avaient rassemblé
suffisamment de forces hors de Berlin pour briser tout coup d’Etat
de la gauche. Il cherchait désormais à provoquer une action
prématurée des masses de Berlin, pour reprendre ensuite la ville
par la force, en prétendant qu’il se bornait à restaurer l’ordre
et à empêcher le chaos.
Le
général Groener déclara devant un tribunal en 1925 que dès le 29
décembre, « Ebert
avait ordonné à Noske de lancer les troupes contre les
spartakistes. Le corps de volontaires se rassembla le 29 et tout
était prêt pour l’ouverture des hostilités »2
Noske
prit sans états d’âme l’emploi de ministre de la défense. Et
il ne faisait pas mystère de ce qu’il comportait. « Quelqu’un
doit être le bourreau ! (Bluthund
– littéralement : le chien de Saint-Hubert) »,
déclara-t-il.
Le
jour ou le limogeage d’Eichhorn fut annoncé, Noske et Ebert
inspectèrent en dehors de Berlin six corps de volontaires composés
d’officiers d’extrême droite triés sur le volet. Le général
Märcher raconte :
Déjà dans les premiers jours
de janvier
une réunion des chefs des Freikorps au sujet des détails de la
marche sur Berlin avait eu lieu à l’état-major à Berlin, à
laquelle (...) Noske était présent.3
Rien
de tout cela ne constituait une réplique à un « soulèvement
spartakiste » à Berlin. C’était au contraire l’élément
d’un plan soigneusement mis au point pour provoquer une action qui
pourrait être présentée comme un soulèvement, puis la réprimer.
Comme le social-démocrate Ernst, qui avait remplacé Eichhorn comme
chef de la police, devait le dire quinze jours plus tard à des
journalistes : « Avec
nos préparatifs, nous avons forcé les spartakistes à frapper plus
tôt ».4
Les
travailleurs de Berlin accueillirent la nouvelle du renvoi d’Eichhorn
par une énorme vague de colère. Ils sentaient qu’il avait été
démis pour s’être rangé de leur côté contre les attaques des
officiers d’extrême droite et des patrons. Eichhorn répondit en
refusant d’évacuer les locaux du quartier général de la police.
Il proclama avec insistance qu’il avait été désigné par la
classe ouvrière berlinoise et qu’il ne pouvait être renvoyé que
par elle. Il accepterait une décision du l’Exécutif de Berlin des
Conseils d’Ouvriers et de Soldats, et de personne d’autre.
Si
le gouvernement ne s’était soucié que du poste d’Eichhorn, il
l’aurait alors pris au mot – puisque l’Exécutif de Berlin
était à majorité social-démocrate. Mais c’était autre chose
qui était en jeu – une bataille à mort avec la révolution et
avec ses organisations, même si ces dernières étaient
temporairement sous le contrôle des sociaux-démocrates. Cette
bataille ne pouvait être menée en reconnaissant qu’une telle
organisation avait le pouvoir de nommer le chef de la police de
Berlin.
Les
dirigeants des Indépendants rencontrèrent des représentants des
Délégués Révolutionnaires et du Parti Communiste récemment
constitué pour discuter de la suite à donner au renvoi d’un de
leurs membres d’un poste aussi important. Il fut décidé que la
résistance devait prendre la forme d’une manifestation pacifique
le lendemain, un dimanche. Un tract fut distribué, qui expliquait ce
qui était en jeu :
Ce que veut le gouvernement
Ebert-Scheidemann, ce n’est pas seulement se débarrasser du
dernier homme de confiance de la classe ouvrière révolutionnaire de
Berlin, mais surtout établir contre ces travailleurs
révolutionnaires un régime de coercition. (..) Le coup dirigé
contre le chef de la police de Berlin doit frapper le prolétariat
allemand dans son ensemble, doit frapper toute la révolution
allemande.5
La
réaction des travailleurs dépassa les attentes les plus optimistes.
« Des
masses
énormes, des centaines de milliers d’individus, répondirent le
dimanche 5 janvier à cet appel »
lancé par les organisateurs à montrer « que
l’esprit de Novembre (...) n’était pas encore éteint ».6
Les ouvriers, beaucoup d’entre eux armés, répondit avec
enthousiasme aux discours dynamiques de Liebknecht, de Daümig pour
les Délégués Révolutionnaires, et de Ledebour pour la direction
des Indépendants.
Les
organisateurs voulaient une protestation pacifique. Mais la foule en
colère n’était pas disposée à manifester pour ensuite rentrer à
la maison. Avec un léger encouragement (il fut dit par la suite
qu’il provenait de nervis d’extrême droite décidés à causer
un soulèvement prématuré7),
ils se précipitèrent pour saisir les locaux, ainsi qu’une édition
entière du journal social-démocrate Vorwärts
qui fut jetée à la rivière. D’autres groupes commencèrent à
occuper les gares de chemin de fer.
« La
réunion des organisateurs »,
raconta plus tard Eichhorn, « n’était
pas folle de joie à la nouvelle de l’occupation des locaux du
journal, qu’elle n’avait pas prévue ».8
La direction spartakiste s’était en fait réunie la veille, et
avait décidé à l’unanimité qu’un soulèvement devait être
évité à tout prix. Paul Levi a écrit :
il y avait une complète
unanimité.
(...) un gouvernement soutenu par le prolétariat n'aurait pas eu à
vivre plus de quatorze jours. (...) il fallait éviter tous les mots
d'ordre qui auraient eu nécessairement pour conséquence le
renversement du gouvernement de cette époque.
Nos mots d'ordre devaient être
précisés
dans le sens suivant : annulation de la révocation d'Eichhorn,
désarmement des troupes contre-révolutionnaires (...), armement du
prolétariat. Aucun de ces mots d'ordre n'impliquait le renversement
du gouvernement ; pas même celui de l'armement du prolétariat,
dans une conjoncture où ce gouvernement aussi possédait encore dans
le sein du prolétariat un parti non négligeable.9
L’attitude
de Rosa Luxemburg consistait à dire que la demande d’un
renversement du gouvernement Ebert-Scheidemann devait être
un slogan propagandiste (...)
mais non
pas l’objectif à portée de main de combats révolutionnaires.
Dans les conditions existantes, en particulier en se limitant à
Berlin, ils auraient conduit au mieux à une « Commune de
Berlin », vraisemblablement à une échelle historique plus
modeste par surcroît. Le seul objectif de combat ne pouvait être
que de repousser vigoureusement l'attaque contre-révolutionnaire.10
Dans
toute bataille, un dirigeant doit avoir la tête froide, et la
capacité de distinguer dans les fluctuations, heure par heure, de la
fortune des armes, le véritable équilibre des forces en
développement. Cela, Rosa Luxemburg et Leo Jogiches l’avaient. Ce
qu’ils n’avaient pas, c’était un parti puissant capable de
communiquer leur tactique aux travailleurs. Ils avaient à la place
un petit nombre d’individus parmi lesquels certains étaient
suffisamment connus des travailleurs pour que ceux-ci les suivissent
à l’occasion. Mais le plus connu d’entre eux, Liebknecht,
n’avait certainement pas la tête froide et claire. Il était
facilement exalté par les événements, et prêt à oublier les
décisions de la direction. Il admettait, à l’époque du débat
sur les élections à la conférence du parti, qu’il se couchait
avec une opinion et se réveillait avec une autre.
Liebknecht
avait voté à la réunion de la direction contre toute tentative de
prendre le pouvoir. Mais il admettait en privé qu’il avait des
réserves. « Notre
gouvernement est encore impossible, c'est vrai, mais un gouvernement
Ledebour appuyé sur les délégués révolutionnaires est d'ores et
déjà possible. »11
Pourtant
c’est Liebknecht qui, avec Wilhelm Pieck, représentait les
spartakistes dans les discussions cruciales avec les Indépendants et
les Délégués Révolutionnaires sur la tactique à adopter à la
suite de la manifestation du dimanche.
Les
dirigeants des Indépendants de Berlin n’étaient pas, dans
l’ensemble, des révolutionnaires. Leur conférence locale, tenue à
peine quinze jours plus tôt, avait voté contre le point de vue
révolutionnaire par 485 voix contre 185. Ils n’avaient pas encore
compris que pour faire une révolution, et commencer à construire le
socialisme, il était nécessaire de transformer la société par en
bas, à travers l’action consciente de la classe ouvrière. Ils
étaient représentatifs de la sorte de gens qu’évoquait Rosa
Luxemburg lorsqu’elle parlait de « l'erreur
de la
première phase de la révolution celle du 9 novembre, croire qu'il
suffit en somme de renverser le gouvernement capitaliste et de le
remplacer par un autre, pour faire une révolution socialiste. ».12
Le
9 novembre, ces gens avaient mis leur foi dans un gouvernement de
coalition USPD-SPD agissant pour
les travailleurs, mais au-dessus de leurs têtes. Désormais ils
ressentaient de plus en plus la pression, la colère, des masses
berlinoises. Ils pensaient qu’il leur fallait y répondre d’une
manière ou d’une autre. Ce qu’ils firent sans changer leur idée
de base, qu’ils devaient agir pour
les masses. Le 9 novembre, les masses avaient été utilisées comme
un levier pour remplacer le kaiser par Ebert et Haase. Maintenant
elles devaient être instrumentalisées pour remplacer Ebert par
Ledebour et Liebknecht. Les noms étaient différents, le mécanisme
restait le même.
Lorsque
Lénine et Trotsky dénonçaient ces gens comme
« centristes »
et « réformistes », ils voulaient habituellement dire
qu’ils mettaient les moyens parlementaires au dessus de tous les
autres. Mais cela ne signifiait pas que les réformistes excluaient a
priori tout recours à la force. Il y avait des situations dans
lesquelles la violence semblait le meilleur moyen de réformer
la structure existante de la société : en portent témoignage
la succession de coups d’Etat militaires de gauche dans le tiers
monde, où on peut parler de « réformisme » militaire
aussi bien que parlementaire.
La
seule chose que les réformistes et les centristes ne feront jamais,
c’est placer leur confiance dans l’activité autonome des
travailleurs. Les masses sont pour eux une armée qui ne doit
paraître sur la scène de l’histoire que pour les porter, eux, au
premier plan. Lorsqu’une véritable lutte se développe, ils
s’efforcent de faire rentrer l’armée, même si le résultat doit
être une défaite aux proportions immenses. Réformisme ne veut donc
pas seulement dire timidité – il comporte aussi parfois des actes
d’aventurisme suicidaire.
Ledebour
était un ancien député social-démocrate, un homme qui devait
bientôt se montrer très hostile au bolchevisme, et qui refusa
toujours de rejoindre une organisation clairement révolutionnaire.
Mais, le 5 janvier, il sentait que les pression des masses était
telle qu’un petit effort suffirait à contraindre Ebert à
transmettre le pouvoir à un gouvernement dans lequel lui, Ledebour,
serait une figure centrale, un gouvernement capable d’introduire le
socialisme « par décret ».
« On
rapporta »,
dit-il plus tard au sujet de la réunion qui fut tenue ce soir-là,
qu’en plus de la classe
ouvrière, la
garnison de Berlin était aussi entièrement de notre côté. Pas
seulement la Division de Marine, mais pratiquement tous les régiments
étaient prêts à prendre les armes et à se mettre à la tête de
la classe ouvrière de Berlin pour renverser le gouvernement
Ebert-Scheidemann. (...) Nous reçûmes de plus la nouvelle qu’à
Spandau de grandes masses étaient prêtes à se porter à notre aide
en cas de besoin, avec 2 000 mitrailleuses et 20 canons. Nous
eûmes des nouvelles semblables en provenance de Francfort sur
l’Oder.13
Dans
un élan d’enthousiasme, l’organisation berlinoise des
Indépendants constitua un « Comité Révolutionnaire
Conjoint » avec les Délégués Révolutionnaires et Liebknecht
et Pieck, qui se proclamaient les porte-parole des spartakistes. Ils
sortirent un tract qui appelait à la grève générale et à des
manifestations de masse le lendemain, concluant : « Au
combat pour le pouvoir du prolétariat révolutionnaire ! A bas
le gouvernement Ebert-Scheidemann ! ».14
Un
second tract, qui semble n’avoir jamais été distribué,
clarifiait plus encore les intentions du Comité :
le gouvernement
Ebert-Scheidemann s'est
rendu intolérable. Le comité révolutionnaire sous-signé,
représentant des ouvriers et soldats révolutionnaires (parti
social-démocrate indépendant et parti communiste), proclame sa
déposition.
Le comité révolutionnaire
soussigné
assume provisoirement les fonctions gouvernementales.
Camarades ! Travailleurs !
Serrez les rangs autour des
décisions du
comité révolutionnaire !
Signé : Liebknecht, Ledebour,
Scholze.15
Au
début, tout sembla aller au mieux pour les révolutionnaires. La
grève générale fut une réussite totale. Même l’indépendant de
droite Heinrich Ströbel dut admettre : « La
grève générale commença le 6 janvier avec force ».16
Rosa Leviné-Meyer, qui était à Berlin à l’époque, écrit :
« La
réaction
des travailleurs, y compris les membres du SPD, fut massive, et le
gouvernement était complètement impuissant »17
Une
autre énorme manifestation parada dans les rues. Les travailleurs
révolutionnaires saisirent tous les journaux bourgeois, de même que
le Vorwärts.
Les imprimeries gouvernementales avaient été envahies, de même que
les gares. Des tireurs sur la porte de Brandebourg dominaient tout le
centre de la ville. « Seuls
quelques points forts dans le quartier des ministères demeuraient
entre les mains du gouvernement ».18
Lors
d’une réunion à la Chancellerie Landsberg fit son rapport :
« Les
spartakistes ont pris l’Administration des Chemins de Fer, le
Ministère de la Guerre est juste après, et ensuite c’est notre
tour ». Terrifié
par les masses répandues dans les rues, même le « chien de
Saint-Hubert » Gustav Noske, récemment nommé ministre de la
défense, s’enfuit de Berlin intra muros pour installer son
quartier général dans la banlieue de Dahlem.
Mais
la révolution n’était pas aussi forte qu’elle en avait l’air,
ni le gouvernement aussi impuissant. Alors même que les travailleurs
révolutionnaires semblaient les maîtres de Berlin, le comité
révolutionnaire montrait sa faiblesse.
Pour
commencer, il n’était pas véritablement représentatif des trois
corps qui l’avaient constitué. Liebknecht et Pieck l’avaient
rejoint pour le compte des spartakistes. Mais la direction
spartakiste n’avait pas été consultée ; en fait, elle était
sérieusement en désaccord. Pieck devait plus tard admettre :
Le comité central du KPD ne
pouvait être
tenue informée de ces réunions, pas plus qu’il n’était
possible de lui indiquer immédiatement ce qui était décidé. Ce
n’est que dans une réunion plus tardive du comité central qu’il
apparut qu’ils étaient d’accord avec la lutte contre les mesures
prises par le gouvernement, mais pas avec l'objectif assigné à
l'action : celui d'une lutte pour le pouvoir gouvernemental.19
Selon
Radek, ce ne fut qu’une semaine plus tard que Rosa Luxemburg apprit
que Liebknecht avait signé l’appel avec Ledebour pour la
constitution du « gouvernement provisoire ».
« Rosa
ne dit rien de plus de toute la soirée. Il était clair que
Liebknecht s’était laissé emporter par l’idée d’un
gouvernement transitoire des Indépendants de gauche et avait engagé
l'affaire sans en informer le CC
[Comité Central] ».20
Selon des rumeurs qui circulèrent plus tard dans le Parti Communiste
Allemand, elle aurait dit à Liebknecht : « Mais
Karl, et notre programme ? »21
Les
combats de janvier sont connus aujourd'hui comme le
« soulèvement
spartakiste ». Mais la direction spartakiste du Parti
Communiste était opposée au projet ! Tel est le sort des
révolutionnaires qui ont la bonne politique, mais qui ne disposent
pas d’un puissant parti discipliné pour la mettre en pratique. Ils
se voient reprocher des actions dont ils n’ont pas décidé et
qu’ils n’ont pas pu contrôler.
Les
Délégués Révolutionnaires n’étaient pas plus unis derrière la
tentative de prise du pouvoir que les spartakistes. Leurs éléments
individuels les plus influents dans les usines de Berlin, Richard
Müller et Daümig, étaient nettement opposés à cette action –
ils étaient tous deux des révolutionnaires, et devaient plus tard
rejoindre le Parti Communiste.
Les
Sociaux-Démocrates Indépendants se trouvaient, par nature, déchirés
par des divisions internes, sur cette question comme sur la plupart
des autres. Ils devaient bientôt prouver qu’ils étaient les
alliés les plus dangereux et les moins dignes de confiance dans une
démarche de conquête du pouvoir.
Le
comité révolutionnaire n’était pas seulement sans
représentativité – il était aussi trop gros et incompétent pour
diriger quelque action que ce soit, pour ne pas parler d’une prise
du pouvoir. Avec ses 52 membres, c’était un parlement en
réduction, et non un exécutif capable de coordonner les mouvements
de troupes révolutionnaires et de travailleurs en armes. Au lieu
d’agir, il débattait interminablement.
L’effet
sur le moral de ceux qui combattaient dans les rues fut
catastrophique. Comme l’écrivit plus tard Paul Levi, un des
dirigeants spartakistes :
Ce que l’on vit le lundi à
Berlin fut
peut-être la plus grande action de masse prolétarienne de
l’histoire. (...) De la statue de Roland [devant
l’hôtel de ville] à celle de la Victoire [sur
la Königsplatz] les prolétaires se tenaient au coude à
coude. (...) Ils avaient amené avec eux leurs armes, ils faisaient
flotter leurs drapeaux rouges. Ils étaient prêts à tout faire, à
tout donner, même leurs vies. Il y avait là une armée de
200 000
hommes comme Ludendorff n’en avait jamais vue.
C'est alors que se produisit
l'incroyable. Les masses étaient là très tôt, depuis 9 heures,
dans le froid et le brouillard. (...) Le brouillard augmentait et les
masses attendaient toujours. Mais les chefs délibéraient. Midi
arriva et, en plus du froid, la faim. Et les chefs délibéraient.
Les masses déliraient d'excitation : elles voulaient un acte,
un mot qui apaisât leur délire. Personne ne savait quoi. Les chefs
délibéraient.
Le brouillard augmentait
encore et avec
lui le crépuscule. Tristement les masses rentraient à la maison :
elles avaient voulu quelque chose de grand et elles n'avaient rien
fait. Et les chefs délibéraient. (...) Ils siégèrent toute la
soirée, et ils siégèrent toute la nuit, et ils délibéraient. Et
ils siégeaient le lendemain matin quand le jour devenait gris, et
ceci, et cela, et ils délibéraient encore.22
Paul
Frölich, qui assista aux événements, raconte comment :
L'organe qui avait si
vaillamment
proclamé le renversement du pouvoir, se montra complètement inapte
à toute initiative dans ce but. Le Comité Révolutionnaire lança
un appel à manifester le 6 janvier, il fit distribuer quelques armes
dans le Marstall, et s’engagea dans une molle tentative
d'occupation du ministère de la guerre. Ce fut tout. Il ne se soucia
pas des soldats qui avaient occupé les journaux, ne leur donna
aucune instruction, les laissa dans des bâtiments sans aucune valeur
stratégique. La seule mesure sensée, l'occupation des gares, se fit
à l'initiative des travailleurs eux-mêmes.23
Le
Comité Révolutionnaire s’était formé sur la base d’une
évaluation excessivement favorable du sentiment des travailleurs et
des soldats à Berlin. Ils étaient prêts à manifester, à faire
grève, à arracher les galons des officiers. Mais ils n’étaient
pas prêts à prendre le pouvoir entre leurs mains.
Beaucoup
des ouvriers et des soldats que le renvoi d’Eichhorn avait mis en
rage considéraient que les sociaux-démocrates majoritaires avaient
rompu « l’unité socialiste ». Mais là, le
gouvernement pouvait présenter l’offensive de la gauche sous la
même lumière. Un tract dans lequel ses arguments étaient présentés
de façon caractéristique fut distribué le soir du 6 janvier :
Pour la deuxième fois, les
bandits armés
de la Ligue Spartakus ont saisi le Vorwärts.
Les chefs de ces bandes ont proclamé aujourd'hui ouvertement le
renversement par la force du gouvernement, le meurtre et la guerre
civile sanglante et la mise en place d'une dictature spartakiste. Le
peuple allemand et en particulier la classe ouvrière sont menacés
d'un très grave danger. L’anarchie et la famine seront le résultat
du règne des spartakistes.24
La
responsabilité des désordres fut transférée du gouvernement à la
gauche. Il y avait encore un nombre considérable de travailleurs et
de soldats prêts à accepter ces arguments. L’Exécutif berlinois
des Conseils dénonça les spartakistes – même si, à peine une
semaine plus tôt, il avait critiqué l’attaque du gouvernement
contre la Division de Marine. Le jour suivant, une manifestation de
plusieurs milliers de sociaux-démocrates autour des édifices
gouvernementaux empêcha les forces révolutionnaires d’agir à
l’intérieur. Des sections de la garnison de Berlin que le
gouvernement considérait comme « peu
sûres » –
comme le Corps des Soldats Républicains – combattirent néanmoins
pour lui.
Plus
significative, peut-être, était l’opposition de nombreux
travailleurs et soldats aux deux
côtés. Des groupes cruciaux de soldats, comme la Division de
Marine, refusèrent de soutenir l’action armée de la gauche et
proclamèrent leur neutralité. Le 9 janvier, une réunion conjointe
de travailleurs de deux des plus grandes usines, Schwarzkopf et AEG,
votèrent pour que les prolétaires s'unissent « sinon
avec vos chefs, du moins par dessus leurs têtes. ».
Ceci fut réitéré par un meeting de 40 000 travailleurs, de
ces usines ainsi que d’autres, qui appelaient à la constitution
d’un gouvernement des trois « partis ouvriers ».25
Les
dirigeants communistes étaient conscients que la masse des
travailleurs continuait à se cacher la vérité ; Müller et
Daümig, des Délégués Révolutionnaires, en étaient conscients ;
mais le Comité Révolutionnaire, de Liebknecht à Ledebour, ne
l’était pas. Ils ignorèrent la neutralité de sections clés de
travailleurs et de soldats. Ils refusèrent de voir que, malgré la
grève générale et d’énormes manifestations, le nombre des
soldats et des ouvriers prêts à combattre ne dépassait pas
quelques milliers.
Pourtant,
même lorsque la décision de combattre fut prise, tout n’était
pas perdu. L’équilibre des forces à Berlin même n’était pas
favorable au gouvernement. « Le
camp des rebelles disposait d’un avantage matériel considérable »,
selon le jugement d’un historien de l’armée allemande.26
Par une action déterminée, les forces révolutionnaires auraient pu
rapidement neutraliser les concentrations de troupes gouvernementales
dans la ville. Cela aurait mis le gouvernement sur la défensive.
Pour conserver leurs positions ministérielles, Ebert et Scheidemann
auraient très bien pu, dans ces circonstances, se résoudre à
accepter une formule qui les maintînt au pouvoir, les travailleurs
restant armés (comme après les affrontements du début et de la fin
de décembre). La gauche révolutionnaire aurait conquis des
positions à partir desquelles elle aurait pu avancer avec un soutien
ouvrier bien plus important dans un avenir peu éloigné.
Mais
le Comité Révolutionnaire ne put fournir aucune coordination. Il
permit au gouvernement de garder le contrôle de bâtiments qu’il
n’aurait pas été capable de défendre une heure face à un assaut
déterminé. A partir de ces bâtiments, il put mettre en œuvre sa
contre-attaque dans l’impunité.
Pire
encore, le Comité Révolutionnaire accumula les erreurs. Dès qu’il
fut clair que le gouvernement n’allait pas s’écrouler
immédiatement entre leurs mains, les dirigeants indépendants
demandèrent à négocier avec lui – alors qu’ils l’avaient
déclaré renversé un jour ou deux plus tôt !
Les
Jacobins français faisaient observer que « les
gens qui font des révolutions à demi ne parviennent qu'à se
creuser un tombeau »,
et Engels enfonça le clou en disant : « la
défensive est la mort de toute insurrection armée ».27
Un soulèvement ne peut réussir que si les masses sentent qu’elles
ont une chance de gagner. Elles ne sont pas des formations militaires
entraînées à maintenir leurs rangs aussi bien en retraite qu’à
l’offensive. Ce sont des hommes et des femmes qui vont tout donner
s’ils croient qu’ils vont réaliser la libération, mais qui
battront rapidement en retraite et reviendront à leurs vies normales
à l’usine, dans leur taudis et au cabaret s’ils sentent que
l’objectif a été abandonné. Un mouvement révolutionnaire qui
est sûr de la victoire oubliera tout le reste. Mais au moment où
les dirigeants admettent que l’ordre ancien va continuer en
négociant avec lui, les travailleurs de base vont commencer à se
soucier de leur emploi, de leur foyer, de l’attitude du
contremaître et du policier local. Même dans les meilleures
conditions, négocier avec l’ennemi signifie que la mobilisation
commence à reculer. C’est ce qui était en train de se passer. Une
situation qui n’était pour les révolutionnaires que mauvaise
devint exécrable.
Rosa
Luxemburg aperçut le danger. Même si elle était contre toute
tentative d’insurrection, une fois que celle-ci était en route il
n’y avait pour elle pas d’autre choix que de la pousser en avant
de la façon la plus énergique. Comme le raconta plus tard Clara
Zetkin, Rosa n’était pas partisane de prendre le pouvoir mais de
« repousser
vigoureusement les attaques contre-révolutionnaires. (...) Pour ces
revendications il fallait agir, et non négocier ».28
C’est la raison pour laquelle, dans
la
Rote Fahne
du 7 janvier, Rosa insistait sur la différence entre la combativité
des masses et l’indécision fatale des dirigeants :
Quiconque a vécu hier la
manifestation
de masse de la Siegesallee, quiconque a ressenti cette conviction
révolutionnaire solide comme le roc, cette état d'esprit
magnifique, cette énergie, qui déferlent des masses, celui-là a
senti, celui-là doit conclure que politiquement les prolétaires ont
énormément grandi grâce à l'éducation de ces dernières
semaines, des événements les plus récents. Ils sont devenus
conscients de leur puissance, et tout ce qui leur reste à faire
c’est de tirer profit de cette puissance. (...)
La masse doit apprendre
elle-même à
combattre, à agir dans la lutte. Et aujourd’hui on peut sentir que
les ouvriers de Berlin ont dans une grande mesure appris à
agir ;
ils sont avides d’actes résolus, des situations claires, de
mesures vigoureuses. (...)
Mais leurs dirigeants, les
organes
exécutifs de leur volonté, sont-ils à la hauteur ? Les
Délégués Révolutionnaires, les gens de confiance des grandes
entreprises, les éléments radicaux de l’USPD ont-ils pendant ce
temps acquis plus de force, de résolution ? Est-ce que leur
capacité d’action est allée au même rythme que l’énergie
croissante des masses ?
Nous avons bien peur de ne pas
pouvoir
répondre à ces questions par un oui catégorique. (...)
Qu’ont ils [les
dirigeants] fait ? Qu’ont-ils décidé ?
Quelles
mesures ont-ils pris pour assurer la victoire de la révolution dans
cette situation tendue, dans laquelle le sort de la révolution au
moins pour la période qui vient va être décidée ? Nous n’e
voyons, nous n'entendons rien ! Peut-être que les hommes de
confiance de la classe ouvrière délibèrent de leurs tâches de la
façon étendue et approfondie. Mais maintenant il faut agir.
Les Ebert-Scheidemann ne
perdent pas leur
temps en délibérations. (...) Ils préparent leurs intrigues en
silence avec l'énergie et la circonspection habituelles des
contre-révolutionnaires à agir avec la ruse et l’énergie dont
font preuve habituellement les contre-révolutionnaires, ils
aiguisent leur épée, pour prendre la révolution par surprise, pour
l'assassiner.(...)
Il n’y a pas de temps à
perdre. Des
mesures énergiques doivent être prises immédiatement. (...) Les
éléments indécis de la troupe ne peuvent être gagnés à la cause
sacrée du peuple que par une action vigoureuse et déterminée de la
part des corps révolutionnaires.
Agir !
Agir ! Avec courage,
avec résolution, avec constance – tel est le devoir des Délégués
Révolutionnaires et des dirigeants socialistes honnêtes. Désarmer
la contre-révolution, armer les masses, occuper toutes les positions
de pouvoir. Agir vite !29
Mais
les spartakistes n’étaient pas capables de donner au mouvement la
détermination, l’organisation et la direction dont il avait besoin
– pas plus qu’ils n’avaient été capables auparavant de le
restreindre à des mots d’ordre défensifs. Ils étaient tout
simplement trop petits pour exercer l’influence nécessaire.
Des
militants spartakistes individuels pouvaient jouer un rôle. Leviné,
par exemple, qui quelques jours plus tôt avait été envoyé par la
direction en Haute-Silésie pour arrêter une insurrection
prématurée, prenait maintenant en charge les opérations militaires
à l’intérieur et autour du bâtiment du Vorwärts.
Mais ce n’était pas du tout la même chose que d’être à même
d’imposer une organisation stratégique et tactique générale aux
forces révolutionnaires.
Le
gouvernement n’était que trop disposé à tirer profit de la
désorganisation et de l’indécision de ses adversaires.
Déjà,
le 6 janvier, Noske avait délégué ses pouvoirs de police au
général Lüttwitz en prévision de l’utilisation des Freikorps en
provenance de l’extérieur de Berlin. Mais la désorganisation des
révolutionnaires permit la création d’une force
pro-gouvernementale au cœur même de Berlin. Le 8 janvier, deux
régiments de soldats sociaux-démocrates avaient été organisés
dans le bâtiment du Reichstag. Leurs effectifs, d’environ
5 000
hommes, étaient inférieurs aux forces révolutionnaires, qui
auraient pu facilement les disperser. Mais il n’y avait, dans le
camp révolutionnaire, aucun commandement général qui aurait permis
cela. Au lieu de cela, en s’engageant dans des négociations, les
Indépendants donnèrent au gouvernement le temps de regrouper ses
forces jusqu’à ce qu’il se sentît assez fort pour les jeter
dans la bataille destinée à briser les révolutionnaires.
La
détermination des chefs des forces gouvernementales leur permit de
déloger très rapidement les révolutionnaires de leurs positions.
Le commandant des Corps de Soldats Républicains pro-gouvernementaux
raconte que dès le 13 janvier
J’étais en situation de dire à
Noske
qu’il n’y avait plus rien à faire, à part maintenir l’ordre
qui avait été rétabli et poursuivre les opérations de
désarmement. Les troupes berlinoises des Corps de Soldats
Républicains et les volontaires (les soldats sociaux-démocrates),
sous les ordres de Kuttner et de Baumeister, qui ont pris la Porte de
Brandebourg et défendu le Reichstag, ont restauré l’ordre à
Berlin.30
Mais
cet ordre n’était pas suffisant pour les dirigeants
sociaux-démocrates, en particulier Ebert et Noske, dans la mesure où
il dépendait d’ouvriers et de soldats sociaux-démocrates armés.
Ils préféraient contrôler Berlin à l’aide de troupes plus
« sûres » – les milliers de monarchistes des
Freikorps
qui s’assemblaient en dehors de la capitale pendant que la
rébellion y était matée. Ils commencèrent à marcher dans Berlin
le 11 janvier, mais la force principale n’y entra que 36 heures
plus tard.
Lorsqu’ils entrèrent dans la
ville,
ils n’avaient rien de mieux à faire qu’arracher les brassards
des membres du Corps de Soldats Républicains et les insulter à tout
propos.31
Cela
semble légèrement exagéré : il y avait encore des tireurs de
gauche dans un certain nombre de bâtiments. Les Freikorps les
liquidèrent bientôt, installant des mitrailleuses et des véhicules
blindés sur les principales places publiques. Toute résistance
était brisée de la façon la plus brutale. Lorsqu’une délégation
de sept personnes fut envoyée pour discuter de la reddition
pacifique du bâtiment du Vorwärts,
elle fut massacrée. L’artillerie fut utilisée pour détruire la
façade du quartier général de la police avant que les hommes
d’Eichhorn ne cessent toute résistance. « Il
n’y eut pas de quartier, les défenseurs étaient abattus sur
place. Seule une poignée réussit à s’échapper par les toits ».32
Les locaux de la direction du Parti Communiste furent pris d’assaut
et détruits.
L’ancienne
police du temps de la monarchie fut rappelée et se vit confier la
tâche d’aider les Freikorps à faire la chasse aux
« spartakistes ».
La presse quotidienne ne tarissait pas d’éloges pour les Freikorps
qui avaient « délivré
Berlin » de
« l’anarchie
et
de la dictature ».
La presse accompagnait le
massacre de la
soldatesque dans les quartiers ouvriers avec des hymnes aux
« libérateurs ».
Elle
chantait les murs éclaboussés de la cervelle des exécutés selon
la loi martiale. Elle changeait toutes la classe moyenne en
populace assoiffée de sang, prise de la fièvre de la dénonciation,
qui poussait les suspects – révolutionnaires, ou complétement
inoffensifs - devant les fusils des pelotons d’exécution.33
« L’effusion
de sang fut
naturellement attribuée aux spartakistes, et une chasse sauvage
contre leurs dirigeants emplir la ville », raconte
Rosa
Leviné-Meyer. « A l'hôpital aussi on pouvait sentir
l’excitation générale. Les infirmières couraient dans tous les
sens comme un troupeau de brebis affolées, racontant d’affreuses
histoires sur les spartakistes sanguinaires... ».34
Le
journal social-démocrate Vorwärts
encouragea tant qu’il put l’hystérie meurtrière, appelant
ouvertement à l’assassinat des dirigeants spartakistes :
Des centaines de cadavres en
rangs
Prolétaires.
Karl, Rosa, Radek et compagnie
Aucun d’eux n’est couché là –
Prolétaires.35
La
terreur blanche atteignit son apogée deux jours plus tard. Rosa
Luxemburg et Karl Liebknecht avaient refusé de fuir la ville – en
fait, même si elle se cachait, Rosa continuait à diriger la Rote
Fahne. Le 15 janvier,
ils furent arrêtés dans leur cachette, avec Wilhelm Pieck, et
traînés séparément au quartier général des Freikorps de l’Hôtel
Eden. Là, un certain capitaine Pabst avait déjà fait des
préparatifs pour leur assassinat. Après avoir été interrogé,
Liebknecht fut emmené hors du bâtiment, à moitié assommé à
coups de crosse et traîné au Tiergarten où il fut tué. Rosa fut
emmenée peu de temps après, eut le crâne fracassé et fut aussi
emportée, abattue d’une balle dans la tête et jetée dans le
canal.
Le jeudi 16 janvier, le Vorwärts
put annoncer avant tous les autres journaux que Liebknecht avait été
abattu alors qu’il tentait de s’échapper et Rosa Luxemburg tuée
par la foule.36
La
nouvelle causa une joie immense dans la classe moyenne. Dans
l’hôpital de Rosa Leviné-Meyer, « l’édition
spéciale passait de main en main ; tout le monde hurlait et
dansait de joie ».37
La
Révolution Allemande était loin d’être terminée. De nombreuses
et âpres batailles étaient encore à venir. Même à Berlin, il y
aurait à nouveau des combats dans les deux mois, et il devait
s’écouler cinq années entières avant que le capitalisme allemand
ne soit complètement stabilisé. Mais son succès de janvier donna à
la bourgeoisie une victoire importante, sur laquelle elle pouvait
construire.
Elle
avait émergé de la Révolution de Novembre avec un appareil d’Etat
en miettes. Elle avait perdu son monopole de la force armée :
l’armée était déchirée entre la pression de la base et les
ordres des généraux. A l’époque des combats de janvier, les
généraux avaient sous leur contrôle immédiat au maximum 10 000
hommes – même pas assez pour tenir une ville, sans même parler
d’un Etat moderne. Leur victoire leur rendit le monopole de la
force armée et la possibilité d’étoffer les unités sûres très
rapidement.
De
plus, l’assassinat de Rosa Luxemburg avait privé les
révolutionnaires de leur dirigeante la plus capable et la plus
expérimentée. Ses successeurs étaient compétents et courageux –
mais ils manquaient de pratique et n’avaient pas sa capacité à
dépasser des impressions immédiates pour comprendre une situation
dans sa totalité. La classe ouvrière allemande devait payer un prix
énorme pour cette perte. Le meilleur résumé de ce que le
gouvernement avait réussi à faire fut établi quelques mois plus
tard par le chef de la police révolutionnaire révoqué,
Eichhorn :
Le prolétariat de Berlin fut
sacrifié à
la provocation, dont les buts étaient larges, et qui avait été
soigneusement calculée, du gouvernement du jour. Le gouvernement
cherchait l’occasion de porter un coup mortel à la
révolution :
le mouvement de janvier la lui offrit.
Le prolétariat révolutionnaire
était
sans doute armé et mobilisé, mais il n’était aucunement prêt à
des combats sérieux ; il tomba dans le piège des négociations
et s'y laissa perdre en force, en temps et en élan révolutionnaire.
Pendant ce temps, le gouvernement, ayant à sa disposition toutes les
ressources de l’Etat, pouvait préparer la défaite complète.38
Les leçons de janvier
Dans
le dernier article qu’écrivit Rosa Luxemburg avant d’être
assassinée, elle mettait la défaite sur le compte de « la
contradiction entre la manifestation vigoureuse, résolue, offensive
des masses berlinoises et l’irrésolution, les hésitations, les
atermoiements de la direction
(…) ».39
Il
n’est pas douteux qu’elle avait raison. Avec un puissant parti
révolutionnaire, la classe ouvrière berlinoise ne serait
probablement pas tombée dans le piège que lui tendaient Ebert,
Noske et les généraux. Avec un puissant parti révolutionnaire, il
y aurait eu la direction globale nécessaire pour coordonner les
forces révolutionnaires si une insurrection s’était déclenchée
contre son gré.
Mais
il n’y avait pas un tel parti. Et son inexistence était le produit
de l’histoire des années précédentes : la croissance et la
stabilité du capitalisme allemand d’avant-guerre ; l’échec
personnel de Rosa Luxemburg à donner à cette époque une forme
organisationnelle pratique à son opposition de principe à la
politique de Kautsky et de la direction du SPD ; la friction
entre les spartakistes et les révolutionnaires de Brême en
1916 ;
la prédominance d’éléments gauchistes impatients dans le Parti
Communiste lorsqu’il fut finalement formé, à peine une semaine
avant le début des combats.
Bien
sûr, il y avait des différences d’ordre objectif entre
l’Allemagne du début de 1919 et la Russie de 1917. Mais là n’est
pas l’explication décisive de la défaite de janvier : en
Russie en 1917, il y eut souvent des situations dans lesquelles les
travailleurs de certains centres industriels voulaient aller à la
bataille sans préparation et isolément des autres travailleurs.
Luxemburg était tout aussi capable que Lénine et Trotsky de voir
les dangers d’une telle action prématurée. Ce qui manquait,
c’était le genre de parti que Lénine avait construit pendant les
vingt années précédentes. Et sans ce parti, les idées de Rosa
étaient réduites au niveau d’un commentaire sur les événements
révolutionnaires, au lieu de pouvoir leur imprimer une orientation.
Mais
cela ne signifie pas nécessairement que les spartakistes n’avaient
aucun moyen d’agir pour éviter les aspects les plus dommageables
de la défaite.
Le
débat sur la tactique des spartakistes commença alors même que les
événements étaient en cours. Et il commença, au sein de la
direction du Parti Communiste récemment créé, sous la forme d’un
désaccord entre Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht.
La
position de Rosa était formulée dans ses derniers articles – Que
font les dirigeants ?,
Châteaux
de cartes,
et L’ordre
règne à
Berlin40
– et dans un exposé de ses vues fourni plus tard par sa camarade
et amie Clara Zetkin. Le point central, pour elle, était que « la
révolution est en marche, pas à pas, à travers tous ces mouvements
qui semblent autant de zig-zags, et elle marche en avant de manière
irrésistible. La masse doit apprendre elle-même à combattre, à
agir, dans la lutte ».
L’action
devait distinguer aux yeux des masses ceux qui étaient
révolutionnaires de ceux qui ne l’étaient pas. « Agir !
Agir ! Avec courage, avec résolution, avec constance – tel
est le devoir des délégués révolutionnaires et des dirigeants
socialistes honnêtes »,
écrivait-elle.41
Pouvait-on s’attendre, dans le
présent
affrontement, à une victoire décisive du prolétariat
révolutionnaire, pouvait-on escompter la chute des Ebert-Scheidemann
et l’instauration de la dictature socialiste ? Certainement
pas, si l’on fait entrer en ligne de compte tous les éléments qui
décident de la réponse. (...)
La lutte de la semaine écoulée
constituait-elle (...) une « faute’ » ? Oui,
s’il
s’agissait d’un « coup de boutoir’ » délibéré,
de ce qu’on appelle un « putsch’. Mais quel a été le
point de départ des combats ? . (...) Une provocation brutale
du gouvernement ! …
(...) la révolution n’agit pas
à sa
guise, elle n’opère pas en rase campagne, selon un plan bien mis
au point par d’habiles « stratèges ». Ses adversaires
aussi font preuve d’initiative, et même en règle générale bien
plus que la révolution.
Placés devant la provocation
violente
des Ebert-Scheidemann, les ouvriers révolutionnaires étaient
contraints de prendre les armes. Pour la révolution, c’était une
question d’honneur que de repousser l’attaque immédiatement, de
toute son énergie, si l’on ne voulait pas que la contre-révolution
se crût encouragée à un nouveau pas en avant (…)
Or il existe pour la
révolution une
règle absolue : ne jamais s’arrêter une fois le premier pas
accompli, ne jamais tomber dans l’inaction, la passivité. La
meilleure parade, c’est de porter à l’adversaire un coup
énergique. Cette règle élémentaire qui s’applique à tout
combat vaut surtout pour les premiers pas de la révolution (…)
De cette contradiction entre
la tâche
qui s’impose et l’absence, à l’étape actuelle de la
révolution, des conditions préalables permettant de la résoudre,
il résulte que les luttes se terminent par une défaite formelle.
Mais la révolution est la seule forme de « guerre » –
c’est encore une des lois de son développement – où la victoire
finale ne saurait être obtenue que par une série de
« défaites ».42
Pour
Rosa, le combat était inévitable. Une fois qu’il avait commencé,
les spartakistes devaient gagner la confiance des masses, les
soustraire à l’influence des indécis et des opportunistes parmi
les sociaux-démocrates indépendants, en se montrant les meilleurs
combattants, les plus courageux et les mieux dirigés. Cela
permettrait peut-être de repousser l’attaque du gouvernement. Dans
le pire des cas, il y aurait une défaite – mais ce ne serait
qu’une défaite partielle. Elle renforcerait le soutien des
révolutionnaires dans la classe ouvrière, et elle conserverait à
la classe la force de lutter une autre fois.
Les ruines et les cadavres de
ce dernier
épisode seront à peine déblayés que la révolution reprendra son
inlassable travail quotidien. Les « spartakistes »
continuent d’aller de l’avant avec une fermeté inébranlable. Le
nombre de leurs camarades tombés augmente chaque semaine, mais le
nombre de leurs partisans grandit cent fois plus vite.43
Clara
Zetkin expliquait ainsi l’attitude de Rosa :
Le jeune Parti Communiste
était donc
confronté à une tâche très difficile, comportant de nombreux
conflits. Il ne pouvait faire sien l’objet de l'action de masse –
le renversement du gouvernement, il devait le refuser. Mais en même
temps il ne pouvait se laisser séparer des masses qui avaient engagé
le combat. Malgré la contradiction, il devait rester avec les
masses, au milieu des masses, pour les renforcer dans leur lutte avec
la contre-révolution, et stimuler le processus de leur maturation
révolutionnaire pendant l'action, en leur donnant conscience des
conditions de leur action. Dans ce but, le Parti Communiste devait
montrer son propre visage, élaborer de façon claire et tranchée
son évaluation de la situation, sans nuire à la solidarité
prolétarienne, révolutionnaire qu'elle devait apporter aux
combattants. Son rôle dans l’action devait être en même temps
négatif et critique d’un côté, positif et encourageant de
l’autre.44
Les
articles écrits par Rosa Luxemburg au cours de ces journées ne
trahissent aucun de ses mauvais pressentiments concernant les combats
de rues. Le sens de ses articles était d’inciter les masses à
aller de l’avant et non de les retenir. Le côté « négatif
et critique » résidait dans sa sévérité à l’égard des
défaillances des dirigeants, les Indépendants de gauche et les
Délégués Révolutionnaires. Radek disait que le ton de la
Rote Fahne était un
ton « de lutte
finale ».45
Radek
lui-même avait une approche nettement différente de celle de Rosa.
Il partait de la même évaluation du rapport des forces – les
travailleurs ne pouvaient pas prendre le pouvoir. Mais il traduisait
cette appréciation en un ensemble de tactiques complètement
différent. Il pensait que le parti devait dire aux masses, tout
crûment, de cesser le combat. Au troisième jour de la lutte, il
adressa la lettre suivante à la Zentrale
(le comité de direction de neuf membres) de
Spartakus :
Dans le programme de votre
parti Que
veut la Ligue Spartakiste ?, vous
déclarez que vous
ne voulez pas prendre le pouvoir avant d'avoir les masses derrière
vous. Ce point de vue absolument correct est basé sur le fait que le
gouvernement ouvrier est inconcevable sans qu’existe une
organisation de masse du prolétariat. Mais à l’heure présente,
les seules organisations de masse existantes, les conseils d’ouvriers
et de soldats, n’ont qu’une force toute nominale. Ils n'ont pas
encore mené de combat susceptibles de déchaîner des forces de
masses. Et par conséquent, le parti du combat, le Parti Communiste,
n'y a pas le dessus, mais les social-patriotes et les Indépendants.
Dans cette situation, il ne saurait être question de songer à une
prise du pouvoir par le prolétariat. Si le gouvernement tombait
entre vos mains à la suite d’un putsch, il serait étranglé et
asphyxié par la province en quelques jours.
Dans cette
situation, l’action
de
samedi décidée par les délégués révolutionnaires en réponse à
l’attaque du gouvernement social-patriote contre le chef de la
police aurait dû avoir simplement le caractère d’une action de
protestation. L’avant-garde prolétarienne, exaspérée par la
politique du gouvernement, et mal dirigée par les délégués
révolutionnaires dont l’inexpérience politique les a rendus
incapables d’apprécier le rapport de forces dans tout le pays, ont
dans leur enthousiasme transformé le mouvement de protestation en
une lutte pour le pouvoir. C’est cela qui permet à Ebert et
Scheidemann de porter au mouvement berlinois un coup qui peut
affaiblir pour des mois le mouvement dans son ensemble.
La seule force
modératrice qui
soit
capable de prévenir ce désastre, c’est vous, le Parti Communiste.
Vous avez assez d'intelligence pour savoir que la bataille est sans
espoir. Vous le savez, vos camarades Levi et Duncker me l’ont dit.
(...) Rien n'interdit au plus faible de battre en retraite face à la
force supérieure. En juillet 1917, alors que nous étions plus forts
que vous ne l’êtes aujourd’hui, nous avons retenu les masses de
toutes nos forces, et lorsque nous n’y sommes pas parvenus nous
leur avons évité par une intervention déterminée une bataille
sans espoir.46
Radek
appelait les dirigeants spartakistes à demander à leurs partisans
d’abandonner le combat. Ses arguments étaient défendus, au sein
de la direction, par Paul Levi et Leo Jogiches. Mais même si Rosa
Luxemburg avait dit (d’après Levi) qu’il n’était plus
possible de travailler avec Liebknecht après son appel à la lutte
pour le pouvoir, elle n’était pas prête à donner l’ordre de la
retraite. Elle savait que les Indépendants négociaient pour une
retraite de leur cru, et ne voulaient pas que les spartakistes leur
fournissent une excuse. Elle pensait que c’était seulement en
restant ferme, pendant que les Indépendants dirigeaient la retraite,
que la nécessaire polarisation pouvait se produire dans les masses,
les meilleurs éléments se trouvant alors attirés vers le Parti
Communiste. Le danger de la formulation de Radek, c’était que,
selon elle, les spartakistes devaient courir se mettre à l’abri
pendant que les plus combatifs des ouvriers et des soldats
continuaient à lutter seuls. Cela n’aurait fait que renforcer les
attitudes anti-parti gauchistes et anarchisantes, plutôt que
contribuer à construire le parti.
Janvier 1919 et juillet
1917
Radek
comparait les combats de janvier avec les journées de Juillet en
Russie en 1917. Il y avait des similitudes. A Petrograd en juillet
1917, comme à Berlin en janvier 1919, les ouvriers et les soldats se
sentaient très forts ; le gouvernement mit en scène une
provocation (ordonnant au régiment des mitrailleurs de partir pour
le front), et les travailleurs réagirent en pressant pour une prise
du pouvoir. Et de la même manière que Liebknecht et Pieck
s’associèrent à l’appel à l’insurrection en janvier 1919, au
mépris de la discipline du parti, en juillet 1917 « Les
dirigeants de l’organisation militaire bolchevik aidèrent à
attiser les flammes de la révolte. (...) : « Les
soldats I M Golovine, K Kazakov, K N Romanov et L Linsky (tous
membres du collectif de l’organisation militaire bolchevik)
s’exprimèrent en faveur d’un coup d’Etat immédiat » ».47
Le journal militaire des Bolcheviks, la Soldatskaïa
Pravda, appela
ouvertement les travailleurs à « déloger
la bourgeoisie du pouvoir ».48
Mais
Lénine s’en tint fermement à l’opinion que le mouvement était
prématuré et extrêmement dangereux :
Nous devons être
prudents et
spécialement attentifs à ne pas être attirés dans une
provocation. (...) un faux mouvement de notre part peut tout
compromettre. (...) Si nous étions capables aujourd’hui de prendre
le pouvoir. (...) nous ne serions pas capables de le garder.49
L’attitude
des dirigeants bolcheviks fut clairement exprimée dans un discours
prononcé par Tomsky lorsque la conférence du parti de Petrograd
entendit parler de mouvements opérés par le régiment des
mitrailleurs : « Les
régiments qui se sont mis en mouvement »,
déclara-t-il, « n’ont
pas agi en bonne camaraderie, n’ayant pas invité le comité de
notre parti à discuter la question. (...) On ne peut parler en ce
moment d’une manifestation sans désirer une nouvelle
révolution ».50
Les
dirigeants bolcheviks ne furent pas capables de retenir les masses.
Les manifestations eurent lieu malgré eux. Auraient-ils dû
simplement ordonner à leurs membres de ne pas participer aux
manifestations ? Agir ainsi eût été fatal. Cela aurait semé
la confusion et la démoralisation parmi de nombreux travailleurs qui
venaient juste de rompre avec les mencheviks, et qui identifiaient
l’activisme révolutionnaire avec la participations aux
manifestations. Ils n’auraient pas dans l’avenir considéré les
bolcheviks comme leur parti si Lénine leur avait donné l’ordre de
se retirer de la bataille et d’abandonner les masses.
Les
membres du parti devaient être avec les masses dans les rues,
lançant des slogans susceptibles de cimenter les masses et
d’exprimer leur esprit combatif, en évitant tout ce qui aurait pu
être interprété comme un appel à prendre le pouvoir. Comme
Kamenev, au nom des bolcheviks, le disait à la section des
travailleurs du soviet de Petrograd à l’apogée des
manifestations :
Nous n’avons pas
appelé à une
manifestation. (...) mais les masses populaires sont elles-mêmes
descendues dans la rue . (...) Et du moment que les masses sont
sorties, notre place est au milieu elles. (...) Notre tâche,
maintenant, est de donner au mouvement un caractère organisé.51
Lénine
expliquait avec insistance que le parti ne pouvait pas simplement
laisser les masses se battre toutes seules :
Si notre parti
s'était refusé
à
soutenir le mouvement spontané des masses les 3 et 4 juillet,
mouvement qui se produisit malgré les efforts que nous avions faits
pour le contenir, cela eût été trahir manifestement et
complètement le prolétariat, car le mouvement des masses naissait
de l'indignation juste et légitime52
Il
écrivit deux ans après les événements :
Lorsque les masses
luttent,
les erreurs
sont inévitables : les communistes, tout en voyant ces
erreurs,
en les expliquant aux masses, en cherchant à les rectifier, en
luttant sans relâche pour la victoire de la conscience sur la
spontanéité, restent
avec les
masses.53
Dans
la pratique, lorsque les bolcheviks virent que toute tentative
d’argumenter contre une action des travailleurs était vouée à
l’échec, appelèrent eux-mêmes à des manifestations armées,
mais des « manifestations pacifiques et organisées ».
Trotsky raconte comment
Sous les murs du
palais de
Tauride,
pendant les Journées de Juillet, Zinoviev fut extrêmement actif,
inventif et fort. Il poussait aux plus hautes notes l’excitation
des masses – non point pour les appeler à des actes décisifs,
mais, au contraire, pour les en empêcher.54
Après
trois jours de manifestations, l’enthousiasme des masses
s’épuisait. C’est à ce stade que les bolcheviks purent appeler
les masses à se retirer, sachant qu’une quantité d’individus
bien plus élevée que leurs propres effectifs obéirait à l’appel.
Ils pouvaient avoir une audience parce qu’ils avaient partagé
eux-mêmes tous les dangers de la lutte au cours des journées
précédentes, alors que les mencheviks ne l’avaient pas fait.
Il
est possible, à cette lumière, de voir plus clairement l’erreur
commise par les spartakistes en janvier 1919. Elle n’est pas qu’ils
aient pris part au mouvement – ils étaient bien plus faibles que
les bolcheviks pendant les journées de Juillet, et les bolcheviks
n’avaient pas été capables de s’en tenir à l’écart. Ce
n’était pas non plus qu’ils n’aient pas appelé à la retraite
– les bolcheviks n’avaient pu le faire que lorsqu’ils sentirent
que les masses suivraient, et la faiblesse des spartakistes les
rendait moins capables de le faire.
La
véritable erreur des dirigeants spartakistes fut de ne pas dire de
façon suffisamment claire – dans leur journal et dans leurs
discours – qu’ils considéraient le mouvement comme ayant des
objectifs strictement limités.
On
ne peut pas dire qu’alors que Liebknecht se répandait en
déclarations enflammées et prononçait des discours exaltés, Rosa
Luxemburg se fût exprimée en termes mesurés, mettant publiquement
en garde les travailleurs révolutionnaires contre le danger d’une
action trop hâtive. En réalité, les articles de Rosa Luxemburg
dans Die
rote Fahne
avaient un ton très ardent. Comme Radek lui en faisait le reproche,
elle insista sur le fait qu’elle devait être au diapason des
masses : « Lorsqu’un
enfant sain vient au monde, il hurle et ne couine pas ».55
Cela
signifie que les masses n’avaient aucun moyen de prendre
connaissance de l’évaluation réaliste du mouvement que faisait
Rosa. Elle lança l’appel au renversement du gouvernement comme un
« slogan
propagandiste »,
destiné à éduquer les masses et non à les inviter à l’action
directe ; mais le ton sur lequel elle le lança doit avoir
donné
une impression très différente aux travailleurs nouveaux à la
lutte et inexpérimentés.
C’est
là que réside la vraie différence avec Lénine en 1917. Il
expliquait avec insistance qu’il ne fallait pas lancer un slogan
s’il y avait un danger que les travailleurs ne comprennent pas ce
qu’il était possible de réaliser immédiatement :
Le mot
d'ordre :
« A bas le
Gouvernement provisoire ! » n'est pas juste en ce
moment
car tant qu'au sein du peuple une majorité solide (c'est-à-dire
consciente et organisée) ne se sera pas ralliée au prolétariat
révolutionnaire, un tel mot d'ordre n'est qu'une phrase en l'air, ou
bien conduit objectivement à s'engager dans une voie d'aventures.56
Une
telle erreur, de la part d’une grande marxiste et d’une grande
révolutionnaire comme Rosa Luxemburg, ne peut être expliquée en
disant qu’elle avait un « tempérament différent » de
celui de Lénine. Son vrai problème, c’est qu’elle craignait
d’être trop dure dans sa critique des actes de groupes de
travailleurs récemment radicalisés, parce c’était à partir de
ces groupes qu’elle essayait de construire le parti. Lénine, lui,
avait déjà construit un parti. Ses militants jouissaient déjà
d’un tel respect dans la classe qu’ils pouvaient se permettre une
impopularité temporaire parmi les travailleurs nouveaux à la lutte
– à condition qu’ils participent aux actions de masse à leurs
côtés.
Quiconque
se retrouve, comme Rosa Luxemburg, en train d’essayer de construire
un parti révolutionnaire, à partir de rien ou presque, dans le
cours même de la révolution ne peut manquer d’être confronté à
d’extrêmes difficultés. Cela est montré par le fait que ceux qui
étaient les plus critiques envers l’attitude de Rosa en janvier –
Paul Levi et Karl Radek – étaient en désaccord, après la mort de
Rosa, sur la façon dont les communistes devaient intervenir dans un
certain nombre de luttes majeures : Levi critiquait les
communistes bavarois et hongrois pour avoir « prématurément »
pris le pouvoir, alors que Radek les défendait ; Radek
encouragea « l’action de mars » de 1921 – aventuriste
s’il en fut.57
Rosa
Luxemburg fit une erreur tactique dans la première semaine de
janvier 1919 en adoptant dans ses écrits un ton trop vif, trop
brûlant. Pourtant son appréciation générale de la situation était
correcte. Son erreur tactique ne trouve pas son explication dans un
événement quelconque de décembre ou de janvier, mais dans quelque
chose de bien plus ancien – le fait d’avoir, en 1912 et en 1916,
sous-estimé l’importance de la construction d’un parti
socialiste révolutionnaire indépendant. Elle avait écrit en mars
1917 :
La Ligue Spartakus
n’est
qu’une
tendance historique de plus dans l’ensemble du mouvement du
prolétariat allemand. Elle se caractérise par une attitude
différente sur toutes les questions de tactique et d’organisation.
Mais penser qu’il est donc nécessaire de former deux partis
soigneusement distincts, correspondant à ces deux aspects de
l’opposition socialiste [les Indépendants et les Spartakistes]
repose sur une interprétation purement dogmatique de la fonction des
partis.58
Le
contraste avec l’insistance de Lénine sur l’indépendance
politique et
organisationnelle des révolutionnaires à l’égard des
« centristes » ne pouvait être plus saisissant, et
contribua à préparer le terrain aux difficultés tragiques que Rosa
Luxemburg et la Révolution Allemande devaient connaître en janvier
1919.