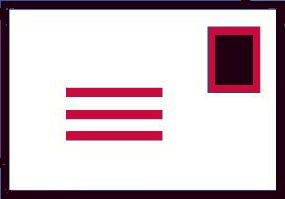L’histoire
de la Révolution Allemande jusqu’en 1920 est une histoire de
luttes plus ou moins spontanées, que des socialistes
révolutionnaires individuels pouvaient influencer, mais que personne
ne pouvait diriger. A l’inverse, après 1920 c’est en grande
partie l’histoire d’un seul parti, le Parti Communiste (KPD).
Au
début de l’année le KPD était pitoyablement petit. Il n’était
une force de masse qu’à Chemnitz. Dans beaucoup des villes les
plus importantes, le parti était complètement absent. L’initiative
montrée par ses membres hors de Berlin pendant les journées de Kapp
avait un peu amélioré les choses. Les effectifs s’étaient
accrus, et le parti commençait à s'enraciner dans la plupart des
régions. Mais avec ses 78 715 membres revendiqués il était
encore plus petit qu’il ne l’était avant la scission avec
l’ultra-gauche. Il avait 9 200 membres en Rhénanie,
17 500
en Allemagne moyenne, 4 200 dans le Wurtemberg (Stuttgart) –
mais seulement 1 700 à Berlin et 1.850 en Thuringe.
Il
ne pouvait pas non plus se vanter d’une grande influence en de hors
de ses propres rangs, si l’on se fie à sa presse. Son quotidien se
vendait à 58 000 exemplaires, avec 17 000 exemplaires
d’hebdomadaires locaux – soit une vente combinée de moins d’un
exemplaire par adhérent.1
Pendant
l’année 1919 et au début de 1920 le parti avait dû fonctionner
illégalement, à part les trois semaines de décembre où il n’y
avait pas eu d’état d’urgence à Berlin. Mais l’illégalité
ne pouvait plus expliquer sa petite taille, dans la mesure où il
avait pu à nouveau travailler ouvertement après les journées de
Kapp, et ses dirigeants affirmaient qu’il avait tenu 3 000
réunions publiques pendant la campagne électorale de juin 1920. Les
suffrages qu’il obtenait, comme ses effectifs, étaient piteux pour
un parti révolutionnaire après 18 mois de grèves de masse et de
soulèvements locaux – à peine 500 000, avec un pourcentage
inférieur à celui de l’extrême gauche française dans
l’atmosphère calme de mars 1978.
Son influence sur les syndicats semble avoir été virtuellement
nulle.
Les
communistes dissidents, qui avaient quitté le parti, faisaient
encore moins bien. A l’époque de la scission les dirigeants de
l’opposition à la direction du parti étaient les communistes de
Hambourg Laufenberg et Wolffheim. Leurs critiques de la direction
furent largement soutenues par ceux que le KPD considérait comme
« putschistes » et « impatients »,
n’ayant
aucune envie d’attendre la révolution jusqu’à ce que les
travailleurs soient prêts. Ces éléments impatients, mais
instinctivement révolutionnaires, furent renforcés dans leur
conviction que leurs critiques étaient correctes par les évènements
des journées de Kapp. Ils voyaient une connexion entre l’abstention
des dirigeants du KPD de la lutte dans les premiers jours et leur
discours ultérieur sur le « gouvernement ouvrier » et
leur insistance à continuer la lutte dans la Ruhr quand tout le
reste de l’Allemagne avait repris le travail.
C’est
dans cette atmosphère que les divers groupes locaux exclus du KPD se
réunirent pour une conférence en avril 1920 et formèrent le Parti
Communiste des Travailleurs (KAPD), se réclamant d’un effectif de
38 000 membres. Le KAPD a pu être à l’occasion présenté
comme la première opposition « anti-Moscou » ayant
rompu
avec le communisme « orthodoxe ». Ce n’était pas le
cas. L’Internationale Communiste, proclamée six mois avant la
scission et n’ayant alors virtuellement ni structure ni appareil,
s’était opposée à l’expulsion des « gauchistes »
du parti allemand. Et le congrès de fondation du KAPD se déclara
partisan de la « dictature du prolétariat » et
demanda à
rejoindre l’Internationale – une demande dont les bolcheviks
russes pensaient qu’elle devait être acceptée.
Il
n’est pas non plus entièrement correct de décrire le KAPD comme
« gauchiste ». Il est certain que tous ses membres
partageaient une opposition « de gauche » au travail
dans
les syndicats et à la participation aux élections parlementaires.
Mais sur la plupart des autres questions il y avait plusieurs
courants d’opinion distincts et contradictoires – dont beaucoup
étaient basés, il faut le dire, sur un manque de confiance
« droitier » envers la révolution.
Laufenberg
et Wolffheim avaient, en rompant avec le KPD à l’automne de 1919,
développé une théorie qui éloignait
de la lutte des classes militante. Ils déclarèrent que l’Allemagne
était une « nation prolétarienne » et qu’il était
nécessaire de mener une « guerre de libération
nationale »
contre les Alliés ; si le prolétariat menait cette lutte, la
bourgeoisie accepterait une « trêve de classe ». Leur
slogan devint : « guerre de libération nationale et
non
guerre de classe ». La vieille notion de révolution passant
par une insurrection pouvait être abandonnée : la révolution
pouvait être menée à bien plus ou moins pacifiquement dans les
usines par l’organisation de syndicats industriels alternatifs.
Déjà, au congrès du KPD où la scission se produisit, Wolffheim
déclarait que le parti n’était pas destiné à diriger une lutte
pour le pouvoir, mais que « le parti ne peut rien être d’autre
qu’un organe de propagande pour la révolution et pour les
conseils ».2
Le
second courant principal dans le KAPD reçut sa direction théorique
de deux communistes hollandais, Pannekoek et Gorter. Le point de
départ de Pannekoek, à nouveau, n’était pas
« gauchiste »,
tant il était convaincu, ce qui est plutôt
« droitier »,
que l’heure de la révolution n’était pas encore venue en Europe
de l’Ouest. Ceci, disait-il, à cause de la domination suffocante
des idées bourgeoises sur la classe ouvrière. Le long et lent
processus de construction d’organisations prolétariennes pures –
des conseils révolutionnaires – dans lesquelles les travailleurs
seraient libérés du carcan idéologique de la bureaucratie et des
influences parlementaires était encore à l’état de projet.3
Il
était implicite que pour l’instant ces conseils ne comprendraient
qu’une minorité de travailleurs. Le rôle du parti était de
contribuer à construire ces conseils, puis de « se
suicider ».
Pour ces « communistes des conseils », comme pour
Laufenberg et Wolffheim, le parti n’avait qu’un rôle limité,
exclusivement propagandiste.
Une
troisième tendance était représentée par un ancien député du
SPD, Otto Rühle, qui rejetait la dictature du prolétariat et se
rapprochait rapidement d’une position anarchiste, ce qui amena son
exclusion du KAPD en novembre 1920.
Il
est presque certain que la majorité des membres du parti ne
suivaient aucune de ces idées. Ce qui les liait au KAPD était un
zèle révolutionnaire impatient, une croyance que l’action était
plus importante que la théorie. De manière différente, Pannekoek
et Laufenberg rejetaient tous deux la lutte armée en tant que
perspective immédiate. Mais leurs partisans étaient souvent parmi
les plus intrépides dans les combats de rue.
Etant
donné ces divergences internes, il n’est pas surprenant que le
parti ait décliné assez rapidement. Les animateurs initiaux de la
gauche, Laufenberg et Wolffheim, ne furent admis au congrès de
fondation que pour être exclus la même année (Wolffheim gravita
ensuite vers les nazis). Selon des sources du KPD, seulement la
moitié des 38 000 membres fondateurs était encore actifs six
mois plus tard.
Pendant
que les forces communistes stagnaient, les travailleurs dégoûtés
du SPD rejoignaient en masse les Sociaux-Démocrates Indépendants.
Les effectifs de l’USPD, de 300 000 au début de 1919,
s’étaient enflés jusqu’à atteindre 800 000 à l’automne
1920.
L’équilibre
entre la gauche et la droite dans le parti était lui aussi
changeant. Dans la première période de la révolution la droite de
l’USPD – Haase, Hilferding, Kautsky et Bernstein – avait pu
obtenir l’investiture des congrès du parti par plus de deux contre
un. Ils ne faisaient pas mystère de leur perspective :
réunifier les deux partis sociaux-démocrates comme avant la guerre.
Mais l’âpreté de la lutte contre les Freikorps et les
sociaux-démocrates poussa les membres du parti fortement sur la
gauche. Une puissante opposition de gauche se développa, autour des
Délégués Révolutionnaires de Berlin.
La
controverse portait essentiellement sur deux questions – le rôle
des conseils ouvriers par rapport au parlement et l’Internationale.
Lors
du congrès du parti tenu à Berlin en mars 1919 (au moment où
commençait la semaine sanglante), la direction chercha à se
concilier l’aile gauche en parlant du besoin de « conseils
ancrés dans la constitution » aux côtés de l’Assemblée
Nationale. Pour la gauche, Däumig s’opposa à cela, proclamant
avec insistance que le socialisme ne pouvait provenir que des
conseils ouvriers formant la base de la dictature du prolétariat.
L’équilibre des forces au congrès fut illustré par l’élection
de la présidence : Haase, pour la droite, eut 159 voix, Däumig
109.
On
arriva finalement à un compromis sur la question du parlement et des
conseils – une formulation qui reconnaissait les conseils comme des
« organisations combattantes » créées par la
« révolution prolétarienne », déclarant que
« le
Parti Social-Démocrate Indépendant lutte pour la dictature du
prolétariat », mais ajoutant bien vite que le parlement avait
un rôle important à jouer.
En
ce qui concernait l’Internationale, la question était de savoir si
elle devait être reconstituée sur la même base que la Seconde
Internationale qui s’était effondrée en 1914, et inclure ceux qui
avaient soutenu des camps opposés à la fois dans le conflit mondial
et dans la guerre civile qui avait suivi ; ou si le parti
devait
s’affilier à l’internationale révolutionnaire qui avait été
proclamée quelques semaines plus tôt par un certain nombre de
délégués de la gauche révolutionnaire réunis à Moscou. Lors du
congrès de mars, c’est la première option qui fut retenue ;
mais la radicalisation des membres aboutit à ce qu’au congrès
suivant, en décembre 1919, la direction fut contrainte d’opter
pour des « négociations » avec l’Internationale
Communiste.
De
telles formulations correspondaient, au début, aux idées inabouties
des travailleurs qui venaient de rejoindre le parti. Mais avec le
temps, et l’évaluation que faisaient les membres des évènements
sanglants de 1919 et du putsch de Kapp, des résolutions de compromis
devinrent de moins en moins praticables. Un dirigeant de l’aile
droite de l’USPD a décrit ce qui se passait :
L’antagonisme
au sein du Parti Social-Démocrate Indépendant avait été très
incomplètement résolu par le programme, extrêmement ambigu, qui
était le fruit d’un mariage entre la démocratie et la dictature
des soviets consommé lors de la conférence de Leipzig (décembre
1919). (...) A l’intérieur des organes et de la presse du parti,
la lutte acharnée pour le pouvoir (entre les deux ailes) n’avait
subi que peu d’interruptions, y compris pendant le putsch de Kapp
et la campagne électorale.4
La
gauche pensait que si elle luttait avec persévérance, la droite
finirait par quitter le parti comme Bernstein l’avait déjà fait.
Elle émergeait en même temps comme une force importante dans les
syndicats : les « Délégués
Révolutionnaires » de
Berlin, regroupés autour de Richard Müller et Dissmann, eurent la
majorité à la conférence du Syndicat des Travailleurs de la
Métallurgie en 1919, obtinrent un tiers des voix lors de la
conférence de la principale fédération syndicale, l’ADGB, forte
de 9 millions de membres, et prirent le contrôle de la fédération
syndicale locale de Berlin.
Les
communistes critiquaient sévèrement les Indépendants de gauche,
les accusant d’être souvent, lorsqu’il s’agissait de lutte
concrètes, pieds et poings liés à la droite. La droite contrôlait
l’appareil du parti, la fraction parlementaire et la plus grande
partie de la presse, et cela déterminait la façon dont les
décisions des congrès étaient interprétées dans la pratique.
Dans la lutte contre Kapp, par exemple, la ligne de l’organisation
nationale de l’USPD n’était pas très différente de celle des
sociaux-démocrates majoritaires. Beaucoup de membres du parti
étaient impliqués dans la lutte armée, et s’opposèrent à toute
reprise du travail tant que les forces réactionnaires ne seraient
pas complètement désarmées et purgées, mais le parti n’avait
aucune politique nationale
d’agitation autour de ces revendications. Même à Berlin, où la
gauche était majoritaire dans le parti, ils finirent par consentir à
reprendre le travail avant que des termes clairement définis aient
été acceptés.
Le
parti se vantait de sa structure « fédérale », non
centralisée, mais c’était exactement ce que voulait la droite,
car cela lui donnait une réputation
« révolutionnaire »
sans qu’elle ait à prendre la responsabilité d’un programme
national d’agitation révolutionnaire.
Il
y avait dans le parti communiste d’abondantes discussions sur la
manière dont il y avait lieu d’influencer l’aile gauche des
Indépendants – en collaborant amicalement ou en critiquant sans
pitié. Mais quoi qu’il en soit cette influence était limitée.
Dans
les discussions sur l’éventualité d’une fusion, un des jeunes
dirigeants des Indépendants de gauche, Geyer, résumait bien le
sentiment général envers le KPD lorsqu’il disait :
« La
gauche de l'USPD n'a pas besoin d'une fusion entre partis. L'U.S.P.D.
est le parti révolutionnaire de masse en Allemagne. » ».5
L’attitude
de la gauche de l’USPD changea à l’été 1920. Non pas du fait
d’une action quelconque du KPD lui-même, mais à cause des
pressions des dirigeants de la nouvelle Internationale Communiste, en
particulier du parti bolchevik russe. La demande de l’USPD de
négociations sur l’appartenance à l’Internationale Communiste
reçut de Moscou une réponse simple : l’affiliation n’était
possible que si la gauche prenait le contrôle de la totalité de
l’appareil du parti et de sa presse, excluait les dirigeants
droitiers et s’employait à construire un parti révolutionnaire
centralisé. Telle était la substance des « 21
conditions »
appliquées à l’USPD et à des partis semblables dans d’autres
pays, y compris les partis socialistes français et italien, le Parti
Travailliste norvégien, et l’ILP britannique.
Le
but, et les dirigeants de l’Internationale n’en faisaient pas
mystère, était de séparer les « nombreux bons
communistes »
de ces partis des dirigeants mous, « centristes » et
réformistes.
Quatre
représentants des Indépendants allemands – deux de chaque aile du
parti – assistèrent au Second Congrès de l’Internationale
Communiste. Les délégués de la droite restèrent intraitables dans
leur défense du parti tel qu’il était. Les délégués de la
gauche, Däumig et Stocker, furent finalement convaincus que la seule
chose à faire était d’exclure la droite, fusionner avec le KPD et
rejoindre l’Internationale.6
La
question fut résolue lorsque les délégués rentrèrent en
Allemagne pour un congrès spécial du parti à Halle. Hilferding fit
le principal discours pour la droite, et Zinoviev, venu de Russie,
expliqua la position de l’Internationale. Il fit un discours
brillant et démagogique qui remporta l’adhésion des derniers
hésitants – et la position de la gauche fut adoptée par 237 voix
contre 156.
La
droite rompit immédiatement, insistant sur le fait qu’elle
conserverait le nom de l’ancien parti avec la plupart de ses
organes de presse. La gauche négocia alors les termes d’une fusion
avec les communistes, et un congrès conjoint, tenu en décembre,
fonda un « nouveau » parti, le Parti Communiste
Unifié
d’Allemagne (VKPD – le V fut abandonné quelques mois après sa
fondation).
Mais
la masse des effectifs des Sociaux-Démocrates Indépendants ne
rejoignit pas le nouveau parti. Sur les 400 000 qui restèrent
en dehors, un tiers peut-être passa au nouvel USPD contrôlé par la
droite. Le reste ne rejoignit aucun parti, attendant de voir comme
les choses allaient se développer. Cela conservait cependant au
Parti Communiste Unifié un demi-million de membres environ – dix
fois plus qu’à l’époque du putsch de Kapp. Avec ce nouveau
parti, il semblait que la Révolution Allemande allait à nouveau
pouvoir faire de grands pas en avant. Mais ce ne devait pas être le
cas.
L’Action de Mars
Les
travailleurs d’Allemagne centrale, autour de Halle et Merseberg,
étaient devenus parmi les plus révolutionnaires du pays en 1919 et
1920 – même si les mineurs de la région avaient été, avant la
guerre, conservateurs et apolitiques. Ils se heurtèrent violemment
aux Freikorps en 1919, et prirent en quelque sorte le contrôle de la
région pendant le putsch de Kapp.
Ils
avaient ensuite conservé leurs armes, et utilisé leur force
fraîchement acquise pour se défendre des attaques contre leurs
conditions de vie et de travail. Pour prendre la mesure de leur
radicalisation, lors des élections du Land prussien en février 1921
ce fut la seule zone dans laquelle les suffrages des communistes
(204 000) étaient supérieurs aux voix combinées des deux
partis sociaux-démocrates (147 000) : c’était le seul
endroit du pays où les communistes étaient visiblement la majorité
de la classe ouvrière.
A
la mi-mars le chef social-démocrate de la province, Horsing, décida
que le moment était venu de mettre un terme à cet état de choses.
Il annonça qu’il allait envoyer la police de sécurité dans la
région pour en finir avec « les grèves sauvages, le pillage,
les vols, le terrorisme et autres manifestations de
non-droit ».
Horsing
avait bien choisi son moment. Il savait que les fêtes de Pâques,
dix jours plus tard, rendraient une action défensive difficile pour
les travailleurs. Il espérait aussi que le reste de l’Allemagne ne
réagirait pas à des « opérations de maintien de
l’ordre »
dirigées contre les travailleurs d’une localité – pas plus
qu’il n’avait réagi aux marches des Freikorps en 1919 ou à
l’écrasement de la Ruhr après le putsch de Kapp.
Mais
à l’inverse de ces deux épisodes, la majorité de la direction
communiste pensait que désormais, avec l’augmentation considérable
des forces de leur parti, ils n’avaient plus besoin d’être
constamment sur la défensive. Une partie de la direction du
Comintern fit plus que les encourager dans cette voie. Il fut décidé
de transformer les escarmouches relativement insignifiantes de
l’Allemagne centrale en démonstration de force pour le nouveau
Parti Communiste de masse. Toutes ses forces furent jetées dans la
transformation des petits affrontements en une nouvelle offensive
révolutionnaire – insurrectionnelle – de la classe au niveau
national.
Le
parti décida de pousser à la grève générale dans toute
l’Allemagne centrale. Le 18 mars, le quotidien du parti, Rote
Fahne, appela les
travailleurs de toute l’Allemagne à s’armer. Il ne faisait pas
mention de la situation en Allemagne centrale, préférant utiliser
comme un prétexte le refus du gouvernement bavarois de désarmer les
bandes d’extrême droite. Le 20 mars, le journal faisait référence
à l’Allemagne centrale, appelant tous les travailleurs à venir à
l’aide de cette région. En fait, le journal disait que tous ceux
qui ne le feraient pas seraient des jaunes : « Ceux
qui ne
sont pas avec nous sont contre nous », vociférait la première
page.
Mais
la grève de protestation ne fut pas générale, y compris en
Allemagne centrale. Les travailleurs avaient fait grève dans la zone
de Mansfeld-Eisleben, où la police de sécurité de Horsing était
déjà présente. Mais l’ambiance à Halle était telle que la
direction du parti hésitait à appeler à la grève générale. Les
tentatives de la direction nationale pour pousser la lutte en avant
prirent une note désespérée. Un représentant de la Centrale du
Parti, Eberlein, expliqua aux communistes de Halle qu’ils devaient
utiliser tous les moyens pour « provoquer un soulèvement en
Allemagne moyenne ».
Il alla jusqu’à proposer de faire sauter les locaux du parti, pour
en mettre la responsabilité sur la police et susciter la colère des
travailleurs !7
La
tactique d’auto-provocation ne fut pas adoptée – même si
l’histoire fut par la suite beaucoup utilisée pour discréditer le
Parti Communiste. Au lieu de cela, le parti accepta les services de
Max Hoelz, le dirigeant de « l’Armée Rouge » en
Vogtland (près de la frontière tchèque) pendant les journées de
Kapp et un héros populaire virtuel du fait de ses exploits en
échappant à la police. Hoelz n’était pas membre du parti – il
faisait partie de ceux, nombreux, qui s’étaient éloignés après
la scission avec l’ultra-gauche. Il avait été qualifié, dans des
publications du parti et lors de conférences, de
« non-marxiste »
et d’« aventurier révolutionnaire ».
Les
activités les plus récentes de Hoelz avaient été extrêmement
individualistes. Il raconte dans ses mémoires comment il s’employait
à « déstabiliser les autorités et terroriser la
population »
en faisant sauter des tribunaux : il essaya de dynamiter
l’hôtel
de ville de Falkenstein, en Vogtland, « pour attirer
l’attention sur le fait que nous étions, nous autres communistes,
toujours vivants » ; il envoya des amis procéder à
des
actions semblables à Dresde, Freiburg et Leipzig ; finalement
il dévalisa diverses banques pour financer le KAPD, bien qu’il
n’en fût jamais membre.8
Lorsque
Hoelz arriva en Allemagne moyenne le 21 mars, le moral des
travailleurs était, admet-il, loin d’être insurrectionnel. Lors
de la réunion d’un comité de grève à Mansfeld « il n'y
avait pas la trace de la moindre préparation à une action armée.
(...) Les travailleurs pensaient qu’une grève générale forcerait
le « socialiste » Horsing à se retirer ses
sentinelles
armées ».9
Mais le soir suivant, d'après Hoelz, « la comportement brutal
et complètement injustifié de la police amena cependant les
travailleurs à prendre les armes. (...) Je devais bien plutôt
tenter d'organiser les travailleurs qui s’armaient spontanément en
unités combattantes ».10
En
tout état de cause, Hoelz se proclama « commandant en chef du
soulèvement », une position dont il dit qu’elle fut acceptée
à la fois par le KPD et le quartier général du KAPD à Berlin.
Travaillant en collaboration avec un dirigeant communiste local,
Scheider, il réussit à constituer un détachement armé de 400
hommes qui entreprit des attaques de guérilla contre divers postes
de police. Cette « armée » se déplaçait d’un endroit
à l’autre, rassemblant autour d’elle des mineurs au chômage et
« enrôlant » tous les hommes entre 18 et 45 ans,11
jusqu’à ce qu’elle compte, toujours selon Hoelz, 2 500
hommes.
Ces
derniers furent rejoints par 3 000 travailleurs qui s’étaient
rassemblés à Halle et mis en marche à leur rencontre. En même
temps, les ateliers de Leuna, avec leurs 20 000 salariés,
s’étaient mis en grève, 2 000 ouvriers s’armant et prenant
la contrôle de l’usine ; mais ils ne surent former aucun plan
d’offensive, restant inactifs pendant une semaine, forteresse
isolée, incapable de se relier aux forces de Hoelz.
Il
existe différentes versions des actions entreprises par les armées
de Hoelz. Celui-ci, naturellement, tend à exagérer leurs succès.
Mais il doit tout de même admettre qu’ils n’étaient pas assez
forts pour rester dans une ville plus de 24 heures. D’autres récits
décrivent une opération à l’impact militaire très limité.
Selon l’historien américain Angress, qui donne une narration
détaillée de ces évènements, « Ses destructions par le feu,
dynamitages et pillages étaient sans système »,12
le potentiel énorme des travailleurs de Leuna ne fut jamais
utilisé ; et les combats eurent lieu sans aucun plan unifié.13
D’après Buber-Neumann, dont on doit prendre en compte la forte
animosité envers les communistes lorsqu’on considère ses écrits,
il y avait « une confrontation générale avec la
police »
avec des « attaques d’hôtels de ville, de banques,
d'équipements ferroviaires, et enfin de maisons privées ».14
La
mise en mouvement d’une police armée suffisante pour écraser le
« soulèvement » n’était qu’une question de temps.
Elle rattrapa « l’Armée Rouge » à Ammendorf, la
vainquit dans une confrontation armée, puis pourchassa ses groupes
dispersés à travers champs.
Le
« soulèvement » lui-même fut un événement de peu de
conséquence. Il ne saurait être comparé aux batailles sanglantes
contre les Freikorps, ou aux journées de Kapp. Le gouvernement n’eut
même pas besoin d’avoir recours à l’armée pour briser les
forces de Hoelz, la police s’avérant suffisante. Il n’est pas
surprenant que les travailleurs des autres régions, qui avaient
assisté à trois reprises à l’écrasement de Berlin, de Brême,
de la Bavière et de la Ruhr, ne l’aient pas considéré comme un
événement important.
Son
intérêt historique réside dans le fait que la direction du Parti
Communiste ne comprit rien à ce qui se passait, réagissant de façon
erronée, allant jusqu’à mettre en péril la survie de leur parti
nouveau-né. Ils décidèrent que c’était une grande action
« offensive », « révolutionnaire ».
Ils
appuyèrent sur des boutons qui n’existaient pas pour essayer
d’obtenir une action de solidarité aux proportions
insurrectionnelles – et accusèrent leur base de
« passivité »
lorsque cette action ne se produisit pas.
A
Hambourg il y eut une manifestation de quelque 2 000 chômeurs.
Ils essayèrent de prendre les docks, et échouèrent. Le
gouvernement sauta sur l’occasion pour décréter l’état
d’urgence. La direction du Parti Communiste répliqua en appelant à
une grève générale nationale illimitée – la veille de la fête
de Pâques. Le résultat fut pathétique : à peine
200 000
grévistes selon la plupart des versions, 400 000 selon
quelques
optimistes. Pourtant le KPD revendiquait 400 000 membres. A
Berlin, pratiquement personne ne fit grève, malgré les 200 000
voix dont les communistes avaient été gratifiés aux élections à
peine un mois plus tôt. Un ordre du parti local enfonçait le
clou :
« Un communiste, même s’il est minoritaire parmi les
travailleurs, ne doit sous aucun prétexte continuer le
travail ».15
La
classe ne bougea pas. Dans certains endroits, des membres du parti
qui avaient plus de détermination que de bon sens essayèrent de
bouger à sa place. Ils utilisèrent les chômeurs pour occuper les
usines et en bloquer l’accès aux ouvriers. La majorité des
travailleurs non communistes qui ignorèrent l’appel à la grève
se firent traiter de « jaunes ». Le seul résultat fut
de
dresser les travailleurs non communistes contre les communistes, avec
des disputes, des bagarres et même des coups de feu.
L'usine
Krupp Friedrich-Alfred-Hütte
de Rheinhausen fut le
jeudi matin le théâtre de sévères bagarres entre les communistes
qui occupaient les ateliers et les ouvriers qui voulaient travailler.
Les ouvriers finirent par charger les communistes avec des bâtons,
obtenant ainsi par la force d’entrer sur leur lieu de travail. A la
fin, des soldats belges intervinrent dans les rixes, séparèrent les
combattants et arrêtèrent 20 communistes. Ces dernier revinrent
plus tard avec des renforts et réoccupèrent la forge.16
Au
lieu d’expliquer patiemment aux ouvriers sociaux-démocrates que
leurs intérêts étaient opposés à ceux de leurs dirigeants, le
Parti Communiste traita ces travailleurs comme s’ils étaient
identiques à leurs dirigeants :
Nous
disons en toute clarté aux ouvriers Indépendants et socialistes
majoritaires : si vous tolérez en silence ou en ne la
critiquant que mollement la terreur blanche et la justice blanche
instituées par Ebert, Severing et Horsing contre les travailleurs,
alors la faute en retombera non seulement sur les têtes de vos
dirigeants mais sur celles de chacun d’entre vous. (...) Honte et
déshonneur au travailleur qui se tient aujourd'hui à l’écart ;
honte et déshonneur au travailleur qui ne sait pas où est sa
place.17
La
majorité
des travailleurs se trouvait condamnée pour n’avoir pas bondi au
commandement de la minorité !
Les
ennemis du parti jubilaient. Le croupion droitier de l’USPD sentit
que c’était une question qu’il pouvait facilement exploiter pour
attirer à lui ceux qui n’avaient rejoint aucun parti après la
scission. Ils dénoncèrent l’action, sous-entendant que Horsing
avait eu raison d’envoyer la police de sécurité – et reçurent
le soutien de nombreux travailleurs qui avaient été sympathisants
des communistes jusqu’à ce qu’ils se fassent huer et traiter de
« jaunes ».
Pour
le Parti Communiste lui-même, les conséquences furent
catastrophiques. Ses actions semblaient justifier tout ce que
disaient ses ennemis lorsqu’il le traitaient de
« dictatorial »,
« antidémocratique »,
« putschiste ». En
l’espace de quelques semaines, il perdit 200 000 membres –
la moitié de ses forces. Les militants qui étaient trop
intelligents pour perdre leur emploi en faisant grève tout seuls
pendant que leurs camarades d’atelier travaillaient quittèrent le
parti plutôt que d’obéir à ses instructions idiotes. Et les
centaines de milliers d’anciens membres de l’USPD qui n’avaient
pas
rejoint le VKPD trouvèrent leurs doutes confirmés.
L’Etat
lui aussi sauta sur l’occasion pour mettre en œuvre des mesures
répressives, jetant en prison des centaines de communistes – y
compris Brandler, le président du parti – et interdisant les
journaux communistes. Des dizaines de milliers de communistes loyaux
qui avaient obéi au mot d’ordre de grève lancé par leur parti ne
furent pas autorisés par la direction à reprendre leur travail.
Dans de nombreux districts, les liens entre les travailleurs
communistes et non-communistes furent rompus. Les communistes
semblaient, aux yeux de nombreux travailleurs, confirmer les vieilles
histoires sur les « saboteurs bolcheviks » et les
« spartakistes assoiffés de violence ».
Le
parti était passé à l’action sans la classe – et s’était
presque brisé lui-même.
La direction du KPD se divise
La
thèse centrale de ce livre jusqu’ici est que la Révolution
Allemande a été vaincue à cause de l’absence, ne serait-ce que
du noyau d’un parti cohésif en Novembre 1918. A chaque étape
ultérieure, ce manque initial a empoisonné le mouvement, empêchant
qu’une orientation cohérente soit donnée aux accès de colère
révolutionnaire de la classe ouvrière. A première vue, cependant,
l’Action de Mars ne semble pas coller avec cette thèse. Le parti
de masse existait – pourtant il se comportait de façon aussi
extravagante que Liebknecht et Ledebour en janvier 1919, ou que les
dirigeants de l’Armée Rouge de la Ruhr à la fin de mars 1920.
Comment
expliquer cette contradiction ?
Les
mouvements révolutionnaires les plus puissants ne se libèrent
jamais complètement des tares de la société qu’ils combattent.
Ils sont construits par des hommes et des femmes qui ont grandi dans
cette société, qui ont acquis par l’éducation un grand nombre de
ses vices – vanité personnelle, petites jalousies, phobies
irrationnelles, peurs obsessionnelles. Tout cela embrume
nécessairement le jugement politique : de tous les grands
chefs
révolutionnaires, seul Lénine semblait capable de mettre
complètement de côté de tels sentiments personnels.
La
gravité du problème est multipliée par cent lorsque des partis
révolutionnaires sont engagés dans des luttes désespérées,
existant à peine un jour, propulsés aux portes du pouvoir le
lendemain. Leurs dirigeants ne peuvent se payer le luxe de
scrupules : ils doivent utiliser certaines des formes
caractéristiques d’organisation autoritaire développées par le
capitalisme pour combattre le capitalisme. Ils doivent exiger une
totale discipline des membres du parti ; ils doivent être
prêts
à se débarrasser de ceux qui ne peuvent remplir les tâches qui
leur sont assignées, aussi bonnes soient leurs intentions, aussi
prestigieuses soient leurs réputations.
La
frontière entre une action arbitraire, motivée seulement par des
sentiments personnels irrationnels, et une action nécessaire est
toujours difficile à délimiter dans de telles circonstances :
on n’a pas le temps d’en débattre en long et en large. Dans
l’Allemagne de 1920-21, la tâche semblait presque impossible.
Un
parti révolutionnaire de masse avait été formé, après
que les occasions révolutionnaires les plus favorables fussent
passées, par une politique consistant à briser avec des éléments
« gauchistes » impatients mais à l’évidence
révolutionnaires (l’essentiel de la base du KAPD), et par
l’unification avec des gens qui, certes, évoluaient à gauche,
mais qui n’avaient pas encore fait leurs preuves en tant que
révolutionnaires. Pendant toute cette période, il y avait eu des
sections de travailleurs, dans une région industrielle après
l’autre, qui étaient prêts à combattre. Mais le parti avait
dépensé autant d’énergie à les empêcher de se lancer dans des
aventures suicidaires qu’à exhorter d’autres sections à les
soutenir.
Inévitablement,
la période était frustrante aussi bien pour la base du parti que
pour ses dirigeants. Ils étaient confrontés à des accusations
quotidiennes de la part des « gauchistes » exclus,
qui
les appelaient « centristes »,
« opportunistes »
voire « sociaux-démocrates déguisés ». Et ils se
demandaient si une fusion avec les sociaux-démocrates indépendants
pouvait produire un parti authentiquement révolutionnaire.
La
tension était présente dès la République des Soviets de
Bavière :
Paul Levi avait critiqué la proclamation de la Seconde République
(communiste) des Conseils comme une aventure, alors qu’un autre
membre de la direction, Paul Frölich, la soutenait avec ardeur.18
Le
débat fit rage à nouveau après la lutte autour du putsch de Kapp.
Tout le monde était d’accord pour dire que la condamnation
initiale de la grève générale par la réunion (tronquée) de la
Centrale du Parti avait été une erreur grossière. L’incident
était clos en ce qui concernait la responsabilité de ce
cafouillage, que Frölich attribuait implicitement à Levi – alors
que Levi avait lui-même, de prison, sévèrement dénoncé les
décisions de la Centrale.
L’argument
de Frölich était que, sous l’influence de Levi, la direction du
parti avait oublié que c’était l’action,
et non la propagande, qui gagnait les gens aux idées
révolutionnaires. Et donc l’abstentionnisme de la Centrale du
Parti au début de la lutte était lié à son soutien à un
« gouvernement ouvrier » à la fin. Frölich dénonçait
l’invitation faite aux indépendants à se joindre à ce
gouvernement comme revenant à dire : « Vous êtes déjà
une putain ; prostituez-vous à nouveau pour que nous puissions
garder notre virginité ».
Il
rappelait que Levi avait dit dans une réunion des conseils d’usine
de Berlin que les conditions n’étaient pas mûres pour la
dictature du prolétariat. Ceci, insistait Frölich, n’était rien
d’autre qu’un « pseudo-marxisme » qui voyait la
préparation de la révolution non pas dans l’action, mais dans
« six mois de travail d’organisation et d’agitation, six
mois de lecture quotidienne d’articles chargés de connaissances
historiques et de bons arguments ». Ce que cela reflétait
véritablement était « l’espoir d’un moment de pause »
qui avait mené à une « politique purement
opportuniste ».19
Levi
conservait des appuis considérables dans la direction. Le principal
théoricien du parti, Thalheimer, écrivit une réponse sarcastique
(qui détruisait de nombreux arguments que Thalheimer lui-même
devait utiliser douze mois plus tard). Il décrivait l’article de
Frölich comme un « retour de la maladie infantile » -
en
d’autres termes du gauchisme :
Lorsque
aujourd'hui Paul Frölich lance la phrase générale selaon laquelle
le développement jusqu'à la victoire passe par une série de
défaites ; lorsqu’il se détourne de la phrase du programme
spartakiste concernant le besoin de s'appuyer sur la majorité
expresse de la classe ouvrière, c’est qu’il n’a pas encore
appris les leçons de la semaine de janvier ou de la république
munichoise.20
Lénine,
dans un appendice
à son célèbre petit livre La
maladie infantile du communisme,
semblait en accord avec la position tactique prise par le Centre du
parti allemand sur la question du gouvernement ouvrier – même s’il
critiquait comme fausses certaines formulations. Il la décrivait
comme :
parfaitement juste dans ses
prémisses
fondamentales et dans sa conclusion pratique. (...) Cette tactique
est, sans nul doute, juste quant au fond.. (...) il est cependant
impossible de passer sous silence le fait qu'on ne saurait appeler
« socialiste » (dans une déclaration officielle du
Parti
communiste) un gouvernement de social-traîtres (...)
Mais
Lénine n’était pas considéré à l’époque comme la divinité
qu’il devint plus tard pour le Comintern stalinisé, et ses paroles
semblent avoir eu moins d’impact en Allemagne que le jugement de
Radek. Le vieux militant de la gauche allemande d’avant-guerre,
conseiller de la direction du parti allemand à l’époque des
grandes luttes de 1919, était maintenant à Moscou, secrétaire de
l’Internationale Communiste à moitié formée. Il avait traversé
les expériences de la direction allemande et semble avoir développé
les mêmes frustrations et impatiences. Dans l’édition de juillet
du journal de l’Internationale, Die
Kommunistische Internationale,
il soutint de tout son poids les arguments de Frölich :
« L’anti-putschisme
a dans une certaine mesure mené au quiétisme : de
l’impossibilité de la conquête du pouvoir politique en Allemagne
– établie empiriquement en 1919 – ils ont tiré la conclusion,
en mars 1920, de l’impossibilité de l’action en général… »
L’exécutif de l’Internationale avait considéré « comme
correcte la lutte contre le putschisme en Allemagne », mais
voyait maintenant que « la propagande anti-putschiste
doctrinaire est devenue un handicap pour le mouvement ». De
plus, en proposant une « opposition loyale » à un
« gouvernement ouvrier » la Centrale avait
« abandonné
sa mission historique ».21
Des
discussions avaient commencé auparavant, avec une polémique ouverte
entre Radek et Levi sur les leçons de la brève République
Hongroise des Soviets de mars-juillet 1919. Levi avait sévèrement
critiqué les dirigeants communistes hongrois, en particulier Béla
Kun, pour avoir pris le pouvoir avant que les travailleurs n’y
fussent prêts. Radek répliquait (avec de claires implications pour
les évènements d’Allemagne) que l’erreur n’avait pas été de
prendre le pouvoir, mais de l’avoir fait sans avoir tiré une ligne
claire entre eux-mêmes et les sociaux-démocrates « de
gauche ».22
A
l’époque du Second Congrès de l’Internationale Communiste, tenu
à Moscou en juillet 1920, la polémique s’aigrissait et on parlait
ouvertement d’une tendance « droitière » dans le
parti
allemand, derrière Levi. Le Congrès du Parti Communiste Allemand
s’entendit déclarer (par Ernst Meyer) qu’on pensait à Moscou
qu’il y avait deux ailes dans le parti, une gauche menée par Meyer
et Rosi Wolfstein, et une droite dirigée par Levi et Walcher. Levi
leur avait dit que ce n’était pas un clivage politique, mais une
différence d’« humeur ». Les « camarades
russes » avaient cependant considéré cela comme une
continuation des vieilles divergences qui avaient éloigné Rosa
Luxemburg et Jogiches de Lénine.23
Ce qui avait commencé comme une discussion politique se trouvait à
l’évidence vicié par de vieilles animosités personnelles – qui
remontaient peut-être à l’absurde vendetta d’avant-guerre de
Rosa Luxemburg contre Radek.
Les
principaux communistes russes engagés dans la construction de
l’Internationale – Zinoviev et Boukharine aussi bien que Radek –
exhortaient le parti allemand à passer à l’action pour éviter
une dérive à droite. Ils conseillaient vivement l’unité avec le
« levain révolutionnaire » du KAPD aussi bien qu’avec
les « centristes » de la gauche de l’USPD. Avec cette
perspective à l’esprit, ils voulaient admettre le KAPD dans
l’Internationale. Face aux protestations unanimes de la délégation
du KPD (« gauche » aussi bien que
« droite »),
le KAPD fut relégué au statut de sympathisant.
Zinoviev
et Boukharine considéraient tout cela comme une preuve de
l’influence « conservatrice » de Levi.
L’Internationale
n’était pas, à l’époque, le monolithe qu’elle devait
devenir. Des désaccords sur de telles questions étaient monnaie
courante, et les « Russes » ne pouvaient pas en user
avec
Levi de manière arbitraire. S’ils pensaient que son approche était
fausse, ils devaient en convaincre le parti allemand. Il semble donc
que Radek reçut pour instruction de gagner les partisans de Levi
dans le parti allemand.
La
tâche n’était pas difficile. Rien n’est plus éprouvant pour le
système nerveux d’un dirigeant révolutionnaire que de devoir
continuellement empêcher des sections des masses de passer
prématurément à l’action. Même un dirigeant équilibré et
expérimenté comme Brandler souffrait de sentiments de frustration –
après tout, il avait lui-même reçu sa part de critiques pour ne
s’être pas, pendant les journées de Kapp, engagé dans des
« prouesses révolutionnaires » dans sa
« forteresse
de Chemnitz ». Il lui était plus facile de reprocher à
d’autres, plutôt qu’à la situation objective, la politique qui
l’avait rendu impopulaire. Même avec le bénéfice du recul
historique, il pouvait écrire 40 ans plus tard qu’il était
troublé par « des tendances, aussi bien dans la classe
ouvrière allemande que dans le KPD, qui ne rejetaient peut-être pas
la lutte armée, mais la considéraient avec indifférence ».24
Ce
« trouble » ne pouvait être justifié à la fin de 1920
par les besoins de la situation ; il reflétait bien plus la
frustration d’être dans une situation où la lutte armée n’était
en réalité pas adéquate.
La
grande réussite de Levi fut la naissance du nouveau Parti Communiste
Unifié par la fusion avec les Indépendants de gauche. Mais cela
aussi braqua une partie de la direction contre ce qui leur paraissait
chez Levi un excès de modération. Comme Brandler aussi le fit
remarquer dans une occasion différente :
Le
parti était devenu si gros que beaucoup de membres pensaient que
l’heure de la révolution avait sonné. Les gens étaient si
impressionnés par le seul chiffre des effectifs du parti qu’ils
refusaient de prendre en considération les forces infiniment
supérieures de l’ennemi.25
Mais
les vieux communistes n’étaient pas les seuls à être
euphoriques. Beaucoup, dans la masse des effectifs en provenance de
l’USPD, étaient encore plus impatients. Ils avaient rompu avec les
anciens dirigeants parce qu’ils étaient désormais convaincus de
la nécessité d’un parti révolutionnaire puissant basé sur
l’action. Ils pensaient qu’étant un demi-million dans un parti
authentiquement communiste, ils étaient capables de réaliser ce que
près du double ne pouvaient faire dans un parti inerte et mou. Ils
furent donc stupéfaits lorsque le premier acte public du parti
unifié, en janvier 1921, fut une « lettre ouverte »
appelant à l’unité d’action avec les syndicats et les autres
« partis ouvriers », à savoir le SPD qu’ils
méprisaient et l’USPD qu’ils venaient de quitter. L’appel
énumérait un certain nombre de points sur lesquels les déclarations
publiques de ces partis coïncidaient avec la position des
communistes – défense du niveau de vie des travailleurs, nécessité
de l’autodéfense armée contre les groupes terroristes d’extrême
droite, libération des prisonniers politiques de la classe ouvrière,
établissement de relations commerciale avec la Russie soviétique.
Il déclarait :
En proposant cette base
d'action, nous ne
dissimulons pas un instant, ni à nous-mêmes ni aux masses, que les
revendications que nous avons énumérées ne peuvent venir à bout
de leur misère. Sans renoncer, fût-ce un instant, à continuer de
propager dans les masses ouvrières l'idée de la lutte pour la
dictature, unique voie de salut, sans renoncer à appeler et à
diriger les masses dans la lutte pour la dictature à chaque moment
propice, le parti communiste allemand unifié est prêt à l'action
commune avec les partis qui s'appuient sur le prolétariat pour
réaliser les revendications mentionnées plus haut.
L’appel
à l’unité d’action fut ignoré par les dirigeants des autres
partis. Il reçut bien une réponse favorable de certaines sections
de leur base,26
ce qui montrait que c’était un bon moyen d’attirer celle-ci vers
les communistes, en particulier d’anciens Indépendants qui
n’avaient rejoint aucun parti après la scission. Mais au sein du
Parti Communiste et de l’Internationale, cela accrut l’hostilité
envers Levi : seule une intervention de Lénine empêcha
l’exécutif de l’Internationale Communiste (dirigée par Zinoviev
et Boukharine) de le dénoncer publiquement.
Toutes
ces divisions atteignirent finalement leur paroxysme au début de
mars. Levi avait indisposé les délégués du Comintern au Congrès
du Parti Socialiste Italien en s’opposant ouvertement à leur
tactique de division du parti pour former un nouveau Parti Communiste
dirigé par le gauchiste Bordiga. Un de ces délégués, Rákosi,
assista ensuite à une réunion du comité central du parti allemand
qu’il persuada, profitant des animosités contre Levi, de condamner
son attitude par 28 voix contre 23. De plus, en présentant sa
résolution, Rákosi ajouta qu’il fallait qu’il y ait encore plus
de scissions – « en
Italie, en France, ou en Allemagne »,
ce qui était à l’évidence une attaque contre Levi lui-même.
Dans
un mouvement d’humeur, Levi et quatre de ses partisans – parmi
lesquels le co-président du parti, Däumig, et la vieille amie de
Rosa Luxemburg Clara Zetkin – démissionnèrent de la Centrale. Ce
qui laissait la direction entre les mains du groupe qui s’était
laissé convaincre que Levi avait été trop « prudent »
– Frölich, Brandler, Meyer et Thalheimer. Dans une série de
lettres qu’il leur adressa, Radek les invitait instamment à
détruire la position de Levi dans le parti une fois pour toutes.27
Ce
qui fut désastreux pour le développement ultérieur du parti fut
l’énorme promotion donnée par ces actes à un courant bien plus
« gauchiste » qui commençait à grandir dans le
district
de Berlin. Il est intéressant de noter qu’il était rassemblé
autour d’Ernst Friesland, qui avait été le principal responsable
de la ligne abstentionniste au début du putsch de Kapp (ce qui
n’avait pas empêché la « gauche » d’en faire le
reproche à Levi, qui était en prison). Mais ses personnalités les
plus tonitruantes étaient deux jeunes intellectuels communistes dont
aucun n’était révolutionnaire depuis plus de trois ans – Ruth
Fischer et Arkadi Maslow.
La
poussée finale pour l’Action de Mars ne fut cependant donnée par
aucun des éléments qui, au sein du parti allemand, s’étaient
dressés contre Levi. Quelques jours plus tard, le communiste
hongrois Béla Kun arriva à Berlin en tant que délégué de Moscou.
On ne sait pas très bien si le conseil qu’il donna au Centre du
Parti restructuré venait de lui – Brandler prétend que Kun
agissait sur instructions de Zinoviev, le président de
l’Internationale.28
Mais il y a peu de doutes en ce qui concerne l’avis qu’il formula
alors.
Levi
expliquait, dans une lettre à Lénine du 29 mars, que Kun l’avait
rencontré, lui et Clara Zetkin, et leur avait dit :
que la Russie se trouvait dans
une
situation extraordinairement difficile [il y avait eu une famine qui
avait provoqué des révoltes paysannes et le soulèvement de
Kronstadt]. Que c'était une nécessité absolue qu’elle soit
soulagée par des mouvements à l’Ouest et que pour cette raison le
Parti Communiste Allemand devait passer à l’action.
Que
le KPD unifié comptait 500 000 membres, avec lesquels on
pouvait mettre en mouvement 1 500 000 prolétaires, ce
qui
est suffisant pour renverser le gouvernement. Qu'il était pour
commencer la lutte immédiatement avec le slogan « Renversement
du gouvernement’ »29
Kun,
très clairement, délivra le même message à la nouvelle Centrale.
Les 16 et 17 mars, lors d’une réunion du comité central,
Brandler, qui remplaçait Levi comme président, déclarait :
Les
antagonismes entre les Etats impérialistes se sont intensifiés, les
antagonismes entre l’Amérique et l’Angleterre se sont aggravés.
A moins qu’une révolution ne donne une orientation différente aux
évènements, nous allons très bientôt être confrontés à une
guerre anglo-américaine. (...) Des difficultés domestiques sont
dans le domaine du possible. (...) Il y a 90 % de chances pour
que des conflits armés éclatent entre les impérialistes allemands
et polonais. J'affirme qu'aujourd’hui nous sommes capables
d’influencer deux à trois millions de travailleurs non-communistes
qui vont combattre sous notre drapeau dans des actions, et même dans
des opérations offensives. C'est donc notre devoir dans la situation
présente d'intervenir par des actions pour influencer les choses
dans notre sens.30
De
tout cela, Frölich, également pour la Centrale, concluait :
« Par notre activité nous devons nous assurer que éruption
se produit, même s’il est nécessaire que nous provoquions la
Garde Locale. »31
Ainsi,
sur la base de prédictions hautement problématiques, la stratégie
générale du parti fut de passer de la défensive à l’offensive.
La « théorie de
l’offensive »
Ce
qui sous-tendait le nouveau tournant en vint à être connu sous le
nom de « théorie de l’offensive ». C’était une
doctrine qui fut propagée par Boukharine à Moscou, et acceptée à
des degrés divers par Zinoviev, Kun, Radek, la nouvelle Centrale
allemande et la gauche berlinoise de Friesland, Fischer et Maslow.
L’argument
de base était qu’il n’était plus nécessaire que le Parti
Communiste soit passif, dans l’attente de développements spontanés
en provenance de la classe. L’effondrement du capitalisme avait
pour conséquence qu’un parti communiste de masse pouvait
« éveiller » les masses à des actions armées
offensives à caractère partiel. Cela aggraverait l’instabilité
du système et amènerait davantage de travailleurs à passer à
l’action, jusqu’à ce que la prise du pouvoir soit à l’ordre
du jour.
Le
mode d’emploi de cette « stratégie », telle qu’elle
était appliquée à l’Allemagne, était indiqué dans une lettre
envoyée à certains membres de la Centrale allemande peu avant
l’Action de Mars :
Si la
faille entre l'Allemagne et l'Entente s'agrandit, et dans
l'éventualité d'une guerre avec la Pologne, nous parlerons. C'est
précisément parce que ces possibilités existent que vous devez
tout faire pour mobiliser le parti. (...) Si, maintenant, vous ne
faites pas tout, par une pression incessante en vue de l'action,(...)
vous échouerez de nouveau à un moment décisif. (...) moins penser
à la formule « radicale » qu'à l'action (...)32
La
lettre était mesurée et conditionnelle comparée avec
l’interprétation qui en fut faite par ceux qui la lurent. Frölich
informa le comité central que la nouvelle tactique impliquait
…une rupture complète avec le
passé.
Jusque là nous étions guidés par la tactique, ou plutôt nous
étions contraints d’accepter la tactique consistant à gagner de
temps jusqu’à ce qu’une situation propice à l’action existât.
(...) Maintenant nous disons : nous sommes si forts et la
situation est si chargée de possibilités que nous pouvons forcer le
sort du parti et de la révolution.
Le
parti doit aujourd’hui assumer l’initiative, indiquer que nous ne
voulons plus gagner du temps, attendre jusqu’à ce que nous soyons
confrontés au fait accompli ; nous entendons créer ce fait
nous-mêmes.33
Les
conséquences choquantes de l’Action de Mars ne discréditèrent
pas immédiatement cette théorie. Radek, qui en privé concédait
qu’on avait peut-être appelé à l’action « trop
tôt », répétait
avec insistance en public quatre semaines plus tard qu’il y aurait
encore beaucoup d’« actions partielles » semblables.
« Le développement de la révolution allemande passera par une
centaine d’actions territoriales fragmentaires », disait-il.34
La
Centrale du Parti enfonçait le clou :
Dans
une époque de profonde tension politique, de telles actions, même
si elles se terminent en défaites temporaires, constituent la
condition préalable indispensable des victoires à venir, et, pour
un parti révolutionnaire, la seule façon possible de conquérir les
masses pour lui et pour le combat révolutionnaire victorieux et de
commencer à faire prendre conscience aux masses indifférentes de la
situation politique objective.35
En
réalité, évidemment, l’Action de Mars avait causé au parti des
dommages terribles, lui faisant perdre la moitié de ses membres et
éloignant de lui les centaines de milliers de travailleurs qui
hésitaient entre les deux moitiés de l’ancien USPD. Quelques
actions de plus dans la même logique auraient détruit le parti
complètement.
En
fait, la « théorie de l’offensive » n’avait rien de
nouveau. A de nombreux égards c’était une reformulation de ce que
disait l’ultra-gauche en 1919. En tant que théorie, elle a
également connu une vogue plus récente : elle était inscrite
dans la vision guévariste, populaire dans de nombreux cercles
révolutionnaires à la fin des années 1960 et au début des années
1970 – qui s’exprimait par le slogan : « Le devoir
d’un révolutionnaire est de faire la révolution ».
Toutes
les versions de cette même position fondamentale proclament que
d’une manière ou d’une autre les révolutionnaires pouvaient
pousser les travailleurs à l’insurrection au moyen d’actions
armées entreprises par une « minorité agissante ».
Elles oublient toutes que les travailleurs, y compris les membres
d’un parti révolutionnaire, ne passeront à l’action
révolutionnaire que s’ils ressentent par
eux-mêmes qu’une
transformation de la société est nécessaire. Ce ne sont pas les
révolutionnaires qui font
la
révolution ;
c’est la masse des travailleurs. La tâche des révolutionnaires
est de
guider ces
travailleurs, et non de se substituer à eux.
L’Action
de Mars de 1921 est le test historique le plus important auquel cette
théorie ait jamais été soumise. Le recul qui suivit aurait dû
être sa réfutation définitive.
La crise dans le parti
Le
résultat de l’Action de Mars envoya une onde de choc à la fois
dans le Parti Communiste Allemand et dans l’Internationale
Communiste.
Le
premier choc, en Allemagne même, fut le départ du parti de Paul
Levi, le membre le plus important à s’être opposé à l’Action
de Mars. Levi avait été le dirigeant le plus influent du parti de
la mort de Jogiches à sa démission à peine une semaine avant
l’Action. Il était incontestablement le plus capable des
dirigeants. Mais il semble avoir eu un dédain considérable pour
ceux qui n’étaient pas d’accord avec lui, et il ne comprenait
pas vraiment que c’étaient de sincères et courageuses convictions
révolutionnaires qui avaient amené des communistes fraîchement
convertis à des actes de démence gauchiste.
Alfred
Rosmer, qui n’avait pas une grande sympathie pour les ennemis de
Levi, le décrivait à l’époque du Second Congrès de
l’Internationale à Moscou :
Les
communistes qui lui avaient résisté à Heidelberg [l’ultra-gauche]
étaient sa bête noire ; il en était obsédé ; le
conflit prenait l’allure d’une affaire personnelle . (...)
il revenait toujours à cette terrible opposition ; cela
frisait
la manie de la persécution.36
Levi
était en rage contre la stupidité de la majorité de la direction,
et ne cachait pas sa fureur. Dans un pamphlet publié quelques jours
plus tard il dénonça l’Action. La brochure, intitulée Notre
chemin contre le putschisme,
était une dénonciation brillante du raisonnement qui avait mené au
« plus important putsch bakouniniste de l’histoire ».
Il utilisait toutes ses ressources de rhétorique et de sarcasme pour
marteler l’argument selon lequel c’était de la folie que de
lancer une action armée « offensive » alors que la
masse
des travailleurs était passive, et seulement quelques semaines après
que le parti n’ait obtenu qu’un tiers des voix du SPD et de
l’USPD combinés lors d’élections tenues dans les deux tiers du
pays.37
Levi
expliquait que ce n’était pas plus facile, pour le Parti
Communiste de masse, de pousser à la lutte des travailleurs
sociaux-démocrates, que cela ne l’avait été pour la petite Ligue
Spartakus de 1918-19, c’était au contraire plus
difficile.
Au
début de la révolution allemande les sociaux-réformistes de toutes
sortes étaient complétement sur la défensive. Certes, ils avaient
les grandes masses derrière eux, mais leurs rangs étaient
inorganisés. (...) Aujourd’hui le social-réformisme a organisé
une résistance consciente et tenace contre le communisme, il passe
même déjà de la défensive à l’offensive. (...) L’influence
morale des communistes sur les masses prolétariennes indécises ou
toujours réformistes ne vient plus d'elle-même aux communistes.
Elle doit être conquise.38
Au
lieu de gagner les travailleurs, « la Centrale a joué avec la
garde favorite de Bakounine, le lumpenprolétariat ».
« Les
chômeurs ont été envoyés comme des colonnes d’assaut »
contre les travailleurs ayant un emploi. Le résultat a été
« une
insurrection soudaine et irréfléchie contre la bourgeoisie et les
quatre cinquièmes du prolétariat, un putsch ».39
Le
pamphlet démolissait les partisans de la « théorie de
l’offensive ». L’ennui, malgré tout, était qu’il était
écrit dans un style presque calculé pour ne pas convaincre la base
du parti, mais simplement les mettre en colère. Il donnait
l’impression de se moquer de leur courage, de leur promptitude à
descendre dans la rue pour combattre. Son ton était celui de
quelqu’un qui regardait le parti de l’extérieur, comme s’il
n’en était pas membre, avec ses erreurs. Ce n’était que trop
facile, pour la majorité de la direction du parti, qui n’avait
toujours rien appris de l’Action, de dresser les militants contre
Levi pour avoir écrit sur ce ton, plutôt que de répondre à ses
arguments. Ils l’exclurent du parti pour « manquement à la
discipline » sans se soucier de répliquer à aucune de ses
critiques.
La dispute internationale
La
discussion sur l’Action de Mars faisait bientôt rage à Moscou
autant qu’à Berlin. Car bien qu’une section de la direction de
l’Internationale Communiste ait poussé à des actions offensives,
des dirigeants comme Lénine et Trotsky n’avaient pas la moindre
idée de ce qui se préparait et de ce qui se disait.
Levi
lui-même désignait dans son pamphlet un des problèmes les plus
importants auxquels était confrontée l’Internationale. Elle était
dominée par le Parti Bolchevik russe, qui, avec son expérience de
prise du pouvoir réussie, avait des millions de choses à enseigner
aux autres partis. Mais le Parti Bolchevik était absorbé par la
défense de la révolution en Russie elle-même. Par conséquent :
D'abord
la Russie n’est naturellement pas dans une position lui permettant
de mettre à disposition les meilleurs éléments. Ils occupent en
Russie des postes où ils sont irremplaçables. Du coup, des
camarades arrivent en Europe, chacun d'eux plein de bonne volonté,
chacun plein d’idées propres, chacun désireux de montrer comment
il « règle la question ». Ainsi, l’Europe de l’Ouest
et l’Allemagne deviennent le terrain d’expérimentation de toutes
sortes d’hommes d’Etat en miniature qui donnent l’impression
qu’ils veulent y développer leur technique. (...) Les choses
prennent des proportions tragiques lorsqu’on envoie des
représentants qui ne possèdent pas les qualités humaines
nécessaires.40
Il
ne fait aucun doute que c’est exactement ce qui s’est passé
lorsque Béla Kun est venu à Berlin en mars 1921. Kun, pensaient la
plupart des dirigeants communistes, avait fait d’énormes erreurs
dans sa conduite de la République Hongroise des Soviets. Puis il
s’était querellé avec Lénine sur ses activités dans le Moyen
orient soviétique. Tout d’un coup, il voyait une chance de se
racheter en organisant une opération réussie en Allemagne – s’il
pouvait seulement parvenir à surmonter les réticences des
dirigeants allemands « conservateurs »,
« semi-centristes ».
Mais
la responsabilité ne repose pas uniquement sur Kun. Il est à peu
près certain qu’il reçut le feu vert de la part de ceux qui
étaient responsables des activités du parti allemand dans
l’Internationale Communiste – en particulier de Zinoviev,
président de l’Internationale. Zinoviev avait collaboré pendant
des années avec Lénine, apprenant avec lui un certain style de
travail. Il admettait que la construction d’un parti
révolutionnaire impliquait de « tordre
le bâton »,41
passer brusquement d’une tactique à une autre, lorsque les
conditions changeaient. Malheureusement, il n’avait pas appris de
Lénine à faire l’évaluation objective nécessaire pour savoir
quand le changement de tactique devait être opéré. Il pouvait
copier la forme
de la méthode de Lénine, mais pas son contenu.
Il
n’avait pas non plus appris de Lénine comment gagner d’autres
communistes à un tel changement de tactique. Lénine argumentait
avec soin et patience pour amener le parti à accepter le
changement : ses œuvres complètes sont pleines d’articles
répétant constamment, encore et encore, les mêmes thèmes lors de
chaque étape particulière de l’histoire du Parti Bolchevik. A
l’inverse, Zinoviev était un démagogue, brillant à la tribune,
mais porté à forcer les choses plus qu’à expliquer patiemment.
De façon caractéristique, Brandler le décrit « tapant du
poing sur la table » pour amener les communistes étrangers à
accepter son opinion ;42
il est difficile d’imaginer Lénine se comportant de cette manière.
Isaac
Deutscher écrit de Zinoviev : « Il faisait merveille
lorsqu’il exploitait les idées de Lénine ou lorsqu’il se
faisait son porte-parole tonitruant et tempétueux; mais son
intelligence manquait de vigueur ».43
Il est clair que lorsqu’il n’agissait pas sur les instructions
directes de Lénine, Zinoviev avait presque toujours tort : il
s’opposa à la révolution bolchevik en octobre 1917, et ne fit
montre, après la mort de Lénine, ni de perspicacité ni de volonté.
L’autre
poids lourd bolchevik engagé dans un travail régulier pour
l’Internationale était Boukharine. Moins porté à la démagogie
que Zinoviev, il avait une pensée plus substantielle. Mais, en 1920
et 1921, il était encore très marqué par le « bolchevisme de
gauche ». Il avait défendu sa propre « théorie de
l’offensive » en 1918 lorsque, à l’époque des pourparlers
de Brest-Litovsk, il proclamait que les Bolcheviks pouvait faire
surgir une Armée Rouge du néant et répandre la révolution en
prenant l’offensive contre les troupes allemandes. En 1920, le même
raisonnement l’avait conduit à soutenir avec enthousiasme l’avance
de l’Armée Rouge jusqu’aux portes de Varsovie, contre l’avis
du Commissaire du peuple à la Guerre, Léon Trotsky.44
On
peut dire que Zinoviev et Boukharine, avec Radek, dirigèrent
l’Internationale Communiste jusqu’à l’Action de Mars. Lénine
et Trotsky faisaient des apparitions occasionnelles lors des réunions
de son exécutif, mais étaient le plus souvent trop occupés par
d’autres choses. « L’exécutif du Comintern n’était
alors qu’un modeste bureau. Lénine n’assista à ses réunions
que deux ou trois fois : il n’avait tout simplement pas le
temps de venir plus souvent », a dit Brandler.45
Avec
le recul, il est possible de voir que ces « deux ou
trois »
visites de Lénine avaient déjà apporté le commencement d’une
perspective différente, dans la construction des partis communistes
d’Europe de l’Ouest, de celle de Zinoviev et Boukharine. Lénine
avait, par exemple, soutenu la proposition de « gouvernement
ouvrier » lors des journées de Kapp et la lettre ouverte aux
sociaux-démocrates de janvier 1921. Mais, jusqu’à l’Action de
Mars, il n’avait pas saisi que cette perspective était
fondamentalement différente de celle de Zinoviev et Boukharine –
il était d’accord avec eux, par exemple, pour mettre la pression
sur le KPD dans le sens d’une fusion avec le KAPD
« gauchiste ».
Peu
après l’Action de Mars, Lénine écrivit à Levi et à Clara
Zetkin :
En ce qui concerne les
dernières grèves
et le mouvement insurrectionnel, je n'ai absolument rien lu. Qu'un
représentant de l'exécutif de l'Internationale [Kun] ait proposé
une tactique imbécile, gauchiste, d'action immédiate « pour aider
les Russes », je le crois sans trop de peine : ce représentant se
trouve souvent trop à gauche. A mon avis, dans de tels cas, vous ne
devez pas céder, mais protester et porter immédiatement la question
devant le plenum de l'exécutif.
Son
attitude devait cependant se durcir bientôt considérablement. Il
étudia les évènements d’Allemagne dans le détail et décida que
non seulement Kun, mais la direction du Comintern avait commis une
pure folie. Le 10 juin, il écrivait à Zinoviev :
« Levi,
politiquement, avait raison sur beaucoup de points. (...) Les thèses
de Thalheimer et de Béla Kun sont sur le plan politique radicalement
fausses » - et ce, après que l’exclusion de Levi du parti
allemand ait été confirmée par l’Internationale !
« C'est
terrible, tout ce qu'on a laissé passer. », continuait Lénine.
Traitant de la « théorie » qui avait justifié
l’Action,
il ajoutait :
Il est insensé et malfaisant
d'écrire
et d'admettre que la période de propagande est révolue et que celle
de l'action a commencé. (...) Il faut sans cesse et de façon
systématique lutter pour gagner la majorité de la classe ouvrière,
d'abord à l'intérieur des vieux syndicats.
Il
dit à Clara Zetkin – qui plaidait auprès de lui la cause de Levi
– que « Levi avait perdu la tête : mais au moins il
avait une tête à perdre ». La « théorie de
l’offensive » était une absurdité :
Est-ce
qu’on peut vraiment l’appeler une théorie ? Non, c’est
une illusion, c'est du romantisme. (...) Nous ne ne pouvons pas
écrire de la poésie et rêver. (...) En attendant nous avons plus à
apprendre de Marx que de Thalheimer et Béla. (...) La Révolution
Russe, après tout, continue à fournir plus d’enseignements que
l’ « Action de Mars » allemande.46
Trotsky
étant, de façon indépendante, arrivé à la même conclusion, ils
décidèrent de lutter ensemble et d’« étouffer » la
« théorie de l’offensive » à l’occasion du
Troisième Congrès de l’Internationale, qui devait se tenir à la
fin juin 1921.
Aussi
curieux que cela puisse paraître, Lénine et Trotsky n’étaient
pas sûrs d’obtenir la majorité au Congrès. Ce n’était pas la
période de Staline, et les délégués étaient libres de se faire
une opinion personnelle sur toutes les questions. Zinoviev et
Boukharine étaient résolument opposés à Lénine et Trotsky, et
tentèrent de gagner les délégués à leur point de vue
individuellement avant le début du Congrès.
Mais
Lénine et Trotsky furent aidés par une chose. Une section de la
direction allemande qui avait lancé l’Action de Mars avait déjà
des doutes : Brandler s’était enfui en Russie pour éviter
d’être emprisonné et avait rapidement changé d’avis sur la
question. A Moscou, Lénine et Trotsky réussirent même à
convaincre le « théoricien de l’offensive »,
Thalheimer, et le gauchiste berlinois Friesland.
Le
Congrès fut une victoire politique pour la ligne désormais adoptée
par les deux dirigeants de la Révolution Russe. Lénine proclamait
avec insistance, dans ses discours, que les positions politiques
soi-disant « droitières » adoptées par la direction
du
parti allemand jusqu’au « tournant à gauche » de mars
avaient été correctes. La lettre ouverte, appelant au front unique
avec les autres « partis ouvriers’ avait été, disait-il
une initiative politique
exemplaire.
(...) C'est exemplaire, car c'est le premier acte d'une méthode
pratique visant à attirer la majorité de la classe ouvrière. Qui
ne comprend pas qu'en Europe, où presque tous les prolétaires sont
organisés, nous devons conquérir la majorité de la classe
ouvrière, celui là est perdu pour le mouvement communiste,
n'apprendra jamais rien, s'il ne l'a pas encore appris en trois ans
de grande révolution.47
Lénine
se rangea aussi à l'idée que les dirigeants allemands avaient eu
raison en 1920 dans leur opposition résolue au KAPD gauchiste. Il
écrivit à Zinoviev : « Je vois clairement que ce fut
une
erreur de ma part que d'avoir accepté l'admission du K.A.P.D. [dans
l’Internationale] ». Lors du Congrès même, Lénine déclara
que c’était « à mon profond regret et à ma grande
honte »
qu’il avait écouté favorablement l’opinion du KAPD sur la
« lettre ouverte ».48
Trotsky
était tout aussi incisif : « C’est notre devoir de
dire
clairement aux travailleurs allemands que nous considérons la
philosophie de l’offensive comme le danger suprême, et sa mise en
pratique comme le pire des crimes politiques ». Non seulement
il critiquait la « théorie de l’offensive », mais il
commençait à élaborer une stratégie alternative – qui reçut au
cours de l’année suivante le nom de stratégie du « front
unique ». Il proclamait avec force que la première grande
vague révolutionnaire était arrivée à son terme. Le capitalisme
avait réussi, temporairement, à se stabiliser. Une nouvelle grande
poussée ne serait pas
suffisante pour le
renverser. L’espace de temps avant que la révolution ne se répande
serait fait d’années et non de semaines.49
Le
rôle du Parti Communiste, disait Trotsky, était d’utiliser
l’entracte de deux ou trois ans pour s’assurer un soutien de
masse dans la classe ouvrière. Il pouvait le faire parce que la
bourgeoisie utilisait son nouveau répit pour lancer une offensive
contre les gains passés des travailleurs – avec baisses de
salaire, chômage, répression accrue, allongement de la journée de
travail, progression de la droite fasciste. Les sociaux-démocrates
et les bureaucrates syndicaux étaient trop liés aux capitalistes
pour adopter les formes de lutte radicales qui pouvaient, seules,
permettre de gagner ces batailles défensives. Le parti communiste
devait se saisir de la lutte sur ces « revendications
partielles » et montrer aux partisans de la social-démocratie
que seules les méthodes révolutionnaires pouvaient gagner des
batailles défensives, aussi limitées soient-elles.
Dans
les mois suivant le Congrès, cet argument fut développé plus
avant : la seule façon de gagner les travailleurs
sociaux-démocrates était de suivre la tactique inaugurée par la
« lettre ouverte » allemande – proposer l’unité
d’action aux dirigeants des partis sociaux-démocrates et des
syndicats. Ce n’est qu’en s’adressant aux dirigeants que les
communistes pouvaient parler à leurs bases.
Si
les dirigeants acceptaient
l’invitation à l’unité d’action, même sur des revendications
partielles, limitées, en provenance directe du programme réformiste
de la social-démocratie, c’était parfait : leur base
entrerait dans la lutte aux côtés des communistes, verrait que ce
que racontaient ses dirigeants sur les communistes était mensonger,
et apprendraient que c’étaient les communistes, et non les
dirigeants sociaux-démocrates, qui étaient prêts à se battre
« pour chaque miette de pain ».
Si
les dirigeants refusaient
l’invitation à la lutte, cela aussi ne pouvait que bénéficier
aux communistes – les dirigeants sociaux-démocrates prouveraient
dans la pratique que c’étaient eux
qui divisaient la classe.
Lénine
et Trotsky l’emportèrent sur leur nouvelle stratégie au Congrès
de l’Internationale. Mais en même temps, ils acceptèrent un
compromis partiel destiné à permettre à la fraction de la
direction du Comintern qui avait soutenu les
« gauchistes »
du parti allemand de « sauver la face ». Un élément
de
ce compromis était que Levi restait exclu du parti et de
l’Internationale.
Lénine
justifia cela devant Clara Zetkin en faisant observer que le ton des
attaques de Levi contre l’Action de Mars était de nature à
détourner de lui de nombreux bons communistes :
La
critique entièrement négative de Levi, qui ne faisait montre
d’aucune espèce de solidarité avec le parti et qui ont exaspéré
les camarades plus par leur ton que par leur contenu, a détourné
l’attention des aspects les plus importants du problème. (...) Une
critique sévère de l’Action de Mars était nécessaire. Mais
qu’est-ce que Levi a accompli ? Une cruelle lacération du
parti.50
Pour
Lénine, cela ne laissait pas d’autre choix que de sanctionner
Levi, même s’il espérait que celui-ci, après une période
disciplinaire de six mois hors du parti, finirait par y revenir.
Cette
partie du compromis était peut-être nécessaire. Elle était loin
d’être satisfaisante. Parce que pendant que Lénine disait à
Zetkin : « Je sais apprécier Levi et ses capacités.
(...) Il a fait ses preuves aux temps des pires
persécutions »,
Radek, un des responsables de « l’offensive »,
parlait
de Levi, dans les pages de l’organe officiel de l’Internationale,
comme d’un dilettante bourgeois et d’un lâche.51
De plus, le bureau de l’Internationale publiait des déclarations –
avec entre autres les signatures de Lénine et de Trotsky – disant
ni plus ni moins : « Levi est un traître. (...) C’est
un mensonge abominable que de prétendre que le comité exécutif ou
ses représentants ont provoqué le soulèvement de mars ».52
De
telles déclarations ne pouvaient être considérées avec indulgence
par Levi – ou, ce qui est peut-être plus important, par la section
de la direction allemande qui, connaissant la vérité, était
d’accord avec lui, pas plus qu’elles ne pouvaient préparer le
parti et ses sympathisants à faire face à la vérité si celle-ci
était révélée par ses ennemis – ce qui ne manqua pas d’arriver
lorsque le journal social-démocrate Vorwärts
mit la main sur des documents internes du parti traitant dans le
détail des « provocations » de mars.
L’autre
partie du compromis était interne au Comintern lui-même. Des thèses
conjointes furent présentées au Congrès par Zinoviev et Boukharine
d’une part, Lénine et Trotsky de l’autre, après que les deux
premiers aient consenti à la nouvelle perspective. En contre-partie,
leur soutien à la folie allemande fut dissimulé à la grande
majorité des délégués au Congrès. Les procès-verbaux du Congrès
donnent l’impression que Zinoviev, Boukharine et Radek étaient
aussi sévères envers l’Action de Mars que Lénine et Trotsky :
le débat se déroule entre tous
les cinq et la
majorité de la délégation allemande. Ce n’est pas avant la fin
des années 20 que Trotsky révéla publiquement qu’il y avait eu
deux « factions » dans la direction russe.
Le
compromis évita à Zinoviev de perdre la face, tout en permettant à
Lénine et Trotsky de gagner la grande majorité de l’Internationale
à leur « cours nouveau ». Cela semblait un faible
prix à
payer que d’abandonner une enquête sur le passé en échange d’un
contrôle sur l’avenir. Mais avec le recul du temps, on peut se
demander s’ils eurent raison. En sauvant la réputation de
Zinoviev, ils laissèrent intacte sa crédibilité dans le mouvement
communiste international – une crédibilité qui lui permit
d’orienter plusieurs autres partis vers des défaites désastreuses
au cours des quatre années qui suivirent.
Le
compromis n’empêcha même pas la direction du Comintern de
continuer à faire des dégâts en Allemagne – Zinoviev et Radek
s’entêtèrent pendant plusieurs moins à stigmatiser ceux qui
critiquaient l’Action de Mars comme le « véritable
danger ».
Lénine lui-même dut intervenir à nouveau en octobre, reprochant
sévèrement à Radek de faire « des déclarations totalement
fausses. (...) selon lesquelles Clara Zetkin « remet toute
action générale du parti jusqu’au jour où les larges masses se
soulèveront » »,
et, en fait, d’essayer « d’essayer de pousser Clara Zetkin
hors du parti ». Lénine expliquait avec insistance qu’il y
avait désormais un grave danger « d’éxagération »
dans la « lutte contre le centrisme », de
« pratiquer
le sport de la « chasse aux centristes » »,
ce qui
ne pouvait que « sauver le centrisme, renforcer sa
position ».
En
ce qui concernait Levi, Lénine admettait sans hésitation que son
infraction à la discipline l’avait mis en dehors du parti, mais se
sentait néanmoins tenu de répéter que « Levi a
raison sur l’essentiel
[souligné par Lénine] dans sa critique de l’Action de Mars
1921 ».53
Le parti allemand en ruines
En
décembre 1921, le parti de masse plein de hardiesse de douze mois
avant n’existait plus. Les machinations mal conçues de Zinoviev,
Radek et Kun ne lui avaient pas seulement coûté la moitié de ses
effectifs et son dirigeant le plus capable, elles avaient créé une
atmosphère interne de lutte fratricide.
Le
départ de Levi fut suivi par d’autres. Le
« gauchiste »
berlinois repenti Friesland devint président du parti après le
compromis du Troisième Congrès du Comintern. Mais à peine assis à
la place du conducteur, il se retrouva dans une position
essentiellement semblable à celle de Levi – il était provoqué
par ses anciens amis « gauchistes » et par le groupe
de
Zinoviev à la direction de l’Internationale. Il fut véritablement
horrifié lorsque, pour la première fois, il apprit la vérité sur
ce qui s’était passé en mars par la publication des documents
dans Vorwärts,
et se rapprocha du groupe communiste dissident de Levi. Finalement,
en janvier 1922, il fut démis de la direction du parti et quelques
jours plus tard il l'avait quitté.
La
perte d’un second président en douze mois n’était pas de nature
à renforcer la confiance des membres du parti. Des doutes et des
disputes agitèrent le parti de la tête aux pieds. D’autres
personnalités issues de la classe ouvrière partirent bientôt –
Däumig, Paul Neumann, Richard Müller, Otto Brass.
Pendant
un temps, les anciens membres continuaient à se considérer comme
faisant partie du mouvement communiste. Mais l’amertume pour la
façon dont ils avaient été traités – en particulier de la part
de Levi et de Friesland – les porta à développer une antipathie
personnelle envers le parti, sa direction et la plus grande partie du
Comintern. Levi remit bientôt en question de nombreuses positions
pour lesquelles il s’était battu en deux années de direction du
parti et obliqua vers l’aile gauche de la social-démocratie.
Friesland alla plus loin, et, sous le nom de Reuter, devint dirigeant
social-démocrate et maire de Berlin-Ouest.
Il
y eut une deuxième conséquence, à de nombreux égards plus
sérieuse que la perte même de nombreux dirigeants. Dans
l’atmosphère factionnelle, ceux qui prospéraient étaient ceux
pour lesquels l’intrigue et la rhétorique étaient des substituts
à la pensée politique. Les deux jeunes intellectuels berlinois,
Ruth Fischer et Arkadi Maslow, se délectaient du sectarisme ambiant,
« jouant à la chasse au centrisme ». Eloquents et
énergiques, ils parvinrent à regrouper autour d’eux beaucoup de
nouveaux, des travailleurs qui étaient passés des Indépendants au
parti – malgré leur nullité au delà d’une compréhension plus
que sommaire du marxisme.
Ils
firent cela en répétant sans cesse que la nouvelle direction
repentante du parti était « molle »,
« centriste »
et « réformiste ». « L’offensive »,
disaient-ils, était la seule méthode communiste correcte. « Un
parti sur la défensive », proclamait Maslow, « est un
parti social-démocrate. S'il veut être un parti communiste, il lui
faut être offensif. ».54
Le ton de Fischer était le même : « Un parti de
500 000
membres qui ne combat pas ne peut que devenir un bourbier, et c'est
ce qu'il était déjà devenu ».
Si
le KPD avait eu une direction ferme et confiante, ceux qui
proféraient de telles inepties auraient, soit appris l’humilité,
soit pris la porte. Mais dans le chaos politique et le factionisme
engendrés par l’Action de Mars, Fischer et Maslow purent gagner
l’allégeance de près de la moitié du parti.
La
conséquence finale de la folie de mars était la moins quantifiable,
mais probablement la plus dévastatrice dans son impact.
La
démence avait pris possession de certains des éléments les plus
compétents du parti – Brandler, qui avait construit le district
ouvrier le plus achevé ; Thalheimer, le théoricien du
parti ;
Frölich, journaliste et polémiste de grand talent ; Ernst
Meyer, son nouveau président ; Radek, le lien avec
l’Internationale. Une fois qu’ils eurent compris leur erreur, ils
perdirent toute confiance dans leur propre jugement politique. Dans
l’avenir, ils hésiteraient avant de se décider à l’action –
en particulier pour une action qui impliquerait les travailleurs en
armes. Et dans la politique révolutionnaire, comme à la guerre,
l’hésitation peut être fatale.
Nous
pouvons apercevoir maintenant la réponse à notre première
question : pourquoi la folie de mars s’est-elle
produite ?
La plupart des dirigeants du parti manquaient de confiance dans leur
propre jugement après les désastres de 1919 et de 1920. Ils
regardaient les délégués de Russie comme les porteurs omniscients
de la stratégie et de la tactique révolutionnaires – même si le
fait de venir de Moscou ne rendait pas un Kun, un Radek ou même un
Zinoviev plus compétent que les dirigeants allemands : seuls
Lénine et Trotsky pouvaient prétendre à cette distinction – et
eux aussi se trompaient souvent.
S’il
y avait eu un parti avec de nombreuses années de lutte commune, au
lieu de quelques mois seulement, les dirigeants allemands auraient
été suffisamment sûrs d’eux-mêmes pour envoyer Kun (et Zinoviev
si nécessaire) faire ses bagages. L’absence d’un embryon de
parti avait mené aux défaites de 1919 et aux erreurs de 1920 ;
celles-ci, à leur tour, provoquèrent un manque d’assurance qui
fut près de détruire le parti de masse une fois qu’il vit le
jour ; et l’amère expérience de l’Action de Mars devait
miner encore plus la confiance de la direction et mener à de
nouveaux désastres.