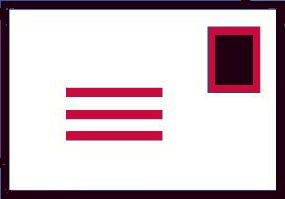Les
symboles des premiers jours de la révolution furent ceux du
socialisme révolutionnaire – les drapeaux rouges, le chant de
l’Internationale,
la formation de conseils d’ouvriers et de soldats dans tout le
pays. La vieille structure politique s’était désintégrée – et
ses symboles avaient provisoirement disparu. Les partis politiques
bourgeois étaient dans une crise profonde, leurs dirigeants se
demandant comment ils pouvaient sauver quelque chose. Ils savaient
que leur unique salut reposait sur ces sociaux-démocrates qu’ils
avaient tant méprisés dans le passé.
Les
sociaux-démocrates avaient la moitié des sièges au gouvernement.
Mais pour les obtenir ils avaient dû user de slogans d’extrême
gauche. Deux jours après la révolution, Scheidemann était
découragé : « Oui,
les Indépendants ont le pouvoir maintenant »,
déclarait-il au journaliste berlinois Theodor Wolff, « Je
n’ai pas de soldats ».
Le collègue « commissaire » de Scheidemann,
Landsberg,
ajoutait : « Nous
sommes dans une situation impossible. Haase est beaucoup plus fort
que nous. Si les choses continuent ainsi, nous n’aurons pas d’autre
choix que de démissionner ».1
Etre
au gouvernement ne servait à rien s’il ne pouvait commander ceux
qui avaient la force armée. Dans le passé, c’étaient les
officiers, mais leur autorité se désintégrait à grande vitesse.
Dès le premier jour de la révolution à Berlin les symboles de
l’autorité militaire furent déchirés :
A travers la masse compacte de
la foule
en marche des camions militaires se frayaient un chemin, pleins à
déborder de soldats et de marins qui agitaient des drapeaux rouges
et poussaient des cris féroces. (...)
Ces voitures, remplies de jeunes gens en uniforme ou en civil,
portant des fusils chargés ou des petits drapeaux rouges, me
semblèrent caractéristiques. Ces jeunes hommes quittaient
constamment leur place pour forcer des officiers ou des soldats à
arracher leurs galons…2
La mosaïque du pouvoir ouvrier
Les
soldats du rang étaient dégoûtés de la guerre, des épreuves, de
la discipline militaire, de leurs misérables rations quand leurs
officiers se gobergeaient. Ils décidèrent que les officiers
devaient écouter leurs hommes maintenant. Partout, ils mirent en
place des conseils de soldats.
Durant les journées de
novembre, des
conseils de soldats apparurent spontanément non seulement dans
toutes les plus grande villes allemandes, mais aussi dans les armées
en campagne en Belgique et en France, de même qu’en Russie.3
A Bruxelles, un centre de
communications
d’une importance vitale pour la retraite de la France et de la
Belgique occupées, un conseil de soldats fut constitué le 10
novembre et prit le contrôle de toute autorité, militaire et
civile, à la place du gouvernement. (...) A Malines, le même jour
un conseil de soldats de 20 membres, parmi lesquels deux lieutenants,
fut élu pour la IVème Armée. Il publia une
proclamation
qui abolissait le mess des officiers séparé et le devoir de saluer
lorsqu’on n’était pas en service. (...) En Pologne occupée, le
conseil de soldats élu à Grodno proclama le 12 novembre qu’il
prenait le commandement dans le gouvernement de Lituanie du Sud.4
En
Allemagne même, l’armée avait tendance à être beaucoup plus
radicale qu’au front. Elle avait eu un contact plus étroit avec la
classe ouvrière organisée et beaucoup plus d’occasions de parler
politique. Dans un centre industriel après l’autre, les conseils
de soldats se joignaient aux conseils ouvriers et ils désignaient
leurs dirigeants élus comme responsables des gouvernements d’Etat
ou de ville.
A
Cologne, par exemple, un conseil constitué en parts égales de
délégués de travailleurs et de soldats établit des sous-comités
pour la sécurité, le ravitaillement et le logement, la
démobilisation, la presse, l’hygiène et les transports. Les
membres du conseil jouaient un rôle de supervision auprès du maire
(qui devait plus tard devenir chancelier d’Allemagne de l’Ouest,
Konrad Adenauer), les chemins de fer, la poste et le télégraphe, la
police, les tribunaux, la banque nationale et le commandement
militaire.5
Dans
un certain nombre d’endroits le nouveau conseil ouvrier qui prenait
en charge le gouvernement local reconnaissait à peine le
gouvernement d’Ebert à Berlin. En Saxe, les conseils d’ouvriers
et de soldats de Dresde, Leipzig et Chemnitz se réunirent et
annoncèrent que le prolétariat révolutionnaire prenait le pouvoir
pour abolir l’exploitation capitaliste. Le vieux gouvernement de
Saxe fut remplacé par un gouvernement socialiste de coalition, avec
la plupart des postes importants aux mains des Indépendants. Dans le
petit Etat de Brunswick, une gouvernement socialiste radical fut
également formé.
Le
plus significatif des gouvernements des conseils
« autonomes »
se trouvait dans le second Etat d’Allemagne, en Bavière. Le
nouveau premier ministre, le social démocrate indépendant Eisner,
négocia même avec les puissances étrangères indépendamment de
Berlin. La Bavière avait depuis longtemps des aspirations
séparatistes.
Dans
l’armée, les choses furent encore plus accidentelles. Jusqu’au 9
novembre les discussions dans les casernes ou dans les tranchées
devaient être secrètes. Manquant d’expérience, les soldats ne
pouvaient pas savoir qui pouvait assurer une direction digne de
confiance à leurs camarades, ou qui était simplement intéressé ou
bien fou furieux. Les soldats tendaient à se tourner vers ceux qui
étaient les plus francs ou qui parlaient le mieux, pourvu qu’ils
promissent la paix, un retour rapide dans les foyers, un meilleur
ordinaire et la fin de la discipline militaire. De telle sorte que
dans un centre militaire important les conseils pouvaient être tenus
par des sociaux-démocrates majoritaires, dans un autre par des
spartakistes, dans un troisième par des démagogues ou des
aventuriers, ou ailleurs par l’officier le plus sympathique. Il y a
même eu des cas où les soldats élisaient leurs commandants au
conseil, et où des conseils de soldats désignaient des politiciens
bourgeois pour diriger les villes.
A
Berlin, les ouvriers des grandes usines tendaient à s’aligner sur
les indépendants, comme l’admet l’historien pro-SPD Landauer.6
Mais cela était compensé par l’équilibre des pouvoirs dans
l’armée ; la plupart des soldats de retour du front
sympathisaient au début avec les sociaux-démocrates majoritaires –
comme le montre l’assemblée des délégués du Cirque Busch.
Le vieux Parti
Social-Démocrate s'était
lamentablement ratatiné dans les grandes villes, et les Indépendants
avaient l’avantage presque partout. Mais les hommes de confiance du
SPD pouvaient utiliser les promesses du gouvernement pour influencer
les masses peu politisées, inactives et arriérées et ce sont eux
qui donnaient le ton. Ce sont surtout les conseils de soldats qui
venaient à leur aide. Les conseils ouvriers représentaient
fidèlement la classe, mais dans la masse hétérogène et confuse
des soldats, les beaux parleurs de la classe moyenne venaient au
premier plan – des employés, des intellectuels, des sous-officiers
et même des officiers, pour l’essentiel des socialistes de
novembre frais émoulus, qui parlaient un charabia politique et qui
agissaient toujours selon leurs intérêts de classe bourgeois.7
Mais
une armée en décomposition ne reste pas figée dans ses attitudes.
Les soldats qui rompaient avec la vieille discipline commençaient
bientôt à rompre aussi avec les anciennes façons de penser. Une
polarisation politique rapide commença à prendre place. Les comités
de soldats dominés par les sociaux-démocrates ne firent pas
longtemps la loi dans les casernes des grandes villes. Et un grand
nombre de soldats avaient abandonné les casernes, emportant leurs
fusils avec eux. Ils se rendirent rapidement compte qu’ils ne
pouvaient pas trouver du travail. La faim et la colère les
radicalisaient, et à Berlin ils se massaient derrière les
manifestations conduites par Karl Liebknecht et la Ligue des Soldats
Rouges.
A
la question « Qui dirige l’Allemagne ? », il
ne
pouvait y avoir à l’évidence qu’une seule réponse : les
conseils. Mais ils ne reflétaient qu’à moitié les aspirations
confuses, peu mûries et changeantes des masses armées qui
contrôlaient les casernes et les rues. Et ils n’étaient
certainement pas organisés en un système coordonné permettant de
diriger le pays sur de nouvelles bases. Il y avait au contraire tout
un patchwork de différents conseils, avec des pouvoirs différents,
poursuivant des buts dissemblables et présentant des degrés variés
d’allégeance envers le gouvernement Ebert – qui était lui-même
à moitié au service du vieil ordre impérial et à moitié soumis à
l’exécutif berlinois de la révolution.
Les
sociaux-démocrates ne pouvaient ignorer le pouvoir dont disposait
cette mosaïque de conseils. Ils essayèrent de prendre le contrôle
du mouvement dans le but de détruire son pouvoir. Cela signifiait en
partie utiliser les conseils de soldats contre les conseils
d’ouvriers – ce qui pouvait aller jusqu’à des affrontements
armés entre l’armée en retraite et les travailleurs locaux. Il
jugeaient également important d’empêcher l’humeur changeante
des masses de se refléter dans les conseils. Les permanents
sociaux-démocrates élus aux conseils dans l’euphorie du 9
novembre refusèrent d’organiser de nouvelles élections en
décembre et en janvier. Si l’attitude des travailleurs ne pouvait
être stabilisée dans une période de soulèvement révolutionnaire,
par contre celle des conseils pouvait l’être.
Le
Congrès National des Conseils d’Ouvriers et de Soldats, tenu à la
mi-décembre, était une assemblée de ceux qui exerçaient
localement le pouvoir révolutionnaire dans tout le pays. Mais ce fut
surtout une assemblée de ceux dont la préoccupation principale
était de détruire la base révolutionnaire du pouvoir. Sur les 499
délégués, seulement 179 étaient des travailleurs manuels ou des
employés, 71 étaient des intellectuels, alors que pas moins de 164
étaient journalistes, députés, responsables syndicaux ou
dirigeants sociaux-démocrates, ou membres des professions libérales.
Il n’était pas surprenant qu’une majorité massive de 288
délégués fût favorable aux Sociaux-Démocrates, contre 90 pour
les Indépendants et 21 pour la gauche révolutionnaire. Ceux qui
appelaient le plus fortement à l’établissement du pouvoir des
travailleurs, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, ne furent même pas
admis dans la salle.
L’autre pouvoir
Les
dirigeants sociaux-démocrates étaient assez observateurs pour voir
qu’avec le temps la base de l’armée se radicalisait, mettant en
danger leur base de pouvoir dans son sein. Dès le premier jour de la
révolution ils se mirent en quête d’un autre type de soutien. Ils
s’assurèrent que des « experts » conservateurs,
« responsables », étaient nommés assistants auprès
des
« commissaires du Peuple ». Ils utilisèrent ces
derniers
pour éviter le démantèlement de la machine administrative qui
avait gouverné l’Allemagne sous le Kaiser.
Comme
l’écrivit un historien – loin d’être révolutionnaire – du
mouvement des conseils :
Ce qui a le moins changé,
c’est
l’appareil bureaucratique qui gouverne la Prusse depuis des
siècles. Cette machine, créée par les Hohenzollern, les a servis
loyalement et avec dévotion. La grande majorité des hauts
fonctionnaires qui administraient le pays, de même que les juges,
commissaires de police et professeurs du secondaire, était fermement
conservatrice et monarchiste, les dissidents ayant été
soigneusement éliminés. (...) Ils sont émotionnellement liés à
l’ordre ancien, et non au nouveau gouvernement et à la république.
(...)
Il y
eut une scène, restée fameuse, à l’occasion d’une réunion
cabinet, lorsque le Dr Solf, qui restait sous-secrétaire d’Etat
aux Affaires Étrangères, refusa de serrer la main de Haase au motif
que ce dernier aurait reçu de l’or des Russes pour son parti avant
la révolution. Non seulement Solf restait en fonctions, mais
également les secrétaires dans les ministères de la Justice, des
Finances, du Travail, des Postes et Télégraphes, le secrétaire de
la Marine et le ministre prussien de la Guerre, le général Scheuch,
même si les sociaux-démocrates avaient au début parlé de le
limoger.8
Cela
dit, la machine bureaucratique ne pouvait fonctionner que si en
dernier ressort elle disposait de la force armée, qui sous l’empire
était sous les ordres du Haut Commandement des Forces Armées
Impériales. C’était vers lui que louchaient les
sociaux-démocrates, désireux qu’il fasse pour eux ce qu’il
avait fait pour le Kaiser.
Le
second jour de la révolution à Berlin, le 10 novembre, Ebert avait
été confirmé au pouvoir par une réunion tumultueuse des délégués
des conseils d’ouvriers et de soldats au Cirque Busch. Peu de temps
après, il fut confirmé au pouvoir d’une façon complètement
différente. Il reçu un appel téléphonique du général Groener,
qui lui annonça que le Haut Commandement Impérial reconnaissait le
gouvernement.
« Qu’attendez-vous
de nous ? », demanda Ebert.
« Le
Maréchal Hindenburg attend du gouvernement qu’il soutienne le
corps des officiers en maintenant une discipline et un ordre stricts
dans l’armée. »
« Quoi
d’autre ? »
« Le
corps des officiers attend du gouvernement qu’il combatte le
bolchevisme, et se tienne à la disposition du gouvernement pour
cela. »
Ebert demanda à Groener de
« transmettre
au Maréchal les remerciements du gouvernement. »9
Hindenburg
avait exercé une dictature militaire virtuelle pendant les deux
dernières années de la guerre. Et là, Ebert lui garantissait, à
lui et à la vieille caste des officiers, le contrôle des forces
armées, qu’ils devaient utiliser quatorze ans plus tard pour
installer Hitler au pouvoir.
Ebert
fut aidé par l’empressement des sociaux démocrates indépendants
à valider cette politique. L’un d’entre eux, Dittmann, écrivit
plus tard : « Mon
consentement à remettre la direction de l’armée à l’ancien
commandement était acquis d’avance ».10
Même le plus à gauche des « commissaires »
indépendants, Barth, contresigna un ordre mettant les troupes sous
le commandement des officiers et limitant les conseils de soldats à
un rôle consultatif.
Ainsi,
les sociaux-démocrates de gauche et de droite collaboraient pour
donner le monopole de la force armée à des hommes qui non seulement
haïssaient le « bolchevisme », mais tout parti, aussi
« modéré » soit-il, menaçant leurs privilèges
séculaires. Ces hommes utiliseraient cette force pour renverser la
donne du 9 Novembre et, au bout du compte, à offrir le pouvoir à un
dictateur déterminé à détruire la social-démocratie.
L’armée du front
Pour
l’instant, cependant, l’accord que le Haut Commandement avait
obtenu des deux ailes de la social-démocratie n’était qu’un
chiffon de papier. Il devait être traduit en action. Le Haut
Commandement devait trouver des combattants prêts à l’exécuter.
Au
début, ils pensaient pouvoir se fier à l’ancienne armée de
campagne. Les troupes en retraite du front semblaient beaucoup plus
disciplinées que celles cantonnées dans les villes, et leurs
conseils étaient beaucoup plus à droite. Il semblait très facile
de les faire marcher contre les travailleurs en armes des villes.
A
l’occasion d’autres conversations téléphoniques avec Groener,
Ebert put donner à ce plan sa complète approbation. « Un
plan fut conçu »,
disait Groener devant un tribunal huit ans plus tard :
Dix divisions devaient marcher
sur
Berlin. Ebert était d'accord. (...) Les Indépendants avaient
demandé que les troupes entrent sans munitions. Ebert était
d'accord pour qu’elles soient équipées de balles réelles. Nous
élaborâmes un programme qui prévoyait après l'entrée un
nettoyage de Berlin et le désarmement des spartakistes. (...) Cette
alliance a été conlue contre le danger des bolcheviks et le système
des conseils.11
Mais
Ebert et Groener devaient être déçus. La
« discipline »
de l’armée de campagne dura seulement jusqu'à qu'elle ait
accompli sa retraite en deçà de la frontière allemande. Puis elle
commença à tomber en ruines. Même les divisions de soldats engagés
se décomposaient. Ils avaient accepté la discipline parce qu’ils
voulaient rentrer chez eux le plus vite possible. Maintenant, ils
commençaient à écouter les agitateurs « bolcheviks ».
Les troupes « sûres » abandonnaient bientôt les
casernes, refusaient de saluer les officiers et couraient participer
aux manifestations organisées par la Ligue des Soldats Rouges.
Le
plan échoua. Le seul Indépendant de gauche du gouvernement, Barth,
réussit à monter à la tribune. Il semble avoir regretté son
acceptation de l’appel à la « discipline » du
gouvernement. Il dit aux soldats que les officiers les trompaient.
Les soldats l’écoutèrent. Ils étaient prêts à accepter la
propagande contre les « bolcheviks subversifs » en
termes
généraux – et à voter pour des élections à l’Assemblée
Nationale ainsi que pour une interdiction des grèves dans les
« services essentiels »- mais ils n’étaient pas
disposés à revenir au vieux système d’obéissance aveugle à une
caste privilégiée d’officiers. Ils votèrent pour l’abolition
de toute marque extérieure de grade et pour la réélection des
conseils de soldats.
Les
soldats du rang en avaient assez de la discipline militaire. Pour
beaucoup, le plus important était de retourner à la vie civile dès
que possible. Chaque tentative de la part des officiers ou des
dirigeants sociaux-démocrates de les soumettre à la discipline ne
faisait que les radicaliser davantage. La marche de l’armée du
front sur Berlin ressemblait davantage à un morceau de sucre plongé
dans de l’eau chaude qu’à un couteau planté dans du beurre. Les
unités disciplinés se fondirent dans la masse des silhouettes vert
de gris hagardes, affamées et grelottantes, qui peuplaient les rues.
Dans
la première semaine de décembre, il y eut une tentative directe
d’utiliser l’armée contre la révolution. La presse bourgeoise
lança une campagne hystérique contre la gauche, prétendant que les
puissances alliées avaient fait savoir au gouvernement allemand
qu’aucune livraison de nourriture ne serait faite à leur pays
affamé tant que les conseils d’ouvriers et de soldats n’auraient
pas été dissous. Des milliers d’affiches
« anti-bolcheviks »
commencèrent à apparaître, avec des messages tels que « Tuez
Liebknecht ».12
Le
5 décembre, un meeting de sous-officiers se porta en manifestation
au bureau du chancelier, où ils dirent à Ebert qu’ils étaient
prêts pour le mot d’ordre « faire
face à un coup d’Etat de Liebknecht ou de ses camarades ».
Le
lendemain des troupes de diverses casernes marchèrent sur le
Reichstag. On leur avait dit que l’Exécutif des Conseils de Berlin
avait détourné 2,5 millions de marks, et elles arrêtèrent leurs
membres. D’autres troupes marchèrent sur la Chancellerie où elles
appelèrent à la dissolution du Comité Exécutif et à la
désignation d’Ebert comme président avec les pleins pouvoirs.
Ebert
ne dit ni oui ni non. Il se borna à déclarer qu’il devait
consulter ses « collègues ». Il n’était pas disposé
à soutenir une entreprise militaire dont l’issue était
incertaine ; mais il n’était pas non plus prêt à la
désavouer.13
Le
coup d’Etat échoua. Les troupes qui y étaient engagées n’avaient
pas une claire conscience des buts de leur lutte, et leurs chefs
n’avaient pas de plan détaillé pour la prise du pouvoir. Elles
supposaient qu’une fois qu’elles seraient en mouvement, les
choses se mettraient en place d’elles-mêmes. Mais les hésitations
d’Ebert donnèrent un coup d’arrêt à l’opération. Après
avoir contrôlé le centre de Berlin, les soldats retournèrent tout
simplement dans leurs casernes. Mais après que 200 d’entre eux
aient ouvert le feu avec des mitrailleuses contre une manifestation
spartakiste, faisant 18 morts.
La
conséquence immédiate de cette tentative de coup d’Etat fut de
radicaliser Berlin plus encore. Les agitateurs les plus
réactionnaires de la garnison étaient compromis. Les soldats qui
les avaient suivis le 6 décembre commencèrent à se poser des
questions. L’une des unités engagées dans l’action – la
Division de Marine – était, à la fin du mois, au centre de la
désaffection vis à vis du gouvernement.
Les nouvelles forces de défense
L’armée
était visiblement en train de se désintégrer. Quiconque voulait
contrôler Berlin devait chercher ailleurs.
La
gauche révolutionnaire avait appelé, au début de la révolution, à
la formation d’une « Garde Rouge » pour maintenir
l’ordre et empêcher toute tentative de contre-révolution. Cela
avait été décidé par l’Exécutif des Conseils de Berlin le 12
novembre, mais le plan avait été abandonné sous la pression de la
droite du gouvernement. La gauche révolutionnaire gardait cependant
le contrôle de la Force de Sécurité que l’indépendant de gauche
Eichhorn avait constituée au sein de la Kommandantur de la police.
Les deux tiers de ses membres étaient des volontaires
révolutionnaires, l’autre tiers des policiers.
Les
Sociaux-Démocrates Majoritaires entreprirent de contrer cette force
– et de désamorcer tout nouvel appel à la constitution de Gardes
Rouges. Ils commencèrent à recruter leur propre Corps de Soldats
Républicains à partir de leurs sympathisants dans l’armée en
désintégration. Les premiers pas avaient été faits par Noske
lorsqu’il était en charge à Kiel. Il avait choisi 3 000
marins qui lui étaient loyaux et les avait envoyés à Berlin. Il
pensait que cette « Division de Marine du Peuple »
donnerait au gouvernement social-démocrate le soutien armé dont il
avait besoin. Retranchée dans le palais impérial, le Schloss,
sous le commandement d’un vieux monarchiste, Wolff Metternich, elle
semblait en effet garantir au gouvernement toute protection contre le
retour de troubles révolutionnaires.
Mais
après leur engagement dans le coup d’Etat avorté du 6 décembre,
les arguments des travailleurs de gauche de Berlin commencèrent à
les influencer. Un grand nombre d’entre eux déserta, rentrant dans
ses foyers, et le reste suivit un révolutionnaire, l’ancien
lieutenant Dorrenbach.
Le
ministre prussien de l’Intérieur, le social-démocrate Wels, et
son gouverneur militaire de Berlin, Anton Fischer, constituèrent le
Corps des Soldats Républicains comme seconde force, financée par
des dons des grands patrons, dans l’espoir qu’il pourrait
remplacer leur premier instrument, désormais inutilisable. Comme
Fischer l’écrivit plus tard : « Déjà,
le 17 novembre, Wels et moi-même avions commencé à constituer une
force armée qui serait sûre jusqu’à un certain point ».
Le problème était d’ordre financier. Mais il fut résolu par un
« certain
étranger » qui
(…) « disait
qu'il pensait que tout Berlin était intéressé au rétablissement
de l’ordre et [qui]
offrit
à Wels son
assistance financière.
(...) Lorsque
l’argent
arriva, Wels, Colin Ross [plus
tard un partisan de Hitler],
Striemer et moi allâmes dans les casernes recruter les meilleurs
éléments. »14
Le
Corps des Soldats Républicains fut bientôt engagé dans des
affrontements avec la gauche révolutionnaire, qui laissaient souvent
des morts sur le pavé. Mais à terme il finit lui aussi par donner
des migraines aux ministres sociaux-démocrates majoritaires. Ses
membres étaient, dans l’ensemble, des sociaux-démocrates plutôt
conservateurs, qui n’aimaient pas le comportement apparemment
« désordonné » des spartakistes. Ils avaient
tendance,
du moins dans les premiers mois de la révolution, à croire aux
promesses du gouvernement selon lesquelles l’avènement du
« socialisme » se ferait dans
« l’ordre »
et la « discipline ». Mais ils ne voulaient pas du
capitalisme. Ils avaient assez souffert sous l’ordre ancien pour ne
pas vouloir son retour.
Les
dirigeants sociaux-démocrates, au contraire, avaient passé un
accord avec le Haut Commandement militaire et les vieux bureaucrates
impériaux – des hommes pour lesquels l’ancien régime était
sacro-saint et devait être restauré le plus tôt possible. Cet
accord exigeait du gouvernement des choses qui étaient peu
compatibles avec toute notion de « marche vers le
socialisme ».
Et comme le Corps des Soldats Républicains devait imposer par la
force l’obéissance à une telle politique, les premiers murmures
vinrent de ses rangs. Comme devait le dire plus tard son commandant,
Fischer, il devenait « chaque
jour un facteur de moins en moins sûr ».15
Aucune
force issue des rangs de l’ancienne armée ne pouvait être
« sûre » pour le Haut Commandement, Ebert, Noske et
leurs amis. Ils durent au contraire créer ce qui devint connu sous
le nom de Freikorps
ou de Gardes Noske.
Les Freikorps
Il
y avait dans l’armée des couches qui n’étaient absolument pas
attirées par la révolution. C’étaient les dizaines de milliers
d’officiers qui s’identifiaient avec la classe dirigeante et
n’avaient rien à gagner à la démobilisation. Il y avait aussi un
certain nombre de soldats privilégiés et hautement entraînés –
appelés les troupes d’assaut – qui n’avaient pas souffert des
rigueurs de la discipline, des corvées et de la mauvaise nourriture
comme la masse de l’armée. Ils étaient liés à la fois par un
ensemble de privilèges et par la camaraderie du combat. Ils
risquaient de perdre tout cela s’ils étaient démobilisés – et
saisirent la chance de gagner un salaire en se battant contre
« les
rouges ».
Le
22 décembre, le gouvernement social-démocrate désigna un des
généraux de l’empire, Märcher, pour organiser ces officiers et
ces troupes d’assaut en une force mercenaire grassement payée, les
Freikorps.
« La
plupart des dirigeants étaient monarchistes d’esprit. Ceux dont on
remarquait l’absence étaient les travailleurs modérés
organisés ».16
Après avoir vu défiler les Freikorps, l’historien conservateur
Meinecke pouvait commenter : « C’était
comme si l’ordre ancien ressuscitait ».
Lorsqu’il
vit parader ces troupes le 4 janvier, Noske se tourna vers Ebert et
lui
dit :
« Sois tranquille : à présent tu vas voir que la roue
va
tourner ! »
Les premiers affrontements
A
Berlin les mois de novembre et de décembre furent marqués par une
radicalisation croissante, en particulier parmi certaines sections de
soldats et dans la multitude des anciens soldats désormais au
chômage. Les manifestations quotidiennes de la Ligue des Soldats
Rouges attiraient de plus en plus de monde. Comme le rapporte un
témoin hostile :
Le mouvement spartakiste, qui
influençait
aussi une partie des Indépendants, réussissait à attirer une
fraction des ouvriers et des soldats (...) et à les maintenir dans
un état d’excitation permanente, mais il restait sans influence
sur la grande masse du prolétariat allemand. Les meetings,
processions et manifestations quotidiens auxquels Berlin assista en
novembre et en décembre 1918 faisaient croire au public et aux
leaders spartakistes qu’ils étaient suivis dans cette direction
intransigeant, ce qui n’était pas le cas en réalité.17
Nous
avons vu comment la droite avait réagi à cela – les officiers
essayèrent de lancer la garnison contre la gauche le 6 décembre –
et comment la presse social-démocrate avait ajouté à l’hystérie
en accusant les spartakistes de « fomenter
un coup d’Etat ».
Le but était d’isoler et de briser la gauche révolutionnaire
avant que la majorité des travailleurs moins mobilisés ne se rende
compte que le gouvernement se préparait à détruire les acquis du 9
Novembre. Mais les choses ne devaient pas se passer comme prévu.
L’idée
se répandait parmi les masses que les socialistes de droite avaient
vendu la révolution à la réaction, que les Indépendants au
gouvernement se laissaient mener par le licou et que les travailleurs
révolutionnaires seraient obligés de passer à l’action. Ces
sentiments s’exprimèrent avec force lors du meeting de
protestation du 8 décembre. La manifestation spartakiste attira une
large foule : trente mille ouvriers et soldats défilèrent ce
jour-là dans la ville, sous la direction de Liebknecht. Plusieurs
camions de soldats furent désarmés par les manifestants.18
Le
journal spartakiste, Die
Rote Fahne, revendiqua
150 000 participants à cette manifestation – et
250 000
à une autre une semaine plus tard, lors de la réunion du Congrès
National des Conseils à Berlin. Le Congrès ne reprit pas les
revendications de la manifestation, et, comme nous l’avons vu,
consentit à transmettre ses pouvoirs à une assemblée
parlementaire, mais il ne pouvait pas négliger les pressions de la
garnison de Berlin hostile à tout retour à une armée à
l’ancienne. Après avoir entendu un rapport de Dorrenbach au nom
des unités de la garnison, elle adopta une résolution proposée par
Hambourg qui appelait à l’abolition des signes extérieurs de
grade, à l’élection des officiers, au contrôle de la discipline
par les conseils de soldats et au remplacement rapide de l’armée
régulière par une « armée populaire » basée sur une
milice.
Mais
la plus importante rebuffade que devait connaître le gouvernement se
produisit à Noël. La Division de Marine du Peuple était toujours
stationnée dans le palais impérial, au cœur des édifices
gouvernementaux de Berlin. Le gouvernement, qui craignait que cette
force, destinée à le protéger de la révolution, ne se retourne
contre lui au nom de la révolution, tenta de la contraindre à se
disperser en bloquant sa solde. Les marins en colère réagirent le
23 décembre en se saisissant du dirigeant social-démocrate prussien
Wels. Il ne serait relâché, insistaient-ils, que lorsqu’ils
toucheraient leur solde.
Le
gouvernement prit prétexte de cette action pour attaquer la
division. Le jour suivant, il lança à l’assaut les Gardes Montés,
apparemment dignes de confiance, commandés par le général Lequis
et basés hors de Berlin à l’abri de son atmosphère subversive.
Un officier adressa aux marin l’ultimatum suivant : S’ils ne
déposaient pas les armes et ne se rendaient pas dans les deux
heures, il ouvrirait le feu de l’artillerie. En fait, le
bombardement commença avant même que le délai ne soit écoulé.
Pendant
ce temps, des groupes de civils s’étaient joints au combat,
membres de la Ligue Spartakiste et d’autres organisations – ainsi
que des sections de la Force de Sécurité d’Eichhorn et du Corps
de Soldats Républicains qui, eux aussi, soutenaient les marins. Et
surtout, des femmes de la classe ouvrière, ignorant le danger,
avaient infiltré les rangs des Gardes et leur expliquaient
l’indignité qui était en train de se commettre. Cela brisa la
cohésion des assiégeants. Les Gardes jetèrent leurs fusils et
arrêtèrent leurs officiers. A midi, la victoire des marins était
complète. Le combat avait fait 11 morts du côté des marins et 56
du côté des Gardes.19
L’emprise
des sociaux-démocrates majoritaires sur Berlin se décomposait à
grande vitesse. Les détachements spéciaux qu’ils avaient
constitués dans la ville étaient passés du côté des marins
contre le gouvernement. L’Exécutif des Conseils dominé par les
sociaux-démocrates condamna l’attaque contre la Division de
Marine. Les sociaux-démocrates ne disposaient même pas des forces
qui leur auraient permis d’empêcher que les locaux de leur
journal, Vorwärts,
ne soient saisis cette nuit-là par des milliers de révolutionnaires.
Leur
isolement s’aggrava les jours suivants lorsque les ministres
indépendants quittèrent le gouvernement. Ils avaient assisté
impuissants aux combats de Noël et à la collusion d’Ebert et de
Lequis. Ils ne pouvaient pas se permettre d’être davantage
compromis, de peur de perdre leur soutien à Berlin.
Dans
une couche de plus en plus large de travailleurs, de soldats et de
chômeurs de la capitale régnait le sentiment que le gouvernement
était désemparé, qu’avec un petit effort ils pouvaient rallumer
un mouvement comme celui du 9 novembre et remplacer ce gouvernement
par un autre de leur choix. Mais le gouvernement s’apprêtait déjà
à utiliser une autre arme, celle des détachements de Freikorps qui
se rassemblaient hors de Berlin. Et ses opposants avaient une grande
faiblesse dont il pouvait profiter – leur extrême désorganisation.
La fondation du Parti Communiste
Dans
la situation révolutionnaire qui se développait rapidement, la
gauche souffrait d’une grave carence – il n’y avait pas de
parti révolutionnaire puissant, capable d’unir les soldats
révolutionnaires et les ouvriers armés en une force basée sur
l’acceptation volontaire d’une discipline commune. La Ligue
Spartakiste, avec ses 3 000 membres environ, de même que le
parti de gauche radicale plus petit, les Communistes Internationaux,
étaient noyés dans un grand nombre de travailleurs et de soldats
qui croyaient que leur enthousiasme personnel pouvait agir comme un
substitut à la stratégie et à la tactique.
Pierre
Broué, l’historien français de la révolution, exagère sans
doute un peu, mais son récit contient un très important élément
de vérité :
Liebknecht,
agitateur infatigable, prend la parole partout où les idées
révolutionnaires peuvent rencontrer un écho. Des colonnes entières
du mince Die
Rote Fahne
sont consacrées à des convocations, des appels, pour des réunions,
meetings, manifestations, défilés de soldats, chômeurs,
déserteurs, permissionnaires. Or ces manifestations, que le noyau
spartakiste n'a pas la force ni sans doute le désir de contrôler,
sont souvent l'occasion, pour les éléments douteux qu'elles
entraînent, de violences ou d'incidents inutiles et même nuisibles.
(...) Liebknecht peut avoir l'impression qu'il est, par les foules
qui l'acclament, le maître de la rue, alors que, faute d'une
organisation authentique,
il n'est même pas maître de ses propres troupes (...). A
ces
hommes impatients et durs qui sortent de la guerre, il n'est pas
question de faire des conférences ni des cours de «
théorie » :
il faut des mots d'ordre clairs, précis, enthousiasmants, il faut de
l'action.20
En
fait, le Spartakusbund
lui-même n’était pas vraiment une force cohérente, malgré sa
petite taille. Comme l’a décrit Paul Frölich : « La
Ligue Spartakus était encore rudimentaire, et était faite
essentiellement d’innombrables groupes, petits et autonomes,
dispersés dans tout le pays ».
C’était « une
organisation informe qui ne comptait que quelques milliers de
membres ».
Un
biographe de Rosa Luxemburg rapporte que
Sur le plan de l’organisation
Spartakus
était lent à se développer. (...) Dans les plus grandes villes, il
ne constitua un centre organisé qu’au cours du mois de décembre
et, dans de nombreux cas, pas avant février ou mars 1919. (...) Des
tentatives pour mettre en place des réunions de sympathisants
spartakistes dans le Conseil des Ouvriers et des Soldats de Berlin ne
produisirent aucun résultat satisfaisant et une tendance communiste
indépendante dans le conseil de Berlin ne fut formée que le 20
février 1919.21
Une
telle organisation n’était ni assez forte ni suffisamment cohésive
pour fournir un centre discipliné aux rangs en formation rapide des
soldats et des ouvriers révolutionnaires.
Quatre
jours après les combats de Noël, 112 délégués de différentes
régions d’Allemagne se réunirent pour tenter de corriger cette
déficience en transformant la Ligue Spartakus en un Parti Communiste
totalement indépendant, le KPD. Rosa Luxemburg avait décidé de
s’engager dans cette voie après qu’un appel aux
Sociaux-Démocrates Indépendants à se joindre à une conférence
spéciale du parti ait été rejeté.
La
plupart des délégués venaient de l’ancienne Ligue Spartakus,
mais une minorité était issue des Radicaux de Gauche basés à
Brême qui avaient décidé de rejoindre le nouveau parti – malgré
les mauvais pressentiments de leur meilleur dirigeant, Knief22.
Etait également présent, en tant que représentant du Parti
Communiste de Russie, l’associé austro-polonais du groupe de
Brême, notre vieille connaissance Karl Radek.
Dès
le début, il y eut un contraste marqué entre l’analyse des
événements des anciens dirigeants révolutionnaires et celle de la
majorité des délégués. Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, Paul Levi,
Karl Radek reconnaissaient tous que pour réussir, une révolution
dépendait de plus que d’un soutien temporaire pour certains
slogans de la part d’une masse désorganisée d’ouvriers et de
soldats. Luxemburg insistait, lorsqu’elle présenta le programme du
parti au troisième jour de la conférence, sur le fait que la
révolution n’en était encore qu’à son stade primitif :
(...) qu’en résulte-t-il pour
notre
ligne tactique générale dans la situation où nous allons nous
trouver prochainement ? La première conséquence que vous en
tirerez est sans doute l’espoir de voir tomber le gouvernement
Ebert-Scheidemann qui serait alors remplacé par un gouvernement
expressément révolutionnaire, socialiste et prolétarien.
Cependant, je voudrais attirer votre attention, non pas vers le haut
de la pyramide, mais vers le bas. Nous ne pouvons continuer à
nourrir l’illusion, retomber dans l’erreur de la première phase
de la révolution, celle du 9 Novembre, croire qu’il suffit en
somme de renverser le gouvernement capitaliste et de le remplacer par
un autre, pour faire une révolution socialiste.23
Seule
la lutte dans les usines pouvait commencer à renverser les rapports
sociaux et établir la base d’une véritable révolution
socialiste. Elle poursuivait :
(...) il est très
caractéristique que
la première période de la révolution qui va, pourrait-on dire,
jusqu’au 24 décembre (…), ait été encore exclusivement
politique. (...) c’est ce qui explique les balbutiements, les
insuffisances, les demi-mesures et le manque de conscience de cette
révolution. C’était le premier stade d’un bouleversement dont
les tâches principales se situent dans le domaine économique :
renversement des rapports économiques.
La nature même de cette
révolution fait
que justement les grèves prennent nécessairement de plus en plus
d’ampleur, deviennent de plus en plus le centre, l’essentiel de
la révolution. C’est alors une révolution économique et c’est
par là qu’elle devient une révolution socialiste. Mais la lutte
pour le socialisme ne peut être menée que par les masses, dans un
combat corps à corps contre le capitalisme, dans chaque entreprise,
opposant chaque prolétaire à son employeur. Alors seulement il
s’agira d’une révolution socialiste…
Le socialisme ne se fait pas
et ne peut
se faire par décrets, même s’ils émanent d’un gouvernement
socialiste, aussi parfait soit-il. Le socialisme doit être fait par
les masses, par chaque prolétaire. C’est la où ils sont rivés à
la chaîne du capitalisme que la chaîne doit être rompue.
Il fallait « miner
progressivement le gouvernement Ebert-Scheidemann »
et non
tenter de prendre le pouvoir avant que les conditions ne soient
mûres.
Camarades, voilà un vaste
champ à
labourer. Nous devons faire les préparatifs à partir de la base,
nous devons donner aux conseils d’ouvriers et de soldats un pouvoir
tel que le renversement du gouvernement Ebert-Scheidemann, ou de tout
autre gouvernement semblable, ne sera plus que l’acte final. Ainsi,
la conquête du pouvoir ne doit pas se faire en une fois, mais être
progressive : nous nous introduirons dans l’Etat bourgeois
jusqu’à occuper toutes les positions. (...)
Les luttes économiques
n'étaient pas
quelque chose de séparé de cette tâche politique, disait-elle,
mais en constituait un point central.
Et la lutte
économique : à mon
avis, qui est aussi celui de mes amis les plus proches dans le parti,
elle doit être également menée par les conseils d’ouvriers.
C’est aussi aux conseils d’ouvriers qu’il appartiendra de
diriger le conflit économique et de lui faire emprunter des voies de
plus en plus larges. (...) Car il s’agit bien de lutter pied à
pied, corps à corps, dans chaque Etat, dans chaque ville, dans
chaque village, dans chaque commune, afin de remettre aux conseils
d’ouvriers et de soldats tous les instruments du pouvoir qu’il
faudra arracher bribe par bribe à la bourgeoisie.
(...) l’histoire nous rend la
tâche
moins aisée que lors des révolutions bourgeoises où il suffisait
de renverser le pouvoir officiel au centre et de le remplacer par
quelques douzaines d’hommes nouveaux, tout au plus. Nous devons
agir à la base. (...) C’est à la base, là où chaque employeur
fait face à ses esclaves salariés, . (...) là où les organes
exécutifs de la domination politique de classe font face aux objet
de cette domination, c’est à la base que nous devons arracher,
bribe par bribe, aux gouvernants les instruments de leur puissance
pour les prendre en main.24
Le
discours de Rosa Luxemburg reçut des applaudissements prolongés.
Cela dit, la majorité des délégués ne comprenaient pas
complètement le point crucial de son analyse – que le conflit
décisif pour le pouvoir d’Etat était encore considérablement
éloigné, qu’il ne pourrait pas y avoir une insurrection réussie
à Berlin avant que les conseils ouvriers ne soient véritablement en
lutte pour le contrôle de la société dans chaque localité,
attirant les plus larges masses dans la lutte, et non les sections
les plus avancées de la capitale. Néanmoins, ils adoptèrent le
programme du parti,
qui proclamait :
La Ligue spartakiste ne
prendra jamais le
pouvoir que par la volonté claire et sans équivoque de la grande
majorité des masses prolétariennes de l’ensemble de l’Allemagne.
Elle ne le prendra que si ces masses approuvent consciemment ses
vues, ses buts et ses méthodes de lutte . (...) La Ligue spartakiste
refusera. (...) de prendre le pouvoir uniquement parce que les
Scheidemann-Ebert se seraient usés au pouvoir et que les
indépendants auraient abouti à une impasse en collaborant avec eux.
Mais
la majorité des délégués était loin d’accepter la patience de
Rosa vis à vis du processus révolutionnaire, sa conviction qu’il
était nécessaire de gagner les masses pour une prise du pouvoir
totale avant d’essayer de prendre le gouvernement. Cela avait été
prouvé par les précédentes discussions du congrès relatives à la
participation aux élections à l’Assemblée Nationale et à la
lutte économique. Comme Rosa Luxembourg l’avait exprimé une
semaine plus tôt :
Nous sommes aujourd’hui au
milieu d’une
révolution, et l’Assemblée Nationale est une forteresse
contre-révolutionnaire érigée contre le prolétariat
révolutionnaire. Notre tâche est de prendre cette forteresse
d’assaut et de la raser jusqu’au sol.25
Les
dirigeants spartakistes n’étaient certes pas partisans de
l’absurdité prêchée par les Indépendants et les
sociaux-démocrates – et par les partis communistes de l’époque
présente – selon laquelle on peut parvenir au socialisme par les
moyens parlementaires. Mais ils croyaient fermement que les
révolutionnaires pouvaient utiliser les élections comme une
tactique dans la lutte pour détruire les illusions des travailleurs
sur le parlement.
Pour
mobiliser les masses contre l’Assemblée Nationale et les diriger
dans une lutte décisive contre elle,
écrivait Rosa,
nous devons utiliser les
élections, et
la tribune de l’Assemblée Nationale. (...) Dénoncer clairement et
sans réservation tous les procédés et les machinations de cette
excellente assemblée, de révéler pas à pas aux masses son œuvre
contre-révolutionnaire, d’en appeler aux masses à décider, à
intervenir – telle est la fonction de la participation à
l'Assemblée Nationale.26
L’argument
fut martelé au congrès par Paul Levi, qui proclama que les
communistes ne pouvaient ignorer les élections que s’ils se
sentaient assez forts pour renverser l’Assemblée. Mais même s’ils
étaient sans doute assez forts pour cela à Berlin, dans la Ruhr et
la Haute Silésie, dans le reste de l’Allemagne les conditions
étaient très différentes.
La question est trop sérieuse.
Nous
voyons tous que la décision sur cette question peut déterminer pour
des mois le destin de notre mouvement. (...) Pensez donc à la
situation suivante. L’Assemblée Nationale va se réunir. Pendant
des mois, et vous ne pouvez pas l’empêcher, elle va dominer
peut-être la totalité de la vie politique en Allemagne. (...) Vous
ne pourrez pas empêcher que tous les yeux soient fixés sur elle.
(...) Elle entrera dans la conscience des travailleurs allemands, et
confronté à ce fait vous voulez rester en dehors, et agir de
l’extérieur ?27
Mais
les délégués n'étaient pas ébranlés. Ils avaient vu, quelques
jours plus tôt, l’humiliation du gouvernement Ebert échouant à
briser la Division de Marine. Ils ne croyaient pas qu’il pourrait
détourner l’attention, même temporairement, vers des voies
parlementaires.
Paul
Lévi décrivit lui-même plus tard cet état d’esprit :
L'air de Berlin (...) était
empli de
tension révolutionnaire. (...) Il n'y avait personne qui n'eût le
sentiment que l'avenir immédiat allait voir se produire de nouvelles
grandes manifestations et de nouvelles actions. (...) Les délégués
qui représentaient ces masses jusqu'alors inorganisées venues à
nous seulement dans l'action, par elle et pour elle, ne pouvaient
absolument pas comprendre qu'une nouvelle action, facilement
prévisible, pourrait aboutir non pas à la victoire, mais à des
reculs. Ils n'envisageaient même pas en rêve de suivre une tactique
qui aurait laissé une marge de manœuvre au cas où ces reculs
seraient produits.28
Le
sentiment de la majorité fut exprimé par l’ancien député
social-démocrate Otto Rühle, qui proclamait avec insistance qu’il
n’y avait aucun besoin d’utiliser l’Assemblée comme tribune :
« Nous
avons
maintenant d’autres tribunes. La rue est la grande tribune que nous
avons conquise et que nous n’abandonnerons pas, même s’ils nous
tirent dessus ».
Les
révolutionnaires n’avaient pas besoin d’un « nouveau
cadavre »,
disait-il. Ils en avaient fini avec « les
compromis et l’opportunisme ».
Il n’y avait pas de souci à se faire. Peut-être l’Assemblée
s’enfuirait-elle dans une ville de province pour échapper à
l’atmosphère révolutionnaire de la capitale. « Dans
ce cas nous établissons un nouveau gouvernement ici à Berlin ».
De toutes façons, il y avait encore 14 jours avant les élections.29
Tous
les délégués opposés à la participation aux élections ne
s’attendaient pas une bataille pour le pouvoir à court terme, mais
il y en avait beaucoup. Leur soutien au programme de Rosa Luxemburg
deux jours plus tard ne voulait pas dire qu’ils étaient vraiment
d’accord avec la perspective dont il était porteur.
La
même impatience se manifesta à l’occasion de la discussion sur la
lutte économique. Lange, qui fit le rapport introductif pour la
direction, ne prit pas position sur la question de savoir si les
révolutionnaires devaient rester dans les syndicats. Mais beaucoup
d’autres délégués étaient convaincus que les communistes
devaient briser avec de telles institutions
« réformistes ».
Paul Frölich lança le slogan « Hors
des syndicats »,
appelant à constituer à la place des « unions
ouvrières »
qui mettraient fin une fois pour toutes à la distinction entre le
parti et les syndicats. Il fut critiqué par Rosa Luxemburg – mais
parce qu’il n’avait pas mis l’accent sur les conseils ouvriers.
Elle n’était pas satisfaite du slogan « Hors
des syndicats »,
mais suggérait malgré tout que la « liquidation » des
syndicats était à l’ordre du jour. Seul Heckert fit remarquer que
les syndicats étaient loin d’être finis, qu’ils rassemblaient
encore de grandes quantités de travailleurs et que le slogan « Hors
des syndicats »
était extrêmement dangereux.
L’exaspération
vis à vis d’organisations syndicales dominées par des
bureaucrates droitiers était naturelle dans une conférence tenue au
milieu de grèves à répétition et de manifestations de rue. Mais
il n’est pas douteux qu’elle était erronée. Les travailleurs
mobilisés dans les grandes usines berlinoises n’attendaient pas,
eux, l’avis des organisations syndicales nationales avant de passer
à l’action, mais pour des ouvriers d’usines plus petites et avec
moins d’expérience de la lutte, les syndicats étaient plus
importants que jamais. Alors même que les spartakistes discutaient
de la liquidation des syndicats, les travailleurs les rejoignaient de
façon massive : les effectifs syndicaux s’accrurent de
50 %
dans le premier mois de la révolution, et triplèrent dans les 12
mois suivants. Comme le soulignait Radek quelques mois plus
tard :
Les masses qui s'éveillent au
cours de
la révolution rentrent en phalange compacte dans les syndicats, en
se moquant de leurs dirigeants. Il y a depuis la révolution de
novembre environ quatre millions de nouveaux syndiqués. C’est la
réponse des masses à la question de la necessité des syndicats,
qu’aucun révolutionnaire ne peut négliger.30
Il
y avait un contraste important entre l’attitude de la majorité des
spartakistes et celle des bolcheviks en Russie. Les bolcheviks
considéraient comme nécessaire de faire un effort vers le travail
syndical même après la Révolution d’Octobre : c’était un
moyen d’amener à l’activité politique des couches nouvelles de
travailleurs. Les discussions au congrès spartakiste révélaient
toutes la même impatience, la même incapacité à prendre au
sérieux la tâche de gagner les plus larges couches de travailleurs
à la révolution.
Beaucoup
des dirigeants les plus expérimentés du nouveau parti étaient
consternés. L’organisateur révolutionnaire vétéran et collègue
de toute une vie de Rosa Luxemburg, Leo Jogiches, voyait dans les
décisions du congrès la preuve qu’il avait été convoqué
prématurément, de façon isolée des masses qui faisaient encore
confiance aux Indépendants. Il était profondément pessimiste quant
à l’avenir, malgré la vague montante de lutte au dehors du lieu
de la conférence. Il vota, seul, contre la fondation du parti. Ce
qui ne l’empêcha nullement, cependant, d’en devenir
l’organisateur principal.
Ses
doutes étaient partagés par Radek, qui écrivit dans ses
mémoires :
« Le
congrès
montrait de façon aiguë la jeunesse et l’inexpérience du parti.
(...) Je ne me sentais pas encore en présence d’un parti ».31
Rosa
Luxemburg était moins pessimiste, même si elle était convaincue
que ses opposants au congrès avaient eu tort. « Notre
défaite »,
écrivait-elle à sa vieille amie Clara Zetkin,
a été simplement le triomphe
d’un
radicalisme un peu puéril, à moitié digéré, d’esprit étroit.
C’est en tout cas ce qui s’est passé au début de la conférence.
Plus tard, le courant entre nous (la direction) et les délégués a
commencé à passer. (...) Les spartakistes sont une nouvelle
génération, exempts des traditions crétines du « bon vieux
parti’ »(le SPD). (...) Nous avons décidé à l’unanimité
de ne pas faire de la question (du boycott) une question cardinale et
de ne pas la prendre trop au sérieux.32
Ce
qui était le plus important, pour Rosa, c’était que le Parti
Communiste qui venait d’être fondé attirait à lui les meilleurs
éléments de la jeune génération. Leur inexpérience et leur
« gauchisme » était l’autre face de leur jeunesse et
de leur esprit combatif. Mais elle sous-estimait l’impact de cette
inexpérience sur un parti qui manquait de cadres trempés. Cela
devait s’avérer fatal dans les jours qui suivirent, même si
l’ancienne direction devait être réélue dans sa totalité à la
fin du congrès. Comme Radek le nota huit mois plus tard :
Dans la direction communiste,
seule une
minorité comprit correctement ce problème. (...) C’est pour cela
que la lutte contre l’idéologie putschiste (...) a été si faible
dans la presse communiste.33
Le
manque de cohésion de la gauche révolutionnaire fut aggravé par
une autre conséquence de la politique gauchiste adoptée par le
congrès. Le groupe le plus expérimenté d’activistes ouvriers de
Berlin, les Délégués Révolutionnaires, devait rejoindre le parti
lors de sa fondation. Mais des discussions entre leurs dirigeants et
une délégation du nouveau parti, conduite par Liebknecht, avaient
buté sur des difficultés. Ils exigeaient un certain nombre de
changements politiques – parmi lesquels l’abandon de toute
référence à Spartakus dans le nom du nouveau parti.
En
fait, ils voulaient surtout des garanties que le nouveau parti
n’aurait rien à voir avec les bandes armées incontrôlables que
beaucoup identifiaient avec le spartakisme. Richard Müller exprimait
cela lorsqu’il fit dépendre l’activité commune de l’abandon
par le Parti Communiste de ce qu’il appelait le « putschisme ».
Liebknecht répliqua que Müller parlait le langage du journal
social-démocrate Vorwärts.
Sur cette note acide, les négociations furent rompues.34
Pourtant, deux des trois représentants des Délégués, Müller et
Daümig, devaient finalement prouver leur sincérité révolutionnaire
en adhérant au parti en 1920.
Le
résultat immédiat fut désastreux. Le Parti Communiste fut engagé
dans des luttes massives sans avoir dans ses rangs certains des
meilleurs et des plus influents dirigeants des travailleurs de
Berlin. Les Délégués, d’autre part, devaient se retrouver
plongés dans une situation complexe et changeante sans pouvoir
bénéficier des conseils que des individualités comme Rosa
Luxemburg, Jogiches et Radek auraient pu leur donner. Le résultat,
paradoxalement, fut que certains d’entre eux tombèrent dans le
putschisme même dont ils faisaient procès aux Spartakistes.