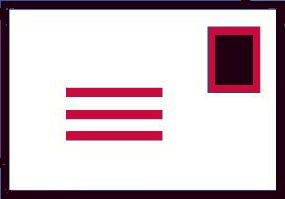L’année
1923 est entrée dans l’histoire comme l’année du chaos
monétaire, de la famine de masse, de la plongée dans l’abîme de
sections entières de la société, et de bagarres de rue
continuelles.
Pourtant,
pendant les deux ou trois premiers mois, la vie sociale avait paru
ordonnée et paisible. L’occupation de la Ruhr par les Français
avait créé une atmosphère de patriotisme et d’unité sociale. La
paix de classe régnait comme on l’avait rarement vu dans
l’histoire de la République de Weimar. Les seules grèves apparues
au cœur du capitalisme germanique, la Ruhr, avaient eu pour but de
défendre les magnats de l’industrie. L’agitation sur les
salaires, qui avait grandi en novembre et décembre, n’était plus
qu’un lointain souvenir au moment où les employeurs doublaient le
salaire des mineurs. Et l’argent conservait sa valeur dans les
transactions quotidiennes, même si les prix montaient déjà à une
vitesse que nous considérerions aujourd’hui comme phénoménale –
de 20 ou 30 % par mois. En fait, le gouvernement avait même
réussi, en février et en mars, à stabiliser la valeur du mark.
Ce
semblant d’ordre commença à être ébranlé à la mi-avril.
Stinnes bougea son petit doigt, et la valeur du mark plongea. Il
fallait 31 700 marks pour acheter un dollar le 1er
mai, 160.400 le 1er
juillet et 1 103 000 le 1er
août.
Dans
la Ruhr, le front inébranlable de la « résistance
passive »
contre « l’envahisseur » fléchissait
soudain :
des travailleurs, non syndiqués et immigrés (essentiellement des
Polonais), se mettaient à obéir aux ordres des Français, et les
industriels négociaient avec « l’ennemi ».
Les
premières manifestations contre les autorités allemandes
commencèrent lorsque la hausse des prix réduisit la valeur des
indemnités versées à ceux que la « résistance passive’
avait réduits au chômage. Die
rote Fahne du 20 avril
avait pour titre : « Effusion de sang dans la Ruhr –
Encore des morts et 35 blessés à Mülheim », après que la
police criminelle ait tiré sur une manifestation de
« plusieurs
centaines de sans emploi » devant l’hôtel de ville. Il y eut
des manifestations semblables à Essen, Duisburg et Düsseldorf.
Il
n’y avait pas autant de chômeurs dans le reste de l’Allemagne
que dans la Ruhr, mais leur sort était bien pire. On estimait qu’à
Berlin les indemnités d’assistance versées aux privés d’emploi
étaient alors à 25 % du niveau de subsistance. Par conséquent
il y eut des « troubles » occasionnés par les
chômeurs
à Stettin, Chemnitz, Leipzig, Plauen, Zittau et Werdau. A Dresde des
comités de contrôle « formés spontanément »
commencèrent à forcer les prix à la baisse.1
Les Centuries
La
montée de l’extrême droite provoqua une réaction de la part des
sections les plus actives des travailleurs. Le Parti Communiste
appelait depuis quelque temps à la formation de groupes de défense
des travailleurs appelées habituellement « Centuries
prolétariennes ». Elles commencèrent alors à prendre racine
– en particulier dans la Ruhr, où les Français avaient expulsé
la police de sécurité allemande, et en Allemagne centrale où les
gouvernements d’Etats sociaux-démocrates de gauche les toléraient.
Le
comité élu au congrès de décembre des conseils d’usine appela,
en avril, à « la
construction de
Centuries prolétariennes en tant qu’expression du front unique
organisé et prêt à la lutte qui existe dans les usines ».
Les cartes de membre délivrées aux Centuries à Leipzig
définissaient leurs buts : « Eclairer la classe
ouvrière
sur les dangers (...) du fascisme. Protéger (...) les réunions et
les manifestations (...) ouvrières ».2
Dans
l’idéal, les Centuries devaient être constituées par décision
de réunions de masse dans les usines. Le comité central du Parti
Communiste appela à ce que les sans-emploi soient enrôlés dans des
groupes d’autodéfense basés sur des travailleurs employés :
« Pas de Centuries spéciales pour les chômeurs. (...) Pas de
constitution de Centuries du parti ».3
De cette façon, le mouvement des Centuries devait être étroitement
lié au mouvement des comités d’usine et à celui des comités de
contrôle.
Il
est difficile de savoir quelle efficacité eut tout ceci dans la
pratique. Il est peu douteux que les Centuries étaient souvent des
organisations du KPD. Mais en mai-juin à Chemnitz les grandes usines
votèrent effectivement pour la construction d’organisations
d’usine armées. Et à Leipzig le mouvement était dirigé par un
comité de sept membres du SPD, cinq communistes et trois sans parti.
Il revendiquait des affiliations dans 96 usines.4
Les effectifs des Centuries de Leipzig étaient constitués de deux
cinquièmes de communistes, un cinquième de sociaux-démocrates, et
le reste de syndicalistes sans parti.5
On assurait que la majorité des membres étaient d’anciens
combattants du front.
La
première action des Centuries qui ait laissé des traces eut lieu le
9 mars à Chemnitz, où elles agirent contre une réunion fasciste.
Deux jours plus tard 4 000 membres, parmi lesquels un
contingent
d’une centaine de femmes, manifesta en Thuringe. Et, le 18 mars,
une manifestation communiste à Halle était précédée
de « troupes
ouvrières portant des drapeaux rouges ».6
Les
défilés du Premier Mai furent utilisés comme une occasion de
montrer le mouvement en cours à l’ensemble de la classe ouvrière.
Dans tout le pays des manifestations étaient précédées des rangs
ordonnés des Centuries. A Berlin, on a dit que 25 000 de ces
travailleurs étaient à la tête d'une manifestation de 500 000
personnes.7
La manifestation à Essen, le même jour, comptait 100 000
participants ; à Halle 50 000 ; cependant
qu’à
Munich une manifestation unitaire de toutes les organisations
ouvrières atteignait, malgré les menaces d’agression fascistes,
70 000 personnes.
Peu
après les Centuries furent interdites dans toute la Prusse par le
ministre de l’intérieur Severing. Il avait déclaré un mois plus
tôt :
Depuis
quelque temps le KPD appelle à la formation de forces prolétariennes
d’autodéfense – pas seulement comme une défense contre les
fascistes et les organisations d’extrême droite, pour empêcher
les réunions nationalistes et protéger les meetings communistes,
mais aussi comme l’avant-garde d’une Armée Rouge.8
L’interdiction
n’empêcha cependant pas le mouvement de continuer à croître dans
la Ruhr occupée par les Français et dans les Länder allemands
centraux de Saxe et de Thuringe. Le 15 mai 10 000 travailleurs
combattirent la police qui protégeait un meeting des paramilitaires
d’extrême droite Stahlheim rassemblant 8 500 participants. En
Saxe, les Centuries se renforcèrent au point de pouvoir dresser des
barrages routiers pour empêcher les fascistes de se déplacer d’un
endroit à un autre. Dans la Ruhr, les autorités étaient divisées
sur l’importance des Centuries. Le point de vue officiel était
qu’elles existaient probablement dans les usines mais pas dans les
mines.9
Dans
le reste de l’Allemagne des efforts furent faits pour continuer à
construire le mouvement clandestinement – par exemple, à Halle les
conseils d’usine votèrent, à la fin juin 1923, pour mettre en
place des « forces de défense » bien qu’elles fussent
« illégales ».10
Une
fois constituées, les Centuries ne se limitèrent pas à des
missions antifascistes. L’inflation s’accélérant, elles furent
naturellement utilisées par les comités de contrôle comme un moyen
de mettre en application des décisions contre la spéculation. On
les envoyait, des centres industriels de l’Allemagne moyenne,
empêcher des évictions de salariés agricoles. De plus en plus,
elles prenaient en charge la défense des piquets et l’extension
des grèves.
La première vague de grèves
L’effondrement
du mark à partir d’avril aboutit à ce que la « paix »
dans les usines du début de l’année se mit à se dégrader
rapidement. En mars, une grève des mineurs impliquant 40 000
travailleurs éclata en Haute Silésie, en même temps que des arrêts
de travail en Allemagne centrale. Mais ce n’était rien à côté
de ce qui allait frapper le pays tout entier en mai-juin.
Le
mouvement commença lorsque les mineurs d’un puits près de
Dortmund, dans la Ruhr, se mirent en grève sur les salaires le 16
mai – rejetant comme inadéquat un accord entre les charbonniers et
le gouvernement. Les mineurs occupèrent l’hôtel de ville de
Dortmund, et envoyèrent dans des puits et des usines du voisinage
des piquets volants accompagnés des Centuries prolétariennes
locales. Des affrontements avec la police suivirent, dans lesquels un
mineur fut tué d’un coup de feu. Mais cela n’empêcha pas la
grève de s’étendre à toute la zone de Dortmund – même si le
Parti Communiste fut complètement pris par surprise et ne donna au
mouvement aucune direction pendant quatre jours.
Une
conférence locale des conseils d’usine, tenue le 20 mai, réunit
200 délégués de 60 lieux de travail, et dans la semaine suivante
la grève ferma toutes les mines et la plupart des grandes usines du
cœur de la Ruhr, entre Dortmund et Essen – même si un comité
central de grève sous direction communiste ne devait être formé
qu’à la fin de la semaine. A ce point de l’action, il y avait
310 000 grévistes, à peu près la moitié des mineurs et des
métallos de la Ruhr.
Les
grévistes se heurtaient de façon répétée à la police. Le 22
mai, par exemple, une manifestation de 50 000 personnes se
battit avec la police et trois travailleurs furent tués. Le
lendemain, 50 000 manifestants protestaient contre les tirs.
D’autres combats eurent lieu lorsque la police essaya d’expulser
des travailleurs qui avaient occupé les bâtiments d’une mine. Les
mineurs s’organisèrent instinctivement comme ils l’avaient fait
dans les premières luttes d’après-guerre. Les marches des
Centuries prolétariennes rappelaient aux observateurs les Armées
Rouges de 1920. Elles occupèrent les marchés et les boutiques pour
le comité de contrôle local, faisant baisser les prix par la
force.11
Le
gouvernement central ne savait trop que faire. Les Français avaient
expulsé la police de sécurité de la région pour essayer d’amener
les autorités locales à mettre un terme à la « résistance
passive » et à collaborer à la mise en place d’une nouvelle
police sous contrôle français. La police criminelle était tout ce
qui restait et elle était bien incapable de faire face à la
situation.
En
désespoir de cause, le chef de l’autorité gouvernementale de
Düsseldorf demanda de l’aide au général « ennemi »,
Devigues, lui rappelant qu’« à l’époque de la Commune de
Paris le Haut Commandement allemand avait apporté une aide décisive
dans l’écrasement du soulèvement ».12
Finalement
on parvint à un demi-accord selon lequel les Français permettaient
aux autorités locales de Mülheim et d’Essen de constituer des
« forces de police auxiliaires » avec des
volontaires.
Selon Rote
Fahne,
il y eut ensuite des « arrestations massives de grévistes et
de permanents communistes ».13
Les
grévistes commencèrent à retourner au travail le 28 mai : le
Parti Communiste, de peur qu’une grève isolée du reste de
l’Allemagne ne soit écrasée, recommanda l’acceptation d’une
augmentation de salaire substantielle.
Mais
si la direction du KPD croyait que la colère était limitée à la
Ruhr, elle se trompait. Cette colère s'ouvrit en juin« un
chemin tempétueux dans toute l’Allemagne par des meetings de
protestation, des manifestations contre la vie chère, par une vague
de grèves, grandes et petites, ».14
Le
7 juin, 30 000 mineurs et métallos se mirent en grève en Haute
Silésie. En deux jours leur nombre avait doublé, et encore deux
jours plus tard ils furent rejoints par l’arrêt de travail de
dizaines de milliers de salariés agricoles. Les grèves doivent
avoir été dures – le Parti Communiste déclara qu’elles furent
brisées physiquement par l’intervention de la police de sécurité.
Mais cela n’empêcha pas l’agitation parmi les salariés
agricoles de se répandre au Brandebourg, où 10 000 cessèrent
le travail, ainsi qu’au cœur de la réaction, en Prusse orientale,
où des « réunions spontanées » de salariés agricoles
furent signalées.15
Il
y avait des signes d’agitation partout : le jour où les
mineurs de Haute Silésie se mirent en grève, Die
rote Fahne avait pour
titre « Sept morts à Leipzig » après que la police
ait
tiré sur une manifestation du SPD et des syndicats. Et sur la côte
Nord-Ouest, des marins firent grève sous direction communiste trois
jours plus tard.
En
Allemagne centrale, les mineurs résistaient de plus en plus aux
pressions poussant à des « sacrifices » à un moment
où
la principale zone minière du pays était fermée par les troupes
françaises. L’inflation avait réduit leurs salaires à un point
tel que, de l’aveu même d’un ministre du gouvernement du Land de
Saxe, « Les
mineurs de Zwickau
ne peuvent pas acheter de pain avec leur salaire, sans parler des
autres aliments ». Pendant les mois de mai et juin les mineurs
firent des grèves du zèle qui réduisirent la production. En
désespoir de cause, les charbonniers firent appel au gouvernement
central. Lorsque le gouvernement leur répondit « le mouvement
de Zwickau s’est produit contre la volonté des syndicats, qui
perdent de plus en plus le contrôle de la classe laborieuse »,
les propriétaires demandèrent une répétition de la tactique de
1919 – une entrée de la Reichswehr en Saxe.16
En
même temps que ces grands mouvements il y avait une prolifération
de grèves locales et partielles, en particulier lorsque le rythme de
l’inflation commença à s’emballer. Les prix ne changeaient plus
tous les mois ou toutes les quinzaines mais tous les deux ou trois
jours : entre le 29 et le 31 juin le prix des denrées de
première nécessité s’éleva de 25 %. Des travailleurs
jusque là pacifiques décidèrent que seule l’action directe
pouvait les protéger – que ce soit en prenant le contrôle des
marchés pour faire cesser la spéculation sur les pommes de terre,
ou, comme les cols blancs des usines de Berlin, en faisant grève le
21 juin pour des salaires de « temps de paix » (en
d’autres termes, d’avant-guerre).
La
vague de grève atteignit son pic lorsque les métallos de Berlin
votèrent la grève à dix contre un. Le 10 juillet, 150 000
d’entre eux avaient débrayé et à nouveau des manifestations de
grévistes se mesuraient avec la police. Les luttes n’étaient plus
seulement économiques. Comme un historien non révolutionnaire l’a
noté récemment, en juillet « la vague des revendications
ouvrières monte inséparablement d’une agitation véritablement
révolutionnaire ».17
Un
témoin encore moins révolutionnaire, Wissell, porte-parole du
Conseil Economique Provisoire, écrivait au début de juin :
Un
mélange de colère et de désespoir règne dans les grandes masses
et parmi tous ceux qui sont forcés de se passer de nourriture. C’est
tout autant le cas chez les fonctionnaires que parmi les demandeurs
d’aide sociale et les ouvriers. Et je dois dire que l’atmosphère
est telle que ces dernières semaines elle m’a effrayé et rempli
de sombres appréhensions pour l’avenir. Je vous dis très
clairement qu’un esprit révolutionnaire militant se lève parmi
les masses les plus calmes et les plus stables. (...) Il ne manque
plus qu’une petite étincelle pour faire tout exploser.18
C’était
exactement le moment pour lequel un parti révolutionnaire de masse
avait été construit pendant les années précédentes. Pourtant
« la petite étincelle » se faisait désirer.
Les sociaux-démocrates en déclin
En
1922, la tendance, réelle, de la classe ouvrière à s’éloigner
des sociaux-démocrates et à se rapprocher des communistes était à
peine perceptible. Au début de l’été 1923, toute la structure
des allégeances politiques traditionnelles vola en éclats.
L’inflation
en accélération rapide frappa le Parti Social-Démocrate de deux
façons. D’abord, elle poussa les travailleurs à des grèves
répétées, auxquelles les dirigeants syndicaux résistaient et que
la police prussienne, dirigée par des sociaux-démocrates, réprimait
violemment. Ensuite, elle détruisit les finances du SPD et des
syndicats. Les cotisations avaient perdu toute valeur au moment où
elles atteignaient la trésorerie nationale, de telle sorte qu’il
n’y avait plus rien pour financer l’appareil, autrefois
tout-puissant, ni pour la presse.
Un
historien qui a vécu la période raconte :
Au
cours de 1923, la puissance du SPD décrut constamment. (...)
Surtout, les syndicats libres, qui avaient toujours été le support
essentiel de l'influence des sociaux-démocrates, étaient dans un
état de délabrement complet. L’inflation anéantissait la valeur
des cotisations. Les syndicats ne pouvaient plus payer leurs employés
normalement, ni apporter de l’aide à leurs membres. Les accords
salariaux que les syndicats étaient habitués à conclure avec les
employeurs devinrent sans intérêt dès lors que la dévaluation de
la monnaie réduisait à peau de chagrin les salaires payés une
semaine plus tard. Ainsi le travail syndical à l’ancienne perdit
toute utilité. (...) La destruction des syndicats était en même
temps un coup porté au SPD.19
Il
y a là quelque exagération. Mais il est vrai que les effectifs des
syndicats « libres » s’effondrèrent – de neuf
millions en 1922 à quatre millions en 1924. Il y avait une
décomposition visible de l’appareil qui avait restreint la classe
ouvrière allemande depuis la guerre.
Le
vieux travail « syndical » de lutte sur les salaires
devait désormais être effectué sur une base hebdomadaire, puis
quotidienne, par des organisations proches des travailleurs. Les
sections syndicales locales,
et par dessus tout les conseils d’usine, assumèrent un nouveau
rôle de direction des luttes. Et les militants communistes ouvraient
la voie en suggérant des formes d’action qui pouvaient gagner.
Déjà,
lors de l’élection à la mi-février d’un conseil d’usine chez
Thyssen, dans la Ruhr, la liste communiste avait eu plus de voix que
celles des syndicats « libres », en même temps qu’un
syndicat dissident recueillait plus de suffrages que les syndicats
« apolitiques » et chrétiens. Les syndicats
comprirent
le message – et remirent à plus tard les élections dans d’autres
usines de la zone occupée.20
Mais cela ne pouvait détruire l’implantation des communistes dans
les conseils d’usine sur le plan national. Une estimation
communiste pessimiste parle de cinq
mille conseils que le
KPD pouvait mobiliser – même s’il ne les contrôlait pas tous.21
En
juin, les évaluations des communistes suggéraient que les militants
du parti tenaient des positions qui organisaient deux millions et
demi de syndicalistes au niveau local – un tiers du total des
effectifs syndicaux de l’époque. Dans le syndicat du bâtiment,
par exemple, le KPD dirigeait 65 des 749 sections locales et était à
égalité avec les sociaux-démocrates dans 230 autres ; dans le
syndicat des métallurgistes, le parti avait la majorité dans des
centres clé comme Stuttgart, Hall, Merseburg, Iéna, Suhl, Solingen
et Remscheid ; à Halle, il gagnèrent les élections des
métallos par 2 000 voix contre 500, et à Magdebourg, où les
sociaux-démocrates l’emportèrent avec 4.900 voix, les communistes
pouvaient malgré tout se vanter d’en avoir obtenu 2 600.22
Les
effectifs du parti grossirent de 70 000 nouveaux membres – à
peu près un tiers – et il y avait des signes que son influence sur
un nombre bien plus important de travailleurs avait considérablement
augmenté. Il n’y eut que deux compétitions électorales pendant
la montée de la lutte en 1923 – dans l’Oldenburg au début de
juin et au Mecklembourg un mois plus tard. Dans l’Oldenburg le
score des communistes passa de 3 % du SPD en 1920 à
25 % ;
dans le Mecklembourg rural les progrès étaient encore plus
étonnants, car les communistes n’avaient pas cru devoir y
présenter de candidat en 1920 et les Indépendants avaient obtenu
seulement 2 000 voix – et là les communistes bénéficiaient
de 10 000 voix, à peu près le même nombre que les
sociaux-démocrates.
Au
Mecklembourg quatre travailleurs sur dix qui votaient
social-démocrate trois ans plus tôt votaient désormais communiste.
Ces chiffres, bien sûr, peuvent ne pas être représentatifs du pays
dans son ensemble. Mais ils indiquent un mouvement massif de
sympathie dans la classe ouvrière, même si l’on peut concevoir
qu’il n’ait pas connu la même amplitude partout.
C’est
la même constatation qui ressort de la séquence électorale
suivante, lorsque la crise inflationniste était terminée et que la
gauche avait été mise en déroute. Malgré l’illégalité, le
manque d’organisation et en particulier d’esprit offensif, à la
fin de 1923 et au début de 1924 le Parti Communiste doubla (au
moins) ses suffrages par rapport à 1921 dans les régions
industrielles. En Thuringe, il fit quatre voix quand le SPD en
faisait cinq, et même dans la Bavière réactionnaire il réalisait
la moitié du score des sociaux-démocrates. Un nombre massif de
travailleurs ayant participé aux grèves et aux manifestations de
l’été 1923, on peut supposer que le soutien dont bénéficiaient
les communistes à ce moment-là était considérablement plus élevé.
Il
semble que l’on puisse considérer comme justifiée l’affirmation
de l’historien et ancien communiste « de gauche »
Rosenberg selon laquelle
Le
Parti Communiste (...) critiquait à haute voix et de façon
vigoureuse le gouvernement Cuno. (...) Les masses affluèrent vers
lui. (...) En été 1923, le KPD avait incontestablement la majorité
du prolétariat allemand derrière lui.23
Même
le président du parti, Brandler, peu porté à l’excès
d’optimisme, pouvait affirmer six mois plus tard que dans les cœurs
industriels du pays les communistes avaient l’avantage sur les
sociaux-démocrates : « Donc dans trois endroits [en
juin]
– dans la Ruhr, en Haute Silésie et en Saxe, et plus tard en
Allemagne moyenne, nous avions la direction de la classe ouvrière
assez solidement en main ».24
A nouveau, peu de temps plus tard il déclarait :
« Nous
avions la majorité de la classe ouvrière derrière nous… »
- même si, d’après
le contexte, on ne comprend pas clairement s’il s’agit de toute
l’Allemagne ou seulement de « Berlin, la Ruhr et la
Saxe ».25
Pourtant
au même moment, en juin 1923, la majorité de la direction du parti
semblait ne pas avoir la moindre idée de la façon dont les
évènements changeaient en sa faveur.
La politique des communistes
Pendant
les deux premiers mois de l’occupation de la Ruhr le Parti
Communiste dut faire face à certains problèmes politiques
complexes. La vague nationaliste influençait un nombre considérable
de travailleurs, et dans la Ruhr elle-même les patrons allemands et
les troupes françaises faisaient de leur mieux pour gagner les
faveurs des travailleurs. La direction communiste devait élaborer
une réplique à l’occupation qui ne la ferait identifier avec
aucun des deux. Elle se comporta dans l’ensemble assez bien, même
si dans une occasion au moins elle s’égara dans une direction
douteuse.
Die
rote Fahne lança le
slogan « Battons Poincaré et Cuno sur la Ruhr et sur la
Spree » (Poincaré était le président du conseil français,
la Spree est la rivière qui traverse Berlin et la Ruhr est la
rivière qui parcourt la région à laquelle elle donne son nom). Le
journal disait que les travailleurs
de la Ruhr entendaient résister à l’exploitation de
l’impérialisme français, mais que leur but était complètement
différent de celui des patrons
allemands :
La bourgeoisie française et la
bourgeoisie allemande sont d'accord pour constuire un trust commun,
qui lie le charbon allemand et le minerai de fer français. Mais les
Français veulent avoir le dessus. Ils désirent une part de
60 %
pour eux-mêmes, laissant à Stinnes, Krupp et Thyssen seulement
40 %. La lutte se mène sur ces 10 %. (...) Elle l'a
payée
jusqu'à présent avec la sueur des ouvriers allemands, payés dans
une monnaie qui se déprécie constamment, pour vendre ainsi leurs
marchandises à l’étranger bon marché.
La bourgeoisie allemande veut
se servir
de la faim et du coût de la vie croissant dont elle s'empiffre pour
amener les masses paupérisées à marcher seulement contre
l’impérialisme français. Elle veut ainsi faire d'une pierre deux
coups. (...) les 10 % de la participation au trust charbon et
fer, et en même temps submerger tous les barrages qui ont été
érigés après l'assassinat de Rathenau (...) contre la
contre-révolution.
Dans
cette situation, le prolétariat doit savoir qu'il a à se battre sur
deux fronts. (...) Les capitalistes français ne sont aucunement
meilleurs que les capitalites allemands, et les baïonnettes des
troupes d’occupation françaises ne sont pas moins acérées que
celles de la Reichswehr. Le Parti Communiste demande aux travailleurs
conscients de la Ruhr de prendre en charge la lutte défensive contre
les forces d’occupation françaises avec toute leur énergie.
C’est
seulement si, dans l’ensemble de l’Allemagne, vous marchez en
tant que force indépendante, en tant que classe combattant pour ses
propres intérêts, que vous pourrez écarter le danger du
renforcement de la bourgeoisie allemande du fait de l’intoxication
nationaliste.26
Cette
politique impliquait d’élargir l’échelle de la résistance
ouvrière à l’occupation française, tout en s’opposant aux
actes de sabotage organisés par les groupes terroristes d’extrême
droite. Alors que l’extrême droite appelait à boycotter les
soldats français, le Parti Communiste préconisait la
fraternisation. L’Internationale Communiste aussi travaillait,
comme elle ne l’avait jamais fait auparavant, à mettre en place
une solidarité pratique. Une réunion des partis communistes
européens fut tenue à Essen le 6 janvier pour organiser la
résistance internationale à l’occupation. Une réunion plus large
de socialistes européens et de représentants des syndicats eut lieu
à Francfort deux mois plus tard. Une réunion élargie spéciale de
l’exécutif de l’Internationale (à laquelle fut donnée une
large publicité) fut consacrée en juin à la question de la Ruhr.
Des meetings furent tenus dans les grandes villes de France, Russie
et Allemagne, et les Russes envoyèrent une grande quantité de blé
pour nourrir les affamés de la Ruhr.
Le
Parti Communiste Français, en particulier, dut faire des efforts
spéciaux pour s’opposer à l’occupation organisée par son
propre gouvernement. Les Jeunesses Communistes furent invitées à se
rendre dans la Ruhr faire de l’agitation parmi les forces
d’occupation. Ils étaient hébergés dans les familles de
communistes allemands et éditèrent toute une variété de journaux
à l’intention des troupes – comme le
Conscrit,
la
Caserne,
et le
Drapeau
Rouge.
Des affiches bilingues furent collées, qui proclamaient :
Soldats
français, ouvriers en uniforme, vous êtes entrés dans la Ruhr sur
l'ordre de vos exploiteurs pour mettre sous le joug vos frères
prolétaires allemands, déjà opprimés par leur propre bourgeoisie.
(...) Soldats français, votre place est aux côtés des ouvriers
allemands. Fraternisez avec le prolétariat allemand.27
Il
est difficile de mesurer la portée que put avoir cette propagande.
Il y eut très certainement des réponses : 57 soldats français
passèrent en cour martiale et furent condamnés à des peines
d’emprisonnement totalisant 130 années. A Paris, le gouvernement
perquisitionna dans les locaux de la direction du parti, et arrêta
un certain nombre de dirigeants communistes parmi lesquels Marcel
Cachin, le secrétaire général.
L’agitation
fut probablement plus efficace, cependant, dans la lutte contre le
courant nationaliste parmi les travailleurs allemands.
Lorsque, par exemple, des conseillers municipaux nationalistes
suggérèrent que Thyssen, qui avait été arrêté par les Français,
devrait être nommé maire d'honneur de Hamborn, une ville de la
Ruhr, les communistes neutralisèrent la proposition en mettant en
avant le nom de Cachin, qui « avait fait bien plus pour les
travailleurs allemands ».28
Les forces d’occupation françaises interdirent la plupart des
journaux bourgeois allemands à cause de leur nationalisme – mais
ils durent interdire des journaux communistes comme l’Echo
de la Ruhr pour leur
internationalisme,
leurs appels destinés aux soldats français.
Le
ton de la propagande du Parti Communiste est donné par les titres de
l’édition du Premier Mai de Die
rote Fahne :
« Les Centuries de défense au premier rang »,
« Drapeaux
rouges », « Provocation policière à Halle »,
« Fraternisation dans la Ruhr avec les soldats
français »,
« Vive Cachin », « Vive la Commune de
Paris »,
« L’Echo
de la
Ruhr interdit par le
général français », « Les fascistes de Munich
défiés ».
On
se plaignit, dans l’Internationale Communiste, de l’insuffisance
des efforts des communistes français parmi les troupes de la Ruhr,
et un historien révolutionnaire français a proclamé depuis qu’ils
étaient sans efficacité,29
mais ils avaient au moins le mérite de poser le modèle d’une
forme d’agitation internationale bien différente de celle qui
caractérisait le mouvement ouvrier social-démocrate.
Cela
dit, il y avait un autre aspect de la politique des communistes qui
prêtait beaucoup plus à controverse – et qui a été attaqué
avec colère par d’anciens communistes qui ont quitté le parti
pendant l’ère stalinienne. Il s’agit de la tentative de
s’implanter dans les classes moyennes appauvries qui étaient
influencées par les nationalistes et les fascistes. Le parti et
l’Internationale s’employaient à gagner certains de ces éléments
à la révolution en expliquant que seuls le pouvoir des travailleurs
et l’alliance avec l’Etat ouvrier russe pouvaient permettre de
venir à bout de la misère qui frappait la grande masse du peuple
allemand. Le but des communistes, comme le disait Brandler, était de
séparer les « bandes de Pinkerton payés par les
capitalistes » du fascisme de « ces petits bourgeois
qui
ont rejoint le mouvement sur la base d’une honnête déception
nationaliste ».30
L’argument
fut utilisé en premier par Frölich dans un discours parlementaire
au début de l’occupation :
On vient nous voir et on nous
: « à
l’heure du danger nous devons être tous comme des frères, nous
devons tous faire des sacrifices ! » Nous demandons :
« où
sont les sacrifices ? » (...) Les barons de la
houille
viennent de relever leurs prix de 50 % ! (...) Nous
nous
sentons être les frères du prolétariat français, avant tout les
frères des camarades français qui sont entrés en lutte contre
Poincaré. (…)
Que
faire ? C'est Karl Marx nous a parlé de ce qui est en train
d'arriver en ce moment : lorsque le danger menace la nation
tout
entière, il est nécessaire que la classe ouvrière se constitue
elle-même en nation en prenant le pouvoir politique. (...) A bas ce
gouvernement !
Alors
seulement le peuple allemand pourra être sauvé. Constitution du
prolétariat en nation, et sur cette base salut de la nation par le
règne du prolétariat !31
Les
propriétaires des trusts industriels, était-il dit, agissaient
contre les intérêts de la masse du peuple allemand ; en fait,
ils trahissaient les buts nationaux qu’ils prétendaient défendre.
De là, il n’y avait qu’un pas vers l’argument selon il y avait
d'une certaine manière un intérêt national que les communistes
défendaient et non les grands industriels : lorsque Stinnes
fut
pris la main dans le sac en train de négocier avec les Français et
lorsque les autorités allemandes firent appel à l’aide des
Français pour écraser les travailleurs de la Ruhr, Die
rote Fahne parla de
« gouvernement de la trahison nationale ».
Radek
opéra le développement le plus célèbre de cet argument au mois de
juin dans un discours devant une réunion élargie de l’exécutif
de l’Internationale. Schlageter, terroriste de droite et ancien
membre des Freikorps, était devenu un héros dans les cercles
nationalistes de droite, après son exécution par les Français.
Radek sauta sur l’occasion pour s’adresser à ces cercles,
tentant de leur montrer que la vie de leur héros avait été une
contradiction que seule la révolution prolétarienne aurait pu
résoudre.
Schlageter,
dit Radek, avait été un « pèlerin du néan ».
Il
s’était engagé dans les Freikorps pour se battre à l’Est
contre la Russie soviétique. Les gens qui l’avaient envoyé là
espéraient de cette façon obtenir les bonnes grâces des Français.
Aujourd’hui, les Français avaient fusillé Schlageter. « La
presse de Stinnes le pleure. Mais dans les Alpes monsieur Stinnes
était le compagnon de Schneider-Creusot, l'armurier de l'assassin de
Schlageter ».
Schlageter
était allé pour la première fois dans la Ruhr en 1920, non pas
pour se battre contre les Français, mais pour réprimer la classe
ouvrière. Il avait agi ainsi parce qu’il croyait que les
travailleurs étaient « l’ennemi intérieur » qui
devait être vaincu avant qu’on ne puisse s’occuper de l’ennemi
extérieur. Mais aujourd’hui, dans la Ruhr, c’était ces mêmes
travailleurs qui résistaient aux Français.
Les
travailleurs étaient prêts à combattre l’impérialisme. Mais
comment pouvaient-ils combattre l’impérialisme français s’ils
étaient sans armes ? « La
majorité du peuple allemand sont des travailleurs qui doivent
combattre contre le besoin et l'oppression que la bourgeoisie
allemande leur impose. (...) La liberté [des travailleurs
allemands](...) est identique à la liberté du peuple tout
entier(...). » Schlageter avait été un « pèlerin du
néant », mais il aurait pu être « un pèlerin d'un
avenir meilleur pour l’humanité tout entière ».32
Le
discours sur Schlageter fut suivi d’une offensive idéologique
contre les nazis parmi les partisans des nazis eux-mêmes. Des
dirigeants communistes comme Ruth Fischer débattirent avec des
porte-parole des nazis dans des réunions d’étudiants, par
exemple, chez lesquels les nazis étaient implantés et où la gauche
révolutionnaire était très faible.
Beaucoup
de ceux qui ont depuis critiqué cette politique l’ont identifiée
avec le national-bolchevisme de Laufenberg (le « communiste de
gauche » hambourgeois) que Radek lui-même avait sévèrement
dénoncé en 1919, et avec le national-communisme prêché par le
Parti Communiste stalinisé du début des années 1930. Tous deux ont
fait des concessions importantes à l’idéologie nazie – et dans
les années 30 il y avait aussi une tendance à une phraséologie
nationaliste rageuse qui avait bien peu à voir avec
l’internationalisme du mouvement ouvrier. Le ton des déclarations
communistes de 1923 était très différent.
Le
discours de Frölich sur « la classe ouvrière se constituant
elle-même en nation » est sans aucun doute loin d’être
irréprochable ; le fait que Radek puisse appeler un nazi
« camarade Schlageter »33
est incontestablement nauséeux. De plus, la tentative de gagner le
soutien des classes moyennes appauvries en faisant appel à leur
nationalisme encourageait
plus
qu’elle ne
combattait une idéologie fausse – mais le cadre général des
déclarations communistes était la résistance à l’hystérie
nationaliste. Après tout, c’étaient les députés communistes qui
votaient au Reichstag contre
les résolutions nationalistes, alors que les sociaux-démocrates
votaient pour.
Les
débats avec l’extrême droite étaient une tactique marginale à
une époque où en même temps, jour après jour, le parti appelait
les sociaux-démocrates à un front unique contre les nazis. Une fois
de plus, nous sommes bien loin de la politique de Laufenberg et du
KPD au début des années 30. De plus, ce qui est peut-être le plus
significatif, ce sont les nazis qui ont décommandé la série de
débats – parce qu’ils y perdaient des membres.
Le
« tournant » Schlageter fut certes une erreur, mais
pas
la folie criminelle dont certains ont cru bon de le qualifier.34
Le front unique
L’axe
principal de l’activité des communistes dans la première moitié
de 1923 suivait la ligne de l’année précédente – tenter, par
l’action commune, de gagner le soutien des travailleurs
sociaux-démocrates. C’était cette priorité qui permettait au
parti de grandir alors même que la social-démocratie commençait à
donner des signes de désintégration.
La
proposition générale de front unique devint désormais un appel à
ce que les sociaux-démocrates rompent avec les partis bourgeois et
forment un « gouvernement ouvrier » avec les
communistes.
C’était de plus en plus le slogan national depuis les derniers
mois de 1922 – en particulier après que le Quatrième Congrès de
l’Internationale Communiste l’ait adopté en décembre. Il
rencontra une prompte réponse chez les travailleurs des Etats
d’Allemagne centrale de Saxe et de Thuringe.
Là,
les sociaux-démocrates et les communistes avaient ensemble la
majorité des sièges dans les parlements des Länder – mais les
sociaux-démocrates s’obstinèrent, jusqu’au début de 1923, à
constituer des coalitions gouvernementales avec les partis bourgeois.
Puis, en mars 1923, la gauche prit le contrôle du SPD en Saxe et un
nouveau gouvernement, entièrement social-démocrate, fut formé sous
la présidence du social-démocrate de gauche Zeigner. Les
communistes votèrent pour lui au Landtag en échange de
l’acceptation de la formation d’une force d’autodéfense
ouvrière, de la libération des prisonniers politiques et de
l’organisation de comités « consultatifs » basés sur
les conseils d’usine.
Le
gouvernement national, à Berlin, fut de plus en plus perturbé dans
les mois qui suivirent. « La loi et l’ordre »
semblaient se briser en Allemagne centrale, où les centuries
prolétariennes manifestaient ouvertement, où les comités de
contrôle intervenaient de plus en plus pour fixer les prix, et où
les conseils d’usine se développaient comme nulle part ailleurs,
malgré le sabotage de l’aile droite du SPD toujours puissante.
Mais aussi bien pour les communistes que pour les sociaux-démocrates,
un point d’interrogation était suspendu au dessus du slogan de
« gouvernement ouvrier ». Cela signifiait-il que les
communistes étaient prêts à gouverner conjointement avec les
sociaux-démocrates ?
La
question avait été, bien évidemment, posée en premier lieu au
cours des journées turbulentes qui avaient suivi le renversement du
Kaiser, et, à nouveau, à la suite du putsch de Kapp. Dans les deux
cas, la participation des communistes à un gouvernement de coalition
avec les sociaux-démocrates avait été rejetée comme une question
de principe. Même l’idée plus limitée d’« opposition
loyale » à un gouvernement social-démocrate de gauche avait
causé une âpre controverse en mars 1920. Désormais les dirigeants
du KPD et certains leaders de l’Internationale trouvaient le slogan
de gouvernement SPD/KPD très attrayant. Il mettait les dirigeants
sociaux-démocrates au pied du mur face à leurs partisans – il
prouvait qu’ils préféraient une coalition avec la bourgeoisie
même lorsque l’équilibre des forces parlementaires leur aurait
permis de faire autrement.
Le
résultat fut excellent pour les communistes – aussi longtemps que
les dirigeants sociaux-démocrates refusèrent un gouvernement
d’unité. Mais s’ils acceptaient ? Ce serait alors les
communistes qui seraient piégés, obligés de participer à un
« gouvernement de gauche » avec un appareil d’Etat
toujours contrôlé par des fonctionnaires bourgeois, et d’assumer
la responsabilité de conditions économiques qui ne pourraient être
modifiées par leur faible portion de pouvoir gouvernemental.
La
discussion sur la participation au gouvernement saxon fut houleuse,
aussi bien dans le KPD qu’au sein de l’Internationale communiste
à l’époque du Quatrième Congrès. On ne peut pas dire qu’elle
ait trouvé une issue satisfaisante. Thalheimer avait tendance à se
passionner en faveur de gouvernements d’unité sur un programme
très minimaliste, alors que Lénine et Trotsky insistaient plutôt
sur la formation d’un tel gouvernement autour d’un programme
contenant nécessairement le début d’une destruction de l’Etat
bourgeois – en particulier l’armement des travailleurs et la
responsabilité du gouvernement devant les congrès de conseils
d’usine. Zinoviev martelait que le « gouvernement
ouvrier »
ne pouvait être que le synonyme de la dictature du prolétariat.
Mais
personne ne semblait se soucier d’une question très simple :
un slogan qui pouvait causer une telle confusion parmi des dirigeants
communistes expérimentés était certainement de nature à semer de
plus fort le trouble à la base, aussi bien communiste que
social-démocrate. Il donnait l’impression que la solution à tous
les problèmes reposait dans une combinaison gouvernementale
différente, et non dans la prise du pouvoir par les conseils
ouvriers. Comme Brandler, un partisan du slogan, le faisait remarquer
un an plus tard :
[Il]
mena à des illusions dangereuses dans la classe ouvrière, y compris
dans les cercles de notre parti, que peut-être une agitation intense
et principielle aurait pu surmonter. Mais le danger le plus important
était qu'ils se disaient : « D’abord une coalition
bourgeoise, ensuite un gouvernement social-démocrate soutenu par les
communistes, puis un gouvernement SPD/KPD, et puis un gouvernement
communiste sans que ne survienne aucune bataille sérieuse,
sanglante. »35
L’insistance
du parti sur l’appel au front unique et au gouvernement ouvrier se
combina, jusqu’à l’été, avec le sentiment que les perspectives
révolutionnaires immédiates étaient sombres et que par conséquent
la seule chose sérieuse à faire était de gagner des sections de
travailleurs sociaux-démocrates. Comme le formula Radek dans une
réunion du Comité central du KPD tenue les 16 et 17 mai :
Nous
ne sommes pas aujourd’hui en situation d’établir la dictature du
prolétariat, parce que la condition préalable, la volonté
révolutionnaire de la majorité du prolétariat, fait défaut.36
Brandler
exprima le même point de vue à la conférence internationale de
Francfort : « Nous faisons face aujourd’hui à un
reflux
de la vague révolutionnaire ».
Cela
aurait été correct en 1921 et en 1922. C’était encore
partiellement vrai au premier trimestre 1923. Mais en avril et mai
1923, cela aboutissait à ignorer ce que remarquaient de nombreux
commentateurs bourgeois – que l’inflation et l’occupation de la
Ruhr avaient produit une déstabilisation profonde de la société, à
laquelle une réaction de la classe ouvrière était inévitable.
Les
dirigeants communistes ne comprirent pas cela. Ils poursuivirent une
politique de front unique agressive – construction des Centuries,
des Comités de Contrôle, des conseils d’usine, et attraction sous
l’influence du parti de nombreux travailleurs de la base du SPD.
Mais ils faisaient tout cela de façon purement défensive, sans
préparer leur parti à utiliser les positions gagnées dans la lutte
défensive pour passer à l’offensive.
Le
parti fut surpris par la vague de grèves de mai-juin : comme
nous l’avons vu, il lui avait fallu quatre jours pour pouvoir
intervenir dans la grève de la Ruhr. Cela n’aurait dû en soi
avoir aucune importance. Il arrive souvent que l’activité
spontanée des travailleurs prend au dépourvu des dirigeants
établis, même révolutionnaires. Mais même lorsque le parti eut
commencé à comprendre qu’une nouvelle activité était en train
de se développer, sa posture resta défensive. Il semblait être
embarrassé par l’activisme des Centuries dans la Ruhr –
peut-être à cause de l’influence en leur sein de syndicalistes et
d’anciens membres du KAPD. Et il recommanda une fin rapide de la
grève, sans apercevoir la poussée à l’action qui grandissait
ailleurs en Allemagne.
Lorsque
des grèves se déclenchèrent ailleurs, le parti fit de son mieux
pour les encourager. Mais Rote
Fahne, par exemple, ne
donnait pas l’impression que la direction du parti se rendait
compte qu’il y avait eu un changement qualitatif
dans l’état d’esprit de la classe. En fait, il semble qu’il y
ait eu une diminution de l’activité du parti pendant la grève par
comparaison avec les débuts de mai, qui avaient vu le parti
organiser à Berlin une série de grands meetings propagandistes et
de manifestations de masse.
Dans
un discours à la tonalité autocritique tenu quelques mois plus
tard, Radek décrivait la séquence des évènements :die
Ruhrgeschichte [hat] eine neue Phase in der
Entwicklung des
Klassenkampfs in Deutschland eröffnet ... Wir haben auf dem
Leipziger Parteitag in dem Aufruf an die Partei gesagt: diese Phase
endet mit dem Bürgerkrieg. Wir haben theoretisch richtig visiert,
und wir haben die praktischen Schlüsse daraus nicht gezogen.
[Hätten] wir seit Mai, als der Durchfall der Ruhraktion
[das
Scheitern des passiven Widerstands] schon klar war, als die
Zersetzungselemente außerordentlich wuchsen, ... die wachsenden
Massenkämpfe aufgerollt .
L’affaire
de la Ruhr a ouvert une nouvelle phase du développement de la lutte
des classes en Allemagne. (...) Nous disions, dans l'appel au parti
du congrès de Leipzig [en janvier] : cette phase se termine
avec la guerre civile. Nous avons bien visé théoriquement, mais
nous n'en avons pas tiré les conclusions pratiques. [Nous aurions
dû] développer les combats de masse croissants à partir de mai,
alors que l’échec de l’action de la Ruhr [l'échec de la
« résistance passive’ » était déjà patent, et alors
que les éléments de décomposition sociale s’accumulaient de
façon extraordinaire.37
Même
la construction des Centuries prolétariennes, un élément clé de
la stratégie défensive de front unique, ne semble pas avoir été
prise très au sérieux par de nombreuses sections du parti. Brandler
déclara plus tard : « En août 1922, alors que je
revenais en Allemagne après l'amnistie de Rathenau, j'ai fait une
déclaration sur la préparation à la guerre civile. (...) Personne
n'a rien entrepris. (...) C'était en particulier le cas à
Berlin. »38
Comment
expliquer ce décalage par rapport aux évènements ? Il ne fait
aucun doute que pour la direction du parti dans son ensemble et pour
son mentor de l’Internationale, Radek, l’expérience de l’Action
de Mars fut décisive. Ils vivaient dans la hantise d’une
répétition de l’aventure qu’ils avaient engagée avec tant
d’enthousiasme à peine deux ans auparavant. C’est à
l’ajustement de la tactique après l’Action de Mars que Radek se
référait, dans le discours cité ci-dessus, lorsqu’il décrivait
la lenteur de la réaction du parti en 1923. Il expliquait qu’après
l’Action de Mars il était dit :
il
faut d'abord conquérir les masses. Cette période de conquète des
masses (...) dura jusqu’à la guerre de la Ruhr. Ensuite, nous ne
pouvions plus les gagner par la voie propagandiste, pour les
conquérir nous devions passer à l’action. Et à nouveau le
contexte (...) dans son ensemble n'a pas été saisi assez vite.39
La
timidité de la direction fut aggravée par un autre facteur. Après
l’Action de Mars, une puissante fraction d’opposition, dirigée
par Ruth Fischer et Arkadi Maslow, avait grandi dans le parti, qui
était partisane de l’action offensive en toute circonstance. Elle
dénonçait la direction pour ses « concessions à la
social-démocratie », son « opportunisme »,
sa
position « sur le terrain de la démocratie » (par
quoi
elle voulait dire la démocratie bourgeoise), son
« liquidationnisme
idéologique et son révisionnisme théorique ». Lorsque la
tactique du front unique fut formulée, elle la dénonça
rageusement. Plus tard, elle l’approuva formellement – à
condition qu’elle soit « par en bas » et non
« par
en haut ».
L’hostilité
générale de l’opposition envers le front unique se traduisait
nécessairement par un refus du « gouvernement
ouvrier ».
Mais les critiques en provenance de tels milieux étaient peu
susceptibles d’influencer ceux qui avaient appris à la dure le
besoin de gagner le soutien des travailleurs sociaux-démocrates. De
la même façon, Fischer et Maslow pouvaient appeler de leurs vœux
une réponse apparemment agressive à la crise de la Ruhr – sans
proposer de véritable alternative à l’autosatisfaction de la
direction.
En
février et mars, Fischer visita la Ruhr et commença à y déclencher
une campagne fractionnelle acharnée contre la direction. Elle
proclamait que celle-ci n’avait pas mis en avant des revendications
concrètes dans les premiers jours de l’occupation. Elle aurait dû,
disait-elle, appeler au contrôle ouvrier des mines et des usines, et
des produits de première nécessité. La lutte sur ces
revendications aurait amené les ouvriers à se rendre maîtres des
usines. En même temps, les Centuries prolétariennes auraient dû
s’installer là où les Français avaient expulsé la police de
sécurité. C’est alors que la base aurait été posée d’une
lutte immédiate pour le pouvoir dans toute l’Allemagne.40
Au
lieu de cette « politique révolutionnaire »,
s’indignait-elle, la direction proposait ni plus ni moins un
« soutien à un gouvernement social-démocrate
minoritaire »
- une position que les communistes ne devaient adopter « en
aucun cas ».
La
direction n’eut pas beaucoup de mal pour dénoncer tout cela comme
un bavardage vide de sens. En janvier et en février, les autorités
aussi bien allemandes que françaises traitaient les travailleurs
avec des gants de velours – les Français prétendant qu’ils
étaient venus pour punir les employeurs et non pas les travailleurs,
les Allemands offrant des hausses de salaires et des indemnités de
chômage au niveau de 100 % des rémunérations. Dans une telle
situation, il n’y avait aucune base pour la construction d’un
mouvement pour le « contrôle de la production » et
des
« produits de première nécessité ».
Pour
couronner le tout, si une telle lutte avait commencé, elle aurait
fait le jeu des bourgeoisies aussi bien allemande que française.
Elle aurait donné aux autorités françaises une excuse pour saisir
les mines à leur bénéfice, en utilisant le
« désordre »
comme un prétexte, et tout affrontement avec les troupes françaises
aurait été mis à profit par l’extrême droite allemande pour
développer l’hystérie nationaliste.
Fischer,
comme la direction pouvait facilement le faire remarquer, ignorait
tout simplement les faits les plus élémentaires relatifs à la
conscience des travailleurs en janvier et février, la « grande
passivité des travailleurs ». Dans la Ruhr, les conditions
étaient « idylliques comparées aux journées de Noske et
Watter en 1919 et 1920 ».41
La
direction réussit à faire passer sa politique à la fois au congrès
national du parti en janvier (par plus de deux contre un) et dans une
conférence des districts de la Ruhr en mars (par 68 voix contre 55).
Mais l’opposition avait une emprise sur d’importantes sections du
parti – Berlin, la côte Nord-Ouest, et la moitié de la Ruhr. De
plus, sa présence aboutissait à ce que toute la vie interne du
parti était caractérisée par des débats semblables à ceux
mettant en lice « gouvernement » et
« opposition »
dans un parlement bourgeois : chaque camp se sentait obligé de
s’opposer par principe à toute proposition de l’autre. La
discussion politique entre camarades de parti se ramenait à compter
les points.
Même
lorsque l’Internationale intervint pour forcer les deux côtés à
travailler ensemble dans les comités de direction, rien ne fut
réglé. Comme personne n’était capable de comprendre le
changement qualitatif qui s’était produit dans la lutte des
classes à la fin du printemps, le fractionnisme dans le parti, loin
de produire une dialectique de discussion qui pouvait élever le
niveau de compréhension des évènements, aboutit à figer les deux
camps dans des postures sans pertinence.
La
direction considérait l’opposition (à raison) comme une horloge
arrêtée : sans égard pour les circonstances, elle tirait
toujours les mêmes conclusions. L’opposition, malgré les injures
dont elle abreuvait la direction, tendait aux moments cruciaux à
adopter les mêmes conclusions passives que celle-ci : lorsque
la véritable lutte éclata en mai dans la Ruhr, Fischer n’avait
rien à dire.
La journée antifasciste
La
seule tentative pour inverser l’attitude défensive du parti ne
vint pas de la prétendue « gauche », mais du
président
du parti, Brandler. Le 12 juillet, la première page de Die
rote Fahne était
porteuse d’une importante déclaration écrite par lui, « Au
Parti ». Elle décrivait une situation de crise montante, dans
laquelle la lutte armée n’était pas éloignée. « Le
gouvernement Cuno est en faillite. Les crises, interne et externe,
l’ont amené au bord de la catastrophe.
Les
fascistes progressaient, disait Brandler. Leurs attaques contre la
classe ouvrière pouvaient prendre différentes formes :
L'offensive des fascistes ne
commence pas
nécessairement par un putsch à la Kapp ; elle peut commencer
avec l’imposition de l'état de siège en Saxe et en Thuringe ;
ou bien avec la proclamation d’une république indépendante de
Rhénanie-Westphalie. Il peut suivre une attaque contre les luttes
salariales des travailleurs. (...) [Dans tous les cas] nous sommes à
la veille de luttes acharnées. Nous devons être entièrement prêts
à agir.
Il
sera nécessaire d’impliquer des travailleurs sociaux-démocrates
et sans parti dans cette action, disait Brandler :
Notre parti doit développer la
combativité de ses organisations au point où elles ne seront pas
surprises par le déclenchement de la guerre civile. (…) Une
attaque des fascistes ne peut être battue qu’en opposant la
terreur rouge à la terreur blanche. Si les fascistes armés tirent
sur les travailleurs, nous devons être prêts à les annihiler.
S’ils mettent contre le mur un travailleur sur six, nous devrons
fusiller un fasciste sur cinq. Dans l’esprit de Karl Liebknecht et
de Rosa Luxemburg, à l’attaque !
Le
même numéro de Die
rote Fahne annonçait
que quinze jours plus tard, le 29 juillet, il y aurait une journée
nationale de manifestations antifascistes. Il était clair que
c’était le jour où l’offensive contre la droite devait être
lancée.
L’appel
de Brandler fut reçu comme un signal que les communistes
abandonnaient leur posture défensive. Les grandes grèves avaient
montré l’amplitude de la colère populaire. Le parti semblait sur
le point de canaliser cette colère dans une bataille pour le
contrôle de la rue le 29 juillet. La presse bourgeoise piaillait que
l’appel n’était rien d’autre que le signal de la guerre
civile. Pourtant il bénéficiait du soutien de sections de
travailleurs sociaux-démocrates et de syndicalistes sans
affiliation, dont les organisations locales s’engageaient
nommément.
Ce
que pouvait faire cette action unie fut démontré à Francfort le 23
juillet. Une manifestation conjointe du KPD et du SPD descendit dans
les rues de la ville, fermant les boutiques et obligeant les passants
petits bourgeois à scander des slogans tels que « Les
exploiteurs à l’échafaud » et « Pas de justice sans
verser le sang ».42
Il
est clair que les dirigeants sociaux-démocrates nationaux étaient
réduits à la défensive. Ils essayèrent de défendre à leurs
membres de s’engager dans les Centuries prolétariennes. Puis des
ministres SPD prirent l’initiative d’interdire les manifestations
de la Journée Antifasciste dans les Länder qu’ils contrôlaient
(à l’exception de la Saxe, de la Thuringe et du Wurtemberg) – un
exemple que les autres Etats étaient tout à fait désireux de
suivre. Si les communistes persistaient dans leurs manifestations,
ils risquaient une confrontation armée dans les grandes villes avec
la police de sécurité, peut-être même avec la troupe.
Les
interdictions amenèrent à la surface les réserves de nombreux
dirigeants communistes envers l’initiative de Brandler du 12
juillet. « Cet appel eut un effet particulier sur le
parti »,
raconta Brandler plus tard. « Dans les masses laborieuses il
éveilla de l’espoir, mais dans les rangs des permanents du parti
il y avait cette idée : Brandler est encore devenu fou et veut
faire un putsch ». Il prétendait que « c’était
particulièrement le cas à Berlin », le centre de la
« gauche ».43
L’annonce
des interdictions causa un désarroi dans la direction. La plupart
les voyaient comme un prétexte pour prendre ses distances avec le
« coup de folie » de Brandler. Ce dernier persistait
dans
son désir d’une tactique offensive. Il suggéra de défier
l’interdiction partout où le rapport des forces permettait aux
communistes de fournir une protection armée capable de dissuader la
police d’attaquer les manifestations – dans la province
prussienne de Saxe, dans la Ruhr, en Haute Silésie aussi bien que
dans le Land de Saxe et en Thuringe. De cette façon le parti
montrerait qu’il était capable de braver les autorités sans pour
autant prendre le risque de s’engager dans des affrontements
sanglants pendant que la masse des travailleurs restait sur la
touche.
Brandler
s’aperçut que non seulement la plus grande partie de la
« majorité » de la direction lui était
opposée ;
il n’avait non plus aucun soutien de la « gauche ».
La
dirigeante des « gauches », Ruth Fischer, se souciait
surtout que son bastion personnel, Berlin, ne soit pas inclus dans le
plan de Brandler. Lorsque celui-ci lui demanda si le district de
Berlin pouvait fournir une protection armée à la manifestation,
elle le traita d’« aventurier » et de
« fasciste ».
Face
à la rebuffade aussi bien de la majorité que de l’opposition,
Brandler hésita. Il avait fait une erreur en 1921 en lançant une
action prématurée et il n’avait pas l’intention de récidiver.
Alors il répéta son autre erreur de 1921 – il se tourna, pour
décider d’une question tactique, vers des hommes qui étaient
éloignés d’une vision détaillée des évènements. Il
télégraphia à Moscou.
Mais
il n’y avait personne à Moscou pour donner un conseil. Lénine,
paralysé, était mourant. Le reste de la direction russe, à
l’exception de Radek – qui avait été aussi mauvais tacticien
que Brandler en 1921 – était en congé, se reposant d’une
conférence éprouvante. La première bouffonnerie, le télégramme
de Brandler à Moscou, fut suivie d’une seconde, Radek
télégraphiant dans les endroits les plus distants de la Russie pour
avoir l’opinion individuelle de dirigeants qui n’avaient même
pas une connaissance de seconde main de la situation allemande.
Zinoviev
et Boukharine étaient partisans d’une tactique offensive – mais
Radek savait qu’eux aussi avaient eu tort en 1921. Staline (c’était
l'une des première fois qu’il venait à l’esprit de quelqu’un
de lui demander son avis sur des questions internationales) affirma
avec insistance que le parti allemand devait être retenu. Comme il
l’expliqua quelques jours plus tard : « Si le pouvoir
tombait, pour ainsi dire, aujourd’hui en Allemagne, et que les
communistes s’en emparent, ils échoueraient avec fracas ».44
Trotsky fut le seul a avoir l’honnêteté d’admettre qu’il
n’avait pas la moindre idée de la situation sur le terrain en
Allemagne et donc ne pouvait rien dire.
Radek
en fut réduit à choisir entre des positions contradictoires.
Craignant une tentative, dans le style de 1921, de « forcer
les
évènements », il répondit à Brandler : « Le
Présidium de l’Internationale suggère de renoncer aux
manifestations ».45
Les
manifestations prévues furent remplacées par des meetings, sauf en
Saxe, Thuringe et Wurtemberg, où les rassemblements n’avaient pas
été interdits. Les meetings furent imposants :
200 000
participants à Berlin, 50 000 à Chemnitz, 30 000 à
Leipzig, 25 000 à Gotha, 20 000 à Dresde,
100 000 au
total au Wurtemberg. Mais c’était un recul. Il n’y avait plus
aucun défi aux fascistes ou au gouvernement autre que verbal. Le
parti avait, dans les faits, abandonné l’offensive ouverte par
l’appel de Brandler du 12 juillet. Au lieu de lancer dans la
bataille la mobilisation construite au sein de la classe ouvrière
depuis la mi-mai en la dirigeant politiquement, le parti était
retourné à la posture défensive développée en 1922.
Dans
la presse communiste l’appel « Aux armes » fut
remplacé
par l’avis de Radek : « Nous devons toujours garder à
l’esprit que nous sommes encore faibles aujourd’hui. Nous ne
pouvons encore livrer une bataille générale ». Brandler
lui-même déclarait avec insistance, dans une réunion du Comité
central tenue les 5 et 6 août, que ce à quoi ils se préparaient
était une « lutte révolutionnaire défensive ».
Pourtant,
l’abandon par le parti du bref tournant vers l’offensive ne
précéda que de quelques jours le déclenchement par les
travailleurs de Berlin de la plus formidable vague de grève qui ait
été vue jusque là.